
M. Ernest Michel.
The Project Gutenberg EBook of À travers l'hémisphère sud, ou Mon second
voyage autour du monde, by Ernest Michel
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: À travers l'hémisphère sud, ou Mon second voyage autour du monde
Tome 1; Portugal, Sénégal, Brésil, Uruguay, République
Argentine, Chili, Pérou.
Author: Ernest Michel
Release Date: September 2, 2008 [EBook #26510]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK A TRAVERS L'HEMISPHERE SUD ***
Produced by Adrian Mastronardi, Christine P. Travers and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Note au lecteur de ce fichier digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été
corrigées.

M. Ernest Michel.
Portugal, Sénégal, Brésil, Uruguay, République Argentine, Chili, Pérou.

PARIS
LIBRAIRIE VICTOR PALMÉ
(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE)
76, Rue des Saints-Pères, 76
| BRUXELLES | GENÈVE |
| Société belge de Librairie | Henri Trembley, Éditeur |
| Rue des Paroissiens, 12. | 4, Rue Corraterie. |
| 1887 | |
Sur la route de Londres à Brighton, un jeune Anglais monte dans mon wagon et s'assied en face de moi. Il a l'air pressé et fatigué, et accepte volontiers les petites provisions que je lui offre. Qu'est-ce qui vous rend si essoufflé, lui dis-je?—Je viens du Mont-Blanc et j'ai passé plusieurs nuits en route pour ne pas manquer le navire qui part demain pour la Nouvelle-Zélande, où je vais m'établir.—Vous allez donc chercher fortune?—Non; j'ai mes capitaux, mais ici ils me rapportent 3%, et en Nouvelle-Zélande 10%. Dans mon village je ne suis rien; là-bas un des premiers. Je viens de parcourir le globe dans un voyage d'investigation, qui a duré deux ans; j'ai visité tous les pays, je les ai comparés, j'ai pesé pour chacun le pour et le contre, et j'ai arrêté mon choix sur la Nouvelle-Zélande. Par son climat tempéré, ses terres fertiles, c'est celui qui présente en ce moment les plus grandes ressources et le séjour le plus agréable. Tous les objets de première nécessité y sont à bon marché, (p. II) et les capitaux y trouvent un emploi lucratif. Je viens donc chercher ma famille et nous partons demain; je ne voulais pas quitter l'Europe sans avoir vu le Mont-Blanc pour le comparer au Mont-Cook des Alpes New-Zélandaises.
Puis, voyant qu'il parlait à un Français, il ajoutait: Pour quelle raison, je l'ignore, mais j'ai constaté que vos compatriotes réussissent peu dans les divers pays.
Là où ils sont venus avec nous, comme en Chine et au Japon, ils disparaissent peu à peu, laissant la place aux Anglais et aux Allemands.
Cette dernière observation fut pour moi fort sensible; je résolus donc d'aller la vérifier en faisant moi aussi un voyage d'investigation à travers le globe.
Un premier tour du monde m'a fait connaître le Canada, les États-Unis, le Japon, la Chine et les Indes. Il a été publié en 2 volumes, à l'imprimerie du Patronage Saint-Pierre, à Nice, sous le titre de Tour du Monde en 240 Jours.
Un second tour du monde vient de me faire voir le Sénégal, le Brésil, l'Uruguay, la République Argentine, le Chili, le Pérou, l'Équateur, Panama, les Antilles, le Mexique, les Sandwich, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Maurice, la Réunion, les Seychelles, Aden, l'Égypte et la Palestine.
(p. III) Je publie aujourd'hui ce deuxième voyage en trois volumes. Le premier comprendra l'Amérique du Sud; le second, Panama, les Antilles, et mon arrivée en Californie à travers le Mexique et les États-Unis.
Le troisième contiendra mes excursions dans les diverses îles de l'Océanie, et mon retour par Maurice, la Réunion, Aden, l'Égypte et la Palestine.
Ces trois volumes pourront être indépendants; c'est pourquoi je les fais précéder chacun d'une préface se rapportant aux pays visités.
Dans le récit de mon premier voyage, j'ai déjà parlé de l'utilité et de la nécessité des voyages d'étude; je signale aujourd'hui un moyen de les populariser. Ce sont les billets circulaires de Tour du monde. Les Anglais les connaissent. Les compagnies anglaises de navigation, d'accord avec les compagnies américaines, donnent pour 3 à 4,000 fr., des billets pour des tours divers, passant soit par le Japon et la Chine, soit par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le grand touriste Cook leur donne des billets d'hôtel à des prix fixes pour tous les pays du monde, et conduit tous les ans, par ses employés, des caravanes de voyageurs dans toutes les contrées à un prix fixe, et à forfait.
Le Bradshow Overland guide leur fournit, pour tous les pays, les renseignements utiles: surface, gouvernement, commerce, industrie, agriculture, ressources (p. IV) diverses, nombre de nationaux et d'étrangers, mœurs et coutumes, nom et adresse des consuls, etc.
Pourquoi n'en ferions-nous pas autant? Ce n'est pas que la liberté ne soit préférable; on peut changer de plan en route, s'arrêter plus longtemps dans tel pays, etc.; mais si la liberté a des avantages pour celui qui est habitué aux voyages, un plan tout tracé, une dépense fixe, un temps limité, sont des choses précieuses qui peuvent décider les plus timides, et surtout ceux qui disposent de peu de temps et de peu d'argent.
J'indique ici trois tours que nos compagnies et surtout les Messageries maritimes et la Transatlantique pourraient organiser, en s'entendant avec les compagnies américaines.
| 1er TOUR. | NOMS DES COMPAGNIES | NOMBRE approximatif DE JOURS | PRIX ACTUEL en 1re cl. | |
| Du Havre à New-York. | Transatlantique. | 8 | 500 | f |
| De New-York à San-Francisco. | Chemin de fer. | 7 | 700 | |
| De San-Francisco à Yokohama. | Pacific-Américaine. | 18 | 1,200 | |
| De Yokohama à Marseille, par Hong-Kong, Canton, Singapor, Ceylan. | Messageries maritimes. | 40 | 1,800 | |
| —— | ——— | |||
| Total | 73 | 4,200 | f | |
| —— | ——— | |||
Le prix du billet circulaire pourrait être réduit à 3,000 fr.
(p. V)| 2e TOUR. | NOMS DES COMPAGNIES | NOMBRE approximatif DE JOURS | PRIX ACTUEL en 1re cl. | |
| De Bordeaux à Lisbonne, Dakar, Brésil, Montevideo, Buenos-Ayres. | Messageries ou Transports maritimes. | 20 | 800 | f |
| De Buenos-Ayres, par Magellan, au Chili et au Pérou. | Pacific-Anglaise. | 20 | 1,000 | |
| De Callao à Panama. | Pacific-Anglaise. | 8 | 500 | |
| De Colon aux Antilles et à Saint-Nazaire. | Transatlantique. | 18 | 1,000 | |
| —— | ——— | |||
| Total | 66 | 3,500 | f | |
| —— | ——— | |||
Le prix du billet circulaire pourrait être à 2,500 fr.
| 3e TOUR. | NOMS DES COMPAGNIES | NOMBRE approximatif DE JOURS | PRIX ACTUEL en 1re cl. | |
| De Saint-Nazaire à Vera-Cruz. | Transatlantique. | 17 | 1,000 | f |
| De Vera-Cruz à Mexico et à San-Francisco. | Chemin de fer. | 8 | 1,000 | |
| De San-Francisco aux Sandwich, Nouvelle-Zélande, Australie. | Pacific-Américaine. | 22 | 1,050 | |
| De Sidney à Nouméa (aller et retour). | Messageries maritimes. | 8 | 400 | |
| De Sidney à Marseille, par Maurice, Réunion, Seychelles, Aden, Suez. | Messageries maritimes. | 35 | 1,625 | |
| —— | ——— | |||
| Total | 90 | 5,075 | f | |
| —— | ——— | |||
Le prix du billet circulaire pourrait être de 4,000 fr.
En un mot, les compagnies n'auraient qu'à faire un rabais de 20 à 25% pour les billets circulaires. En (p. VI) Espagne, en Italie et ailleurs, les compagnies de chemins de fer font un rabais de 40 à 45%. On accorderait un an de temps avec faculté d'interrompre le voyage à toutes les escales pour visiter le pays. Un planisphère indiquant ces trois tours avec prix et conditions dans le Guide-Chaix hebdomadaire en populariserait la connaissance. Ce n'est que depuis l'insertion des voyages circulaires dans l'Indicateur des chemins de fer que l'Algérie et la Tunisie commencent à être un peu visitées par nos nationaux.
Les compagnies de navigation seraient amplement compensées de leur sacrifice par le plus grand nombre de passagers, d'autant plus que la plupart du temps, aujourd'hui, leurs navires s'en vont à moitié vides.
Pour bien tirer parti des voyages, il faut s'y préparer.
La première préparation consiste à connaître au moins les éléments de la langue parlée dans le pays qu'on va visiter. Je dis les éléments, car la pratique ensuite fera le reste. Sans cela on risquerait de parcourir les villes, de visiter les monuments, d'admirer les scènes de la nature, mais on ne connaîtrait pas les hommes, qui sont le pays vivant. Il importe en effet de les interroger, depuis le gouvernant jusqu'à l'homme du peuple. À cet effet, le voyageur devra se munir de lettres de recommandation pour les savants, les commerçants, (p. VII) les industriels, les agriculteurs, les missionnaires, les hommes politiques. Sans cette précaution, il ne pourrait le plus souvent les aborder, et malgré sa bonne volonté, il ne pourrait connaître ce qui se passe dans le pays.
Lorsqu'on fait partie d'une Société de Géographie, d'une Conférence de Saint-Vincent de Paul et autres associations analogues, il est facile d'avoir les lettres nécessaires, car des associations similaires existent partout, et il suffit d'aborder quelques personnes bien placées dans un pays, pour que celles-ci vous fassent ouvrir toutes les portes.
La langue espagnole est indispensable dans toute l'Amérique du Sud. Celui qui la possède se fera bien vite à la langue portugaise, parlée dans tout le Brésil. Pour l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Hindoustan et tout l'Extrême-Orient, la langue nécessaire est l'anglaise. Dans le bassin de la Méditerranée vers l'Orient, la langue européenne la plus en usage est encore l'italien, mais le français s'y répand tous les jours davantage. L'allemand est nécessaire dans le nord de l'Europe.
Le voyageur devra lire les derniers ouvrages sur les pays qu'il va visiter, porter avec lui un thermomètre, une boussole, un baromètre anéroïde, l'Aide-Mémoire du voyageur de Kaltbruner, ou tout autre semblable, (p. VIII) et se munir des meilleures cartes. Il est regrettable que jusqu'à ce jour les meilleures cartes soient encore celles des Anglais et des Allemands.
Un des ennuis du voyageur c'est le changement de monnaie, de poids et de mesures dans chaque pays. Comme on a unifié la poste, il serait utile d'unifier les monnaies, les poids et les mesures.
Un billet circulaire pris au Comptoir d'Escompte de Paris, ou des traites circulaires achetées à la Société générale pour le développement du Commerce et de l'Industrie, permettent au voyageur de se procurer aux banques correspondantes, dans tous les pays, la monnaie indigène nécessaire. Ces traites sont fournies au pair et sans frais. Quant à la dépense qu'on peut faire à terre, elle atteint une moyenne de 30 fr. par jour, tout compris. Les hôtels, dans tout l'Extrême-Orient, n'atteignent pas les prix des hôtels de l'Europe.
Le voyageur devra se garder de la manie des malles lourdes ou nombreuses; elles lui coûteraient autant que son voyage, sans parler des ennuis de toute sorte pour veiller sur elles. Un vêtement de flanelle de Chine, deux vêtements d'été, un d'hiver et un peu de linge de corps avec un pardessus et un châle suffisent, et le tout tient dans une valise et une courroie, qu'on peut au besoin porter à la main. Les objets de curiosité qu'on achète en route sont facilement et économiquement (p. IX) expédiés en Europe, du premier port qu'on rencontre.
Quelques-uns s'imaginent qu'il faut s'armer jusqu'aux dents. Les armes sont dangereuses, provoquent la méfiance et exposent à une mauvaise action. Les meilleures armes sont: la prudence, la bienveillance, la fermeté, la justice envers les populations. Je n'en ai jamais eu d'autre, soit dans les pays civilisés, soit dans ceux plus primitifs du Japon, de la Chine, de l'Hindoustan, de l'Araucanie et des Canaques. J'ai même traversé seul en voiture tout le Mexique, si renommé pour ses brigands; je n'ai trouvé partout que d'honnêtes gens polis, et aimables lorsqu'on les traite convenablement.
Enfin, le voyageur devra prendre ses notes aussitôt après ses conversations et pendant sa visite aux divers établissements. Il devra rédiger jour par jour, ou tout au moins chaque semaine, son journal de voyage. Les longues journées de navigation lui seront pour cela fort utiles. Les notes écrites sur place sont plus vivantes et conservent la physionomie des personnes et des lieux. Si on retarde, les impressions d'une contrée effacent celles de la contrée visitée précédemment.
Plusieurs croient impossible d'aborder les grands voyages à moins d'une constitution robuste. Je peux affirmer le contraire. J'ai rencontré partout les Anglais (p. X) et les Américains, de santé délicate, voyageant pour la fortifier; je les ai vus, s'en allant aux antipodes avec femme et enfants; j'en ai rencontré un bon nombre voyageant autour du monde en voyage de noces.
J'ai cru devoir entrer dans tous ces détails, parce qu'ils sont utiles au voyageur. L'essentiel, c'est que notre jeunesse voyage, non en touriste, pour s'amuser, en gaspillant le temps et l'argent, mais en observateurs, pour rapporter dans le pays des connaissances étendues, des faits nombreux, bien étudiés. Nous pourrons alors, par la comparaison de ce qui se passe chez les peuples divers, adopter ce qui leur réussit, préparant ainsi notre réforme, non sur des théories, mais sur l'expérience.
Dans ce premier volume, après un arrêt en Portugal et au Sénégal, que nous aurions déjà dû relier à l'Algérie, le lecteur verra au Brésil comment des vues courtes et une étroitesse d'esprit font que les ressources précieuses de cet immense pays demeurent inexploitées et perdues, aussi bien pour les habitants que pour le reste de l'humanité. Il y remarquera encore l'horrible plaie de l'esclavage.
À l'Uruguay, à la République argentine, comme dans les autres républiques de race espagnole, il verra à quel triste état les guerres civiles périodiques réduisent (p. XI) les populations, qui devraient pourtant prospérer et se multiplier sur d'immenses terres fertiles.
Au Chili, il trouvera une race plus virile, mais abusant, elle aussi, des Indiens, qu'elle tient dans un état bien misérable.
Au Pérou, il déplorera la corruption générale, fruit de la richesse, et suivie du désastre d'une guerre sanglante et malheureuse.
Le lecteur, comme le voyageur, saura tirer parti pour son pays de toutes ces observations.[Table des matières]
Portugal.
Le départ. — Le Tage. — Lisbonne. — La ville. — Les œuvres catholiques. — L'église de Saint-Roch. — Le cloître de Bélem. — La Casa Pia. — La navigation. — Un mineur qu'on voudrait détrousser. — Le steamer le Niger. — Ses dimensions. — Les passagers.
Ce n'est pas sans émotion que le voyageur au long cours quitte le sol natal. Les parents, les amis se présentent à son esprit et semblent vouloir le retenir; l'imagination accumule les difficultés, les périls, et s'efforce de l'arrêter. Puis la pensée de la Providence qui veille sur toutes ses créatures dissipe ce trouble d'un moment.
C'est dans ces sentiments que le 20 mai 1883, à dix heures du matin, je quittai Bordeaux pour descendre la Gironde et rejoindre à son embouchure le Niger, steamer de la Compagnie des Messageries maritimes, qui devait me porter au Brésil.
Trois jours de navigation nous firent franchir les côtes de France et d'Espagne, et dans la nuit du 23 mai notre navire jetait l'ancre dans le Tage, en face de Lisbonne, en Portugal.

Type de Paysanne portugaise.
Cette ville de 300,000 habitants, vue du port, ressemble un peu à Gênes. Elle est construite en partie sur plusieurs (p. 002) collines que les voitures ont de la peine à escalader. Après les formalités de la santé et de la douane, je prends terre et me rends à Saint-Louis des Français. Chemin faisant, je rencontre de nombreux tramways traînés par des mules. Des paysans en costume pittoresque emmènent sur leurs mulets les denrées au marché; mais ce que je trouve de plus coquet, ce sont les vendeuses de poisson coiffées d'un gracieux chapeau de feutre surmonté d'une corbeille remplie de gros poissons. Elles courent pieds nus, les mains sur les hanches, se dandinant plus ou moins gracieusement, et poussant ces cris traînards qui sont la spécialité des poissardes de tous les pays. Le P. Miel, lazariste, me reçoit avec bonté, et me présente au comte d'Aljésur, Brésilien qui passe les hivers à Lisbonne, où il préside la conférence de Saint-Vincent de Paul, fondée en 1859 à Saint-Louis des Français. Une seconde conférence vient d'être inaugurée le 19 mars dernier chez les RR. PP. dominicains irlandais, et l'on s'occupe déjà de la subdiviser pour étendre plus aisément son action bienfaisante à (p. 003) chacune des trente-trois paroisses de la ville. En dehors des deux conférences de Lisbonne, chacune des villes suivantes possède la sienne: Funchal, Braga, Porto, Marinha Grande, Guimaraens, Penafiel et Coïmbra; en tout neuf conférences avec 1,182 membres et souscripteurs, distribuant 25,000 francs de secours en nature à 450 familles. C'est bien peu pour un pays qui compte dix mille confréries et associations de tiers ordres avec leurs hôpitaux, leurs asiles et leurs orphelinats; mais l'abondance même de ces instituts charitables, largement pourvus de ressources, explique le peu de développement de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. Maintenant qu'une impulsion vigoureuse lui a été donnée, tout fait espérer qu'elle se propagera.

Type de Poissarde portugaise.
Lisbonne possède soixante-dix belles églises, sans compter les oratoires et chapelles privées: la plus ancienne est la basilique patriarcale de Sainte-Marie Majeure, dont on attribue la fondation à l'empereur Constantin; elle était dès le commencement du IVe siècle le (p. 004) siège d'un évêché, car depuis cette époque les actes des conciles de Tolède portent la signature d'un Episcopus Olissiponensis. En 1394, le Prélat de Lisbonne fut promu au rang d'archevêque, et plus tard, en 1716, élevé à la dignité de patriarche et aux honneurs de la pourpre romaine. Le titulaire actuel est le cardinal Neto, né en 1841, nommé en 1879 à l'évêché d'Angola et du Congo, promu en avril 1883 au patriarcat; il est le moins âgé des membres du sacré collège.
Tout près de la cathédrale on aperçoit la jolie petite église de Saint-Antoine, bâtie sur l'emplacement de la maison où le saint vint au monde en 1195. Les Portugais ont une grande dévotion envers leur compatriote saint Antoine, dit de Padoue, parce qu'il expira dans cette ville le 13 juin 1231. Grégoire IX le canonisa onze mois après, le 30 mai 1232, et on raconte que ce jour-là les cloches de Lisbonne se mirent d'elles-mêmes à carillonner joyeusement, tandis que toute la population se livrait à la danse, sans que personne soupçonnât la cause de la commune allégresse.
Je passe, ensuite à l'Hôpital français: les Sœurs de Saint-Vincent de Paul y soignent quelques malades et instruisent un grand nombre de jeunes filles. Je trouve là un jeune abbé auquel je demande de quelle partie de la France il est originaire; il me répond: «Je ne suis pas Français, je suis Auvergnat.»
L'église de Saint-Roch, ainsi que son vaste couvent, avait été donnée en 1533, par Jean III, à la Société de Jésus, (p. 005) et saint François Borgia y a prêché. Ce qui y attire le plus l'attention c'est la magnifique chapelle de Saint-Jean-Baptiste, dans laquelle on a prodigué les marbres les plus rares, les bronzes les plus artistiques, les mosaïques les plus belles et les pierres précieuses. L'on raconte qu'en 1718, Jean V assistant dans cette église à la fête de saint Ignace de Loyola et remarquant que toutes les chapelles étaient profusément ornées de fleurs et de lumières, à l'exception de celle de saint Jean, s'enquit de la cause, et qu'on lui répondit que toutes les autres chapelles avaient des confréries qui veillaient à leur entretien, tandis que celle-là n'en avait point.
—Eh bien! dit le roi, puisque cette chapelle est dédiée au saint dont je porte le nom, je prends sur moi de l'embellir. En effet, dès le lendemain il commandait à son ambassadeur à Rome une chapelle digne de son saint patron, et l'ambassadeur ayant confié ce travail à Vanvitelli, qui s'en acquitta à son honneur, Benoît XIV la consacra et y offrit le saint sacrifice avant qu'elle ne fût expédiée à Lisbonne. Le roi envoya au souverain Pontife, en témoignage de sa reconnaissance, un calice d'or massif orné de brillants, de la valeur de 250,000 francs. Cette chapelle avec ses accessoires a coûté cinq millions de francs; mais le pieux monarque n'eut pas la consolation de la voir, car il se mourait lorsqu'elle arriva à Lisbonne, et ce fut son fils et successeur Joseph Ier qui, l'inaugura en 1751.
Dans le couvent attenant à cette église est établie (p. 006) l'œuvre de la Miséricorde, qui accueille les enfants trouvés et les protège jusqu'à l'âge de 18 ans. D'après le rapport de l'exercice 1881-1882, l'œuvre n'en avait pas moins de 7,617 sous sa tutelle, dont 92 dans l'établissement même et 7,525 dehors, c'est-à-dire en nourrice ou en apprentissage. L'œuvre pensionne les nourrices qui, après l'allaitement, consentent à garder les enfants, et pour les encourager à envoyer ces pauvres petits êtres à l'école, elle leur accorde des prix lorsque ceux-ci passent de bons examens. Les enfants maintenus hors de l'établissement sont assidûment surveillés, et lorsqu'ils sont malades ou bien qu'ils se déplacent, ils accourent à la Miséricorde pour se faire soigner ou placer de nouveau.
En dehors de cette œuvre principale, la Miséricorde a servi 2,880 pensions d'allaitement à des mères pauvres; elle a dépensé 20,000 francs pour aider de pauvres familles à payer leurs loyers, et 70,000 francs en secours à domicile, lesquels—observe le Rapporteur—n'ont été refusés à aucun besoin légitime. La recette totale de l'exercice a été de 1,350,000 francs et la dépense de 1,210,000, y compris 200,000 francs capitalisés. Cette belle œuvre est présidée par le comte de Rio-Maior, grand maître des cérémonies de la Cour, membre héréditaire de la Chambre des pairs.
Tous les membres, d'ailleurs, de cette noble famille de Rio-Maior, consacrent leur fortune, leur intelligence et leur activité au soulagement de toutes les infortunes.—Dom José de Saldanha, frère puîné du comte, est le président (p. 007) de l'Association catholique et le champion de la cause religieuse à la Chambre des députés: il cède son traitement aux pauvres du district qui l'a élu.—Leur sœur, Doña Theresa de Saldanha, a fondé et dirige personnellement l'Association protectrice des jeunes filles pauvres, laquelle a établi dans trois anciens monastères de religieuses, que le gouvernement lui a cédés, des écoles-asiles confiées aux Sœurs du tiers ordre de Saint-Dominique.

Château royal à Cintra.
La vénérable comtesse douairière de Rio-Maior, leur mère, est la fondatrice de l'Association de Notre-Dame Consolatrice des affligés, que malgré son grand âge elle préside encore. Cette association a créé, dans un ancien couvent de Carmélites, un asile où elle maintient vingt (p. 008) pauvres femmes aveugles, soignées par les Sœurs dominicaines. Le rapport publié au mois d'avril dernier constate que pendant l'année précédente, en dehors de l'œuvre des aveugles, l'association avait distribué à des pauvres honteux 1,312 pensions de 5 jusqu'à 50 francs par mois, qu'elle avait dépensé en outre 2,000 francs en bons alimentaires et en secours pour loyers, et que son vestiaire avait fourni des vêtements, de la literie, etc. La dépense totale a été de 27,000 francs.—Faute de temps pour visiter l'asile, j'ai dû me contenter d'une prière dans sa belle église, une de celles où l'on fait quotidiennement à tour de rôle, comme à Rome, l'exposition des quarante heures; et je pousse mon excursion jusqu'au faubourg de Bélem.

Couvent de Bélem (intérieur du cloître).
La superbe église de Sainte-Marie de Bethléem ainsi que son cloître, qui appartenait aux ermites de saint Jérôme, ont été bâtis en 1500, par le roi Emmanuel, sur l'emplacement de la petite chapelle où Vasco da Gama et ses hardis navigateurs passèrent en prières la nuit qui précéda leur départ pour la découverte des Indes. C'est un remarquable spécimen du style gothique-flamboyant. L'église renferme les tombeaux du fondateur et de plusieurs de ses successeurs, y compris le cardinal-roi Henri, qui succéda à son petit-neveu, l'infortuné Sébastien, mort en 1578, âgé de 24 ans, à la bataille d'Alcacer-Quibir, où l'armée portugaise fut complètement défaite par les Maures.—L'année dernière on a transporté en grande pompe dans ce monument les cendres du héros dont il (p. 009) rappelle l'épopée, ainsi que celles de son chantre, l'épique Camoens.

Tour de Bélem.
Après la suppression des ordres monastiques en 1834; on a installé dans le cloître la Casa Pia, asile où 550 enfants pauvres sont élevés gratuitement jusqu'à l'âge de 18 ans, moyennant la dépense annuelle de 350,000 francs.—Un peu plus loin, au bord du Tage, une tour de même style architectural était destinée à défendre le monastère contre les incursions des pirates.
Mais l'heure du départ approche; il faut regagner le bord.
Nous voilà donc redescendant le Tage et admirant ses belles rives couronnées de forts.
Le 24 se passe sans incidents; le 25 nous côtoyons les (p. 010) îles Canaries. De nombreuses hirondelles voltigent autour du navire. Le matin, je suis étonné d'en voir une dans ma cabine qui voletait contre la vitre pour recouvrer sa liberté. Après l'avoir bien caressée, je la renvoie en mer, où elle a bientôt rejoint ses compagnes. Si j'avais su qu'elle se dirigeât vers les rives de France, je l'aurais chargée d'une dépêche.
Le 26 et le 27 se passent, comme les autres jours, en lectures et en causeries.
Un mineur qui s'en va à la Plata dans les Andes, où il a des mines aux confins du Chili, vient de Paris. Il était allé proposer aux capitalistes parisiens d'entrer dans son affaire, mais il s'étonne d'abord de les trouver dans la plus complète ignorance sur les pays d'outre-mer. Ils prennent l'Amérique du Sud pour l'Amérique du Nord. Son étonnement grandit lorsqu'il les entend poser pour première condition, l'entrée en association avec 50% de l'affaire. Ainsi il fallait un million pour développer les chantiers, et on lui propose alors une société par actions au capital de quatre millions, dont un million seul sera effectif; les autres trois millions seront: un pour l'apport des mines, les deux autres pour rétribuer le capital. Là-dessus notre mineur s'en va, persuadé que dans les déserts qui entourent ses mines il ne trouvera pas de brigands plus détrousseurs.
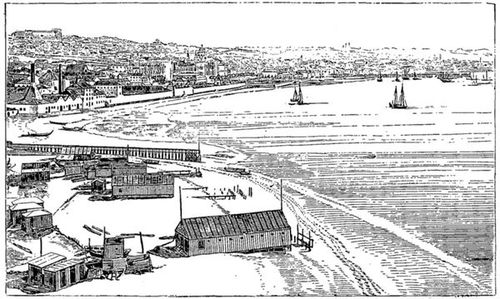
Le Tage à Bélem (Portugal).
Un officier de la marine brésilienne ne cesse de me parler de l'immensité et de la bonté de son pays. Il est du nord ou du bassin de l'Amazone: cet immense fleuve est (p. 011) maintenant sillonné par des bateaux à vapeur qui le remontent jusqu'aux confins du Pérou, mettant un mois pour faire le voyage, aller et retour. Là, comme presque partout ailleurs, c'est une Compagnie anglaise qui, sous pavillon brésilien, exploite cette navigation. L'officier dont je parle vient de faire une inspection dans les divers pays de l'Europe, dans le but d'améliorer l'armement de la flotte. Divers bébés lui sont nés durant les trois ans de sa tournée. Il revenait avec quatre; un est mort en route près de Lisbonne, les trois autres font les charmes de la maman et des passagers. Une dame basque qui s'en va rejoindre son mari dans la Pampa a aussi deux enfants bruyants qui mettent un peu de vie dans le navire. Elle raconte qu'elle ne pourrait plus se faire à la vie économe et mesquine des personnes de sa condition dans les Pyrénées. Les 10,000 moutons que possède son mari lui rapportent bon an mal an de 30 à 40 mille francs de rente, et elle peut ainsi se permettre de larges dépenses. Les officiers du navire sont à leur tour complaisants et donnent volontiers les renseignements qu'on leur demande. Voici les dimensions du Niger: 125 mètres de long, 12 de large, 15 de haut; la machine est de la force de 600 chevaux au coefficient de 300 kilogrammètres, et nous pousse avec une vitesse de 11 à 12 nœuds. Le déplacement est de 5,000 tonnes, et il porte 2,000 tonnes de marchandise outre 250 passagers de chambre et 800 d'entrepont lorsqu'il est au complet. Il fait les voyages de la Plata depuis dix ans. Son personnel compte 105 individus, dont 35 employés à (p. 012) la machine, 39 servant de domestiques, bouchers, boulangers, gardes-magasin, et le reste officiers et matelots.
Le fret, qui s'élevait jusqu'à 500 et 800 fr. la tonne pour le café, est tombé maintenant si bas que c'est à peine si l'on peut former une moyenne de 30 à 40 fr. la tonne pour les diverses marchandises; mais la subvention du gouvernement atteint environ 200,000 fr. pour chaque voyage. La Compagnie importe dans l'Amérique du Sud du vin et des objets manufacturés, et en exporte le café, le suif, les cuirs et la laine. Le plus grand nombre des passagers sont des Portugais, des Brésiliens, des Platéens, des commis-voyageurs. Un journaliste de Paris s'en va prendre part à un congrès pédagogique à Rio.—Paris fait le plus souvent le sujet de la conversation. On se raconte ce qu'on y a vu, ce qu'on y a fait. Les désœuvrés de tous les points du globe viennent y chercher les distractions, y laisser leur argent; et ils en exportent trop souvent la frivolité, si ce n'est pire. C'est ainsi que l'influence de cette capitale se fait sentir partout au loin. Combien meilleur serait le résultat, si l'on trouvait à Paris plus de sérieux que de futile!
Hier, c'était dimanche. Sans le calendrier on aurait pu l'oublier. Sur les navires anglais ou américains, un service du matin rappelle le jour du Seigneur.
Ces jours derniers nous avons rencontré peu de navires, mais aujourd'hui nous en avons devancé deux. Nous approchons de la terre d'Afrique.[Table des matières]
Sénégal.
Arrivée à Dakar. — Les nègres plongeurs. — La végétation. — Le marché. — Les fruits. — La ville. — Les cases des nègres. — L'industrie au Sénégal. — Le couscous. — Les négresses. — Une école indigène. — Le roi de Dakar. — Les Sœurs de l'Immaculée-Conception. — Les Pères du Saint-Esprit. — Les Frères de Saint-Gabriel. — Apparition de la locomotive. — Le passage de la ligne. — Les couchers du soleil.
Vers les six heures et demie du soir, nous commençons à apercevoir les deux Mammeles: rocher ainsi appelé à cause de sa forme. Le phare qui s'élève sur la pointe la plus élevée commençait à allumer ses feux. En continuant notre route, nous passons devant deux autres phares, et vers huit heures nous mouillons à Dakar. Déjà le navire avait lancé ses trois fusées pour faire connaître son arrivée, et l'agent de la santé vient à bord un peu après celui de la Compagnie et celui des postes; mais il était trop tard pour descendre à terre. On passa un peu de temps à causer avec les jeunes médecins et pharmaciens de la marine montés à bord, et je gagnai ma couchette de bonne heure pour en sortir de grand matin.
En effet, le lendemain, dès cinq heures, les nègres, grands et petits, faisaient vacarme autour du navire. (p. 014) Ils manœuvraient avec des palettes de petits canots rustiques formés d'un tronc d'arbre creusé. Je mets ma tête à la fenêtre et ils me crient: Papa, un sou! dis donc dou sou à moi! et cette chanson se répète comme un écho de canot en canot. Je jette un double sou dans l'eau, et immédiatement une douzaine plongent et se l'arrachent avant qu'il atteigne le fond; un d'eux arrive triomphant, le portant entre ses dents. Cette scène se renouvelle toute la matinée, car bien des passagers aiment à voir ainsi plonger ces pauvres nègres, au risque de les voir enlever par les requins.
Arrivé à terre, un bon employé répond à mes nombreuses questions sur le pays, et m'accompagne à la poste, puis à l'église, et enfin chez les Pères du Saint-Esprit. Le Père supérieur me confie à un jeune missionnaire alsacien qui parle le langage des nègres et veut bien se faire mon cicérone.

Vue de Dakar (Sénégal).
La sécheresse rend la végétation languissante. Le sol est de sable ou d'une roche ferrugineuse. Je vois bon nombre de plantes que j'avais trouvées dans l'Hindoustan: l'acacia flamboyant aux magnifiques fleurs rouges, le mango, le cocotier, le lanthana, diverses sortes d'acacias et le banhian ou ficus, mais il est loin d'atteindre les dimensions de ses congénères de l'Inde. Le géant des arbres d'ici est le baobab: il y en a un près du débarcadère dont le pied a au moins deux mètres et demi de diamètre: il produit un fruit de la grosseur et de la couleur d'un gros rat. J'en ai vus qu'on aurait dit couverts de (p. 015) rats d'eau suspendus par la queue. Les indigènes mangent ce fruit aigrelet. Le singe en est gourmand, ce qui lui a fait donner le nom de pain des singes. La grande place de Dakar est plantée de ficus. Sur le tronc de quelques-uns une grande affiche porte en grosses lettres: Conversion de la rente 5%: le gouvernement ose-t-il donc parler de conversion aux nègres!

Type de Femme du Sénégal.
Mon excellent cicérone me conduit au marché; chemin faisant nous rencontrons partout de gentils lézards à robe grise et à tête blanche qui nous regardent avec curiosité, sans paraître effrayés: on les dit inoffensifs. Au marché, je vois une centaine de femmes accroupies à terre, vendant des légumes et fruits divers. Elles les tiennent dans d'immenses moitiés de courges dont la contenance varie de 1 à 40 litres. Elles vendent aussi du mil, du couscous, du poisson, de la viande et (p. 016) des poules. Les enfants de toute taille grouillent nus ou à peu près à leurs côtés, mais les plus petits sont enveloppés et attachés sur le dos des mamans, à la mode japonaise. Or, sous ce soleil de feu, la méthode est dangereuse, car plusieurs enfants, à force de regarder le soleil avec leur tête à la renverse, ont les paupières brûlées. Ceci explique le grand nombre d'aveugles qu'on trouve dans le pays. J'achète quelques fruits: le nevo, espèce de pomme douce-amère, dont le goût rappelle la patate; le ditach, qu'on suce et dont le noyau brûlé répand un doux parfum; le cola, qui vient des côtes de Guinée et qu'on me vend très cher. Les naturels prétendent qu'il suffît d'en manger un pour être affranchi de la faim durant 24 heures: j'en ai fait l'essai, mais il n'a pas réussi; l'estomac des blancs n'est pas celui des nègres. Si l'essai avait réussi, j'aurais pu en acheter une grande provision, et, malgré le prix de 15 centimes pièce, réaliser encore une grande économie. J'ai vu aussi le popaya, mais il n'était pas mûr.
Les maisons de Dakar ne sont pas nombreuses. À part les édifices du gouvernement, on ne voit que quelques maisons de commerçants et quelques baraques pour les ouvriers et employés du chemin de fer. Des maisons privées, quelques-unes imitent le genre anglais avec vérandah: elles ne sont pas assez entourées de verdure. Le plus grand nombre des constructions européennes se trouve dans l'île de Gorée, qui fait face à Dakar.
Ma curiosité me portait de préférence vers les cases (p. 017) des indigènes. Elles sont nombreuses, car il y a ici dix à douze mille nègres. Le bon missionnaire m'en fait visiter un grand nombre. Il allait partout, rien ne l'arrêtait, et partout il était bien accueilli. Les enfants le suivaient en criant: abba pinou, abba pinou: ils demandaient des épingles. C'est en leur en donnant que le Père en rassemble quelquefois un grand nombre et les conduit chez lui, où il leur fait le catéchisme. Ces épingles leur servent pour tirer les épines des pieds, car ils vont pieds nus.
Tous ces nègres sont musulmans, mais ils aiment les Pères, qui les traitent bien, les visitent et les secourent s'ils sont malades.
Les cases sont disposées par groupes de huit à dix. Elles entourent une petite cour commune. À l'un des coins de la cour on voit un rond de pierre qui sert de temple: c'est là que les familles, en se prosternant vers l'orient, viennent réciter leur Coran et faire la prière. Ces cases se ressemblent toutes; elles sont rondes ou carrées et couvertes en chaume ou herbe analogue. Les parois sont en roseau tressé: elles couvrent un espace de 10 à 20 mètres carrés, et ont souvent deux pièces; une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Elles ont une légère porte en bois. Les riches commencent à se donner le luxe de cases en planche couvertes en tuiles plates de Marseille, ou en zinc. Le mobilier est fort simple: un lit de planches, quelques courges pour les liquides et les légumes, un filet pour la pêche, une caisse pour fermer les vêtements et objets précieux lorsqu'il y en a, une marmite (p. 018) pour cuire le couscous, un tamis, un mortier et pilon en bois, et un grand nombre d'amulettes ou cri-cri. Ils consistent en ceintures, en queues, mais le plus souvent en gros ou petits scapulaires de cuir ou d'étoffe, renfermant des versets du Coran, avec certaines substances cabalistiques: graines de fruits, fiente de vache, etc. Il y en a qui doivent préserver des balles, d'autres des cornes de bœufs; il y en a contre la petite vérole, contre la fièvre, contre la médisance et la calomnie et contre tous les autres maux qui affligent les nègres comme le reste des hommes. Les marabouts ou prêtres indigènes, qui ont seuls le pouvoir de faire ces cri-cri, les vendent fort cher à leurs ouailles crédules. Ils viennent d'en inventer un contre les locomotives qu'ils vendent plus cher que les autres. La locomotive en effet vient de faire ici sa première apparition, et il fallait être préservé de ce diable nouveau.
J'ai voulu acheter quelques-uns de ces cri-cri, mais on s'est toujours refusé à me les vendre. Le Père en a pris un paquet de la main d'un nègre, et me les a montrés. Il y en a ici pour 500 fr., me dit-il, c'est au moins ce qu'ont payé ces braves gens: or, cela ne valait pas, cuir compris, la somme de 2 fr.
Le Père m'a fait observer les divers procédés par lesquels on forme le couscous. Les longs épis du mil portés de l'intérieur sont conservés dans des greniers ronds, en forme de tonneaux ou petites cases, à côté de la case habitée. On en sépare la graine pour la piler dans un grand mortier de bois: c'est le travail des femmes, et elles y (p. 019) consacrent leur matinée, comme les femmes arabes, en Orient, qui broyent chaque matin le blé entre deux pierres. La farine est tamisée, puis aspergée d'eau pour la réduire en fines boulettes, le tout placé contre les parois d'un plat de bois dont le fond est percé de plusieurs trous. Ce plat est posé sur une marmite d'eau bouillante, et la vapeur qui s'en dégage, passant à travers les trous, cuit le couscous. Les nègres y mélangent parfois de petits morceaux de viande ou de poisson et mangent le tout avec les doigts, comme les Hindous: c'est la fourchette du grand'père Adam. Nos pères n'en connaissaient pas d'autre jusqu'au temps de François Ier. Les Chinois, plus habiles, avaient depuis longtemps trouvé les bâtonnets.
J'ai visité la case d'un forgeron. Deux peaux de chèvres formaient la forge. Ouvertes par le haut, elles aboutissaient en bas à un canon de fer qui arrivait jusqu'au charbon de bois. Le forgeron relevait une peau qui se remplissait ainsi de vent, puis, avec la main, serrait les deux bois du bord qui, en se rapprochant, fermaient l'ouverture, et poussant en bas, l'air s'en allait sur le feu. À mesure qu'il baissait l'une, il relevait l'autre, et le jet était ainsi continu. Le métal rougi était battu sur une petite enclume. Ce forgeron, avec des pièces de 5 francs et des napoléons d'or, faisait les jolis bracelets, colliers et pendants d'oreille qui ornent le cou, les bras et les oreilles des femmes du pays. J'ai voulu acheter quelques bijoux, mais il n'y en avait point de prêt. Donnez-moi deux pièces (p. 020) de 5 francs, me dit le nègre, et je vais vous les transformer en deux bracelets.

Type de Femme du Sénégal.
J'ai visité aussi la case d'un tisserand. Il avait installé son métier dans la cour, au milieu de son groupe de cases. La trame était attachée au loin au pied d'un arbre, et aboutissait de l'autre côté aux mains du tisserand. Celui-ci, assis à terre, avait creusé un trou dans lequel il enfonçait ses jambes; chacun de ses pieds pesait sur un bâton qui faisait bascule à un piquet, et en baissant alternativement l'un et l'autre, il croisait la trame sur le fil qu'il passait à la navette. Il n'y a pas de désert où un semblable métier ne puisse être monté en peu de temps.
Dans quelques cases on faisait des nattes; dans d'autres, des cordes de palmier. Plusieurs se reposaient sur leurs lits, pendant que les femmes soignaient les (p. 021) bébés. L'amour maternel m'a paru partout en honneur.
Il est d'usage de faire visite à l'ancien roi de Dakar. Sa case est un peu plus grande que les autres. Il n'était pas présent, mais ses cinq femmes nous ont reçus volontiers, et nous ont tendu la main pour avoir quelques pièces de monnaie.
Dans quelques cases j'ai vu des miroirs, une petite commode, une ombrelle et même des sommiers. Parfois, de jolis burnous en drap et soie galonnés d'or pendaient aux parois: c'est l'habit de fête. Les femmes sont artistement drapées dans des étoffes blanches et légères. Elles portent un foulard en guise de turban: on les prendrait pour des reines de Saba. Elles ornent d'or et d'argent leurs bras, leur cou et leurs oreilles. Leur chevelure est divisée en un grand nombre de petits flocons ressemblant à de petites tresses; on les obtient en entourant un petit jonc avec une mèche de leurs cheveux crépus; le jonc enlevé, le flocon pend uni et gracieux.
Dans une case je remarque un instrument de musique. Il consiste en un parchemin tendu sur un rameau creusé, allongé d'un bâton à l'un des bouts. Quatre cordes tendues et pincées en guise de luth donnaient des sons harmonieux. J'ai voulu l'acheter, mais on m'en a demandé 100 fr. Sans doute, c'était le prix d'affection. J'ai voulu aussi acheter un sabre recourbé, dont le fourreau en cuir rouge travaillé était d'un bel effet: on m'en a demandé 50 fr, j'en ai offert 20. La femme qui le tenait m'a répondu: «Si mon mari était là, il vous le donnerait; (p. 022) mais si je vous le donnais moi, je m'exposerais, à son retour, à recevoir des coups.»
Dans une autre case, j'ai trouvé une bonne vieille étendue sur son lit. Je lui ai demandé son âge, et voici sa réponse: «Lorsque les Anglais étaient ici, j'étais petite fille.» Elle doit avoir quatre-vingt-dix ans. Dans plusieurs cases, on me demandait si en France j'étais marabout, et lorsque je répondais affirmativement, on me faisait un grand salut.
En parcourant les petites ruelles qui séparent les groupes de cases, j'ai entendu un grand bruit de voix enfantines, et je suis arrivé jusqu'à lui. C'était une école indigène. Les enfants s'exerçaient à écrire, sur des planchettes de bois, les versets du Coran qu'ils apprenaient par cœur sur une cantilène monotone. Les tablettes lavées et séchées servaient à écrire une nouvelle page. J'ai encore demandé à acheter une de ces tablettes, mais sans succès.
L'instruction est donnée par les marabouts. Ceux-ci ont pour rétribution les dons que recueillent les enfants en allant quêter chaque matin auprès des familles.
Les marabouts rendent aussi la justice, et les nègres qui auraient recours aux juges européens, seraient mis au ban comme infidèles.
Après la visite aux indigènes, nous arrivons aux écoles catholiques. Les Frères de Saint-Gabriel, au nombre de trois, instruisent environ quarante négrillons externes. Leur établissement était en réparation; la fourmi blanche (p. 023) avait rongé presque toutes les boiseries. Les Sœurs de l'Immaculée-Conception de Castres ont cinquante négresses de tout âge et internes. Elles leur apprennent les métiers habituels aux femmes. Comme presque partout dans les missions, elles ont une pharmacie, et tous les matins bon nombre d'indigènes malades viennent leur demander des remèdes. Deux Sœurs visitent aussi à domicile les malades qui ne peuvent venir jusqu'à la pharmacie; rien d'étonnant que les nègres aiment les Sœurs.
Une cinquantaine de kilomètres de chemin de fer est déjà achevée. Les 200 kilomètres qui manquent encore pour unir Dakar à Saint-Louis, capitale de notre colonie, le seront avant la fin de l'année. On a dû importer des Piémontais pour ce travail; et quoique venus de leurs glaciers des Alpes, ils travaillent ici sous le soleil brûlant au prix de 60 centimes l'heure. Là où il y a un rude travail à faire, sur tous les points du globe, on est à peu près sûr d'y trouver des Piémontais.
Rentré au navire, je suis avec intérêt une discussion du capitaine avec un Parisien à propos de l'industrie parisienne. Le capitaine, en homme pratique qui a vu le monde et ce qui s'y passe, s'efforçait de faire comprendre à son interlocuteur que, si on n'y mettait bon ordre en faisant disparaître des exagérations déraisonnables, bientôt plusieurs branches de l'industrie seraient supplantées par les étrangers; mais il n'arrivait pas à convaincre son adversaire, et il finit par lui dire: «On voit que vous parlez comme un Parisien qui n'a vu que Paris (p. 024) et qui en est encore à croire que Paris est le nec plus ultra de la perfection du monde!»
À deux heures et demie, nous levons l'ancre et nous passons à côté de quelques navires qui viennent ici chercher l'arrachide, pistache oléagineuse qu'on récolte à l'intérieur. Son prix est actuellement de 30 fr. les 100 kilog. Les mêmes navires apportent en échange des cotonnades et des liqueurs. Nous voilà encore une fois en route, et cette fois nous allons bien à l'Équateur, car la chaleur devient tous les jours de plus en plus intense.
La traversée a continué dans de bonnes conditions; près d'atteindre l'Équateur, nous avons eu temps sombre et pluie. C'est le 2 juin, vers onze heures du matin, que nous avons passé la ligne; l'ancienne habitude de baptiser ceux qui la passent pour la première fois a disparu.
Le coucher et le lever du soleil sont ordinairement fort beaux dans l'Océan: mais ici je les trouve singulièrement bizarres. Avant-hier, le soleil en se couchant peignait couleur de feu d'innombrables nuages qui prenaient toutes les formes d'animaux les plus divers; puis, un peu plus tard, lorsqu'à la teinte rouge succéda la teinte grise, on pouvait voir une quantité d'îles, de montagnes, de golfes, de presqu'îles avec phares: l'imitation était complète.[Table des matières]
Le Brésil.
Olinda. — Pernambuco. — Le débarquement. — La ville. — Les monuments. — Les institutions de charité. — Le marché. — Les environs. — Bahïa. — La ville. — Le couvent de Sn-Bento. — Les établissements charitables. — La baie de Rio-de-Janeiro. — Le Brésil. — Forme de gouvernement. — Budget. — Armée. — Marine. — Produits. — Importation. — Exportation. — Immigration. — La monnaie. — La ville de Rio. — Ses faubourgs. — Nicteroy. — L'hôtel Moreau. — Fleurs et fruits. — La Tijuca. — Le musée. — Réception de l'Empereur et de l'Impératrice.
Le 4 juin dès le matin, nous apercevons des terres basses, puis des collines couronnées par de superbes cocotiers. Vers dix heures, les grands couvents d'Olinda, l'ancienne Pernambuco, sont devant nous.—Lorsque les premiers Portugais aperçurent le charmant mamelon baigné par la mer et couvert d'une si belle végétation où s'élève maintenant Olinda, ils s'écrièrent: O linda situaçao para edificar una cidade. O le bel emplacement pour bâtir une ville; et le nom d'Olinda est resté à la ville aujourd'hui éclipsée par sa voisine Pernambuco. L'étymologie de ce dernier nom remonte aussi à son fondateur Fernand. Buco en portugais signifie bateau; les indigènes appelèrent Fernambuco l'endroit où Fernand arrêta ses navires, et les Hollandais qui conquirent ensuite et tinrent (p. 026) pour un temps ces possessions, transformèrent le nom en Pernambuco.
Une jangada passe si près du navire que l'escalier du bord faillit en déchirer la voile. On appelle ainsi une sorte de radeau composé de plusieurs poutres reliées ensemble et portant une voile tendue au vent. Les hommes qui la manœuvrent sont inondés par les vagues; ils ont un gouvernail, une rame, une ancre, et attachent leurs provisions au haut d'une perche. Ils placent à une certaine hauteur une petite cabane couverte en natte pour y passer la nuit. La mer est si houleuse dans ces parages que ces barques insubmersibles sont de toute nécessité.
À midi et demi nous sommes devant la ville parsemée de nombreux clochers et de hautes coupoles. Le navire stoppe au large à un demi-kilomètre. La mer est relativement calme, mais bientôt nous voyons combien le débarquement est difficile. Chaque pirogue a six rameurs nègres aux muscles solides, et un pilote pour la barre: elles dansent au pied de l'escalier, s'élevant ou s'abaissant alternativement à la hauteur ou profondeur de plusieurs mètres. L'habileté consiste à choisir le moment propice pour enjamber. N'ayant pas pris assez de précautions, ou plutôt n'ayant pas attendu pour observer comment allaient s'y prendre les habitués, je passai le premier dans la barque, mais je posai le pied au moment où elle s'enfonçait violemment; mon pied porte à faux, et tombant sur une jambe au bord de la barque, je roule dans son fond, brisant un parapluie. Un instant après, la (p. 027) jambe est fortement enflée, mais la douleur diminue et je peux continuer l'excursion.
En voyant la force que déployent les rameurs nous revenons sur notre première opinion, et concevons que les 40 fr. qu'on nous a demandés pour le débarquement et le réembarquement sont bien gagnés. Après avoir été ballottés durant vingt minutes, nous passons la barre et entrons dans le port. Celui-ci est formé par une jetée en pierre et brique que les vagues battent avec violence en la dépassant souvent. Nous défilons devant la Médusa, bateau sur lequel est installée la douane; et peu après nous sommes sur les quais. La ville, qui compte une population d'environ 100,000 habitants, a l'aspect d'une ville portugaise: rues assez étroites, maisons peinturlurées et balcons gracieux. Les tramways ou bonds, comme on les appelle ici, circulent partout, tirés par de vaillantes mules. Je prends le premier venu, et chemin faisant je me renseigne sur les curiosités à voir.
Je descends bientôt pour visiter l'hospice des enfants trouvés confié aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul. La bonne supérieure, qui est Française, me fait parcourir tout l'établissement. Les dortoirs sont sous le toit, mais celui-ci, formé de tuiles plates, sans plafond, protège contre le soleil: il est superflu ici de se précautionner contre le froid. La maison contient environ 250 filles de tout âge: la plupart sont négresses ou mulâtresses. Elles sont recueillies dans un Tour et ensuite placées en nourrice à la campagne. Lorsqu'elles retournent à l'établissement, (p. 028) elles y sont instruites dans l'écriture, lecture, calcul et tenue du ménage. Arrivées à l'âge convenable, on les marie, et on leur donne une dot de 500 fr. avec un trousseau d'égale somme. Ce système m'a paru plus pratique que celui de nos orphelinats d'Europe, où les jeunes filles sont placées comme bonnes d'enfant, couturières ou cuisinières', et par là vouées presque au célibat forcé au milieu d'innombrables dangers. J'aurais voulu visiter encore un collège que les Sœurs ont à la campagne, et dans lequel elles instruisent plus de 200 jeunes filles de la bourgeoisie; un orphelinat avec 200 orphelins qu'elles dirigent à Olinda, et l'hôpital Pedro II où dix-sept Sœurs soignent 400 malades; mais le temps était court. À quatre heures nous avions rendez-vous sur les quais pour rentrer au bateau, qui repart dans la soirée. Je me décidai donc à visiter la plus belle des églises de Pernambuco, celle de la Peigne, de parcourir la ville et de faire en tramway une excursion à la campagne au quartier de la Maddalena, le plus pittoresque des environs. Avant tout je rends visite à un avocat mon confrère qui me reçoit dans son bureau avec beaucoup de bonté et me fournit plusieurs renseignements sur le pays et sur les œuvres de charité. Je remarquai le peu de luxe de l'installation; le bureau était situé au 1er andar ou 1er étage: on y avait accès par un magasin et en grimpant sur une échelle de bois assez dangereuse.

Brésil (Pernambuco): Négresses vendant des fruits.
À la Peigne j'ai trouvé des capucins italiens qui ont édifié là un véritable monument, à grands frais. L'église (p. 029) est surmontée d'une grande coupole et les bas côtés sont soutenus par huit colonnes en marbre rouge, taillé dans les carrières de Vérone. Les cinq autels, en marbre blanc, viennent aussi d'Italie, et les magnifiques mosaïques qui ornent la façade sortent des ateliers de Venise.
Non loin de l'église se trouve le marché. Les voitures le traversent comme aux Halles centrales de Paris. À côté des tomates et des oranges, je remarque les bananes, les ananas, les mangos et autres fruits et légumes des pays tropicaux. Les vendeurs ou vendeuses sont presque tous nègres ou mulâtres. Enfin le temps s'avance et je m'empresse d'enjamber le tramway de la Maddalena. Nous traversons sur de longs ponts tubulaires plusieurs bras d'eau, et parcourons la campagne parsemée de jolies villas. Elles sont de tous les styles, depuis l'arabe fantastique jusqu'à l'italien régulier. Les jardins qui les ornent sont ravissants: les cocotiers, les palmiers géants élèvent aux nues leurs verts plumets; les arbres et arbustes fleuris occupent le second plan, et les lianes s'entrecroisent gracieusement. Il me semblait être à Bandora, dans les environs de Bombay. C'est bien à regret que je quitte ces lieux enchanteurs pour regagner le bateau.
Après deux jours d'une navigation paisible, par une température de 30° centigrades, le 6 juin, à sept heures du matin, nous entrons dans la magnifique rade de Bahïa. Elle est vaste et pittoresque. À droite, la ville perchée sur des collines, au milieu des plumets de gigantesques palmiers; à gauche, quelques îles verdoyantes; en face, une (p. 030) presqu'île que domine le palais somptueux de l'Hospice de mendicité. Plusieurs navires sont à l'ancre, entre autre la Reliance de la Unite State's mail, qui a depuis sombré dans un naufrage, et une quantité de barques couvertes de nattes, probablement maisons flottantes de familles nègres. Après la visite de la douane et de la santé, je descends à terre et me rends à la poste. Le directeur, don Macedo Costa, pour lequel j'avais une lettre, me reçoit avec bonté. Près de là, j'entre dans un ascenseur public, et en quelques minutes je me trouve en haut de la ville, sur la place du gouvernement. À droite, on me montre le palais du gouverneur; à gauche le palais de ville, et, en face, la Chambre des députés de la province.
Je continue ma route, et dix minutes après j'entre dans l'église de San-Bento. Une assemblée de noirs assistait à un service commémoratif. Sous la coupole, devant un tapis noir orné d'une croix étendue à terre, le prêtre récitait les prières des morts. Je passe au couvent contigu, je parcours de longs corridors, monte plusieurs escaliers, et après avoir traversé de vastes salons dont la vue domine la ville, j'arrive à la cellule du Padre Mestre Géral. Il me reçoit poliment, et nous parlons de son frère qui habite Paris. Il me fait accompagner chez un autre de ses frères, professeur de pathologie à la faculté de médecine, et chez les Pères lazaristes à Campo do Polvera.
Je parcours encore une fois le couvent. Ce vaste établissement, qui pourrait loger au moins une centaine de (p. 031) moines, en contient actuellement huit, et les jardins sont incultes. On me dit qu'il en est de même des autres nombreux couvents de Bahïa et du Brésil en général. Il en est de ces institutions comme des hommes: elles dégénèrent et meurent, puis renaissent.
Mon conducteur me mène à travers un labyrinthe de rues plus ou moins sales, elles sont bordées de vieilles maisons peintes en jaune, en bleu, en rouge, à la mode génoise. Le terrain est inégal: on monte des mamelons et descend des vallées. Partout les vaillantes mules tirent les bonds ou tramways; je remarque une population nombreuse, noire ou mulâtre, presque pas de blancs. À la fin, ruisselant de transpiration sous un soleil de feu, j'arrive au Campo do Polvere chez les Pères lazaristes. Le P. Sagnet en est le supérieur. Il me retient à déjeuner et me propose la visite des établissements tenus par les Sœurs de Charité. C'est toujours avec plaisir que je vois à l'étranger les établissements dirigés par nos compatriotes.
À peu de distance de l'habitation des Pères, nous trouvons l'asile dos Espostos. Il contient 215 petites filles. Comme à Pernambuco, l'administration les marie lorsqu'elles ont l'âge voulu, et remet à chacune une dot de 1,000 fr. avec un trousseau de 250 fr. Cet établissement contient aussi 68 garçons qu'on envoie travailler dans les ateliers de la ville: on les place au dehors vers l'âge de 12 à 14 ans. Les Sœurs tiennent là aussi une école externe qui réunit une centaine d'élèves. C'est beaucoup pour (p. 032) une maîtresse. C'était l'heure du dîner, le plus grand nombre étaient rentrées chez elles, mais une trentaine dînaient en classe avec les petites provisions portées dans un panier.
Le jardin de l'établissement est vaste et bien tenu: des mangoes séculaires y font une ombre bienfaisante. Un jacquier colossal les domine tous; de gros fruits pendent de ses branches noirâtres. Je remarque là le fruit abiu (le caki du Japon); le pigna ou frutto de Conde (la Buonana des Malais); le sobaia, espèce de nèfle; le popaja, arbre à pain, le grand éventail ou arbre du voyageur, et une quantité de plantes à feuilles rouges et à fleurs variées.
Dans une cour, j'admire une vigne couverte de grappes près de mûrir. Si on voulait se donner la peine de la cultiver en grand, on pourrait bientôt se passer du vin de l'Europe. La nourriture est bonne et abondante, elle se compose de soupe, viande, haricots de diverses couleurs, pommes de terre venues de France, de farine de manioc.
Dans un autre quartier de la ville, le jeune P. Morre me conduit à la visite de l'établissement dont il est aumônier. Les Sœurs y instruisent environ 200 jeunes filles internes appartenant à la bourgeoisie, et une quarantaine d'orphelines. Elles construisent une belle église gothique, la première de ce style qu'on voit au Brésil.

Brésil: Entrée de Rio-de-Janeiro.—Pain de Sucre.
Les élèves nous montrent les dentelles, les broderies, les fleurs artificielles confectionnées par elles, et nous (p. 033) prenons congé des bonnes Sœurs toujours heureuses de voir des compatriotes.
Un peu plus loin nous parcourons les salles d'un autre orphelinat que dirigent aussi les Sœurs et visitons la vieille église des Pères jésuites. Comme toutes celles de l'Ordre, elle est à peu près copiée sur Saint-Ignace de Rome, et surchargée de sculptures et dorures. De la sacristie on domine la rade, et l'on jouit d'un des plus beaux panoramas du monde. Le bon chanoine portugais qui avait eu la bonté de me faire ouvrir l'église (car ici elles sont fermées durant le jour) a fait ses études à Rome et a de la fortune; il peut ainsi se livrer aux œuvres de dévouement non rétribuées.
Mais l'heure avance, et malgré mon désir de visiter l'hôpital et l'école de médecine, je dois y renoncer pour gagner le Niger.
Personne n'a pu me dire le chiffre exact de la population de Bahïa. Les uns prononçaient le chiffre de 100,000, d'autres indiquaient le chiffre de 200,000 et plus. Il n'y a pas d'état civil ici, et lorsque le gouvernement ordonne un recensement, les gens fuient ou se cachent. On cache surtout les garçons pour les soustraire au service militaire.
Je n'ai pu me procurer ni ordo, ni un indicateur de chemin de fer; ces sortes de documents sont inconnus dans le pays.
On m'avait parlé de la beauté des environs et surtout des quartiers de Barra et de Rivermet; mais ces excursions (p. 034) demandaient plus de temps que je n'en avais devant moi, et je dus y renoncer.
Dans l'intérieur, la population est bonne. Le P. Morre me disait que dans les missions qu'il va prêcher de temps en temps, 15 à 18,000 âmes sont souvent réunies, et il est alors obligé de leur prêcher sous la voûte du ciel. Les principaux produits sont le tabac, la canne à sucre et la racine de manioc qu'on nous porte en Europe sous forme de tapioca.
À quatre heures et demie le navire américain lève l'ancre; un quart d'heure après le Niger le suit.
7 juin.—La nuit a été mauvaise, pluie, mer en fureur, inondation des cabines. Aujourd'hui le mauvais temps continue, et on a dû stopper durant une heure pour réparation à la machine. On a peuplé le navire de perroquets; la plupart sont à plumage vert, ailes rouges, bec noir, et ne cessent de bavarder. Quelques-uns sont extraordinairement gros et rouges avec queue très longue; ceux-ci, incomparablement plus jolis, ne parlent pas; la nature partage ses dons. On a aussi embarqué bon nombre d'ouistiti, charmant petit singe de la grosseur d'un écureuil.
Le lendemain, la navigation est encore pénible. Le 9 juin, à sept heures du matin, nous apercevons la côte hérissée de montagnes plus ou moins coniques. À neuf heures, on nous montre au loin un profil de montagnes ressemblant à la tête de Louis XVI, couché sur son dos. À midi, nous entrons dans la rade de Rio-Janeiro. Elle (p. 035) est vaste et gracieuse, parsemée d'îles, et garnie de navires. De nombreuses chaloupes à vapeur entourent le Niger. C'est la santé, la douane et les parents et amis qui viennent chercher les amis et les parents. Il est toujours touchant de voir ces scènes de famille après une longue absence; mais ici touchant est d'autant plus le mot que les Brésiliens, comme les Portugais, s'embrassent en se tapant simplement de la main sur le dos. Ils ne baisent pas comme les Français et ne secouent pas la main comme les Anglais. À deux heures une baleinière me dépose à la place du Palais, d'où je gagne l'Hôtel de France. Ma première visite est pour le banquier, ma seconde à la poste.
De Bordeaux à Rio, nous avons eu 20 jours de navigation. À table, nous n'avons jamais vu ce que les marins appellent les violons: cordes tendues pour retenir les plats et les bouteilles. Nous arrivons à Rio en plein hiver; tout le monde y est vêtu de noir. La chaleur est pourtant aussi forte que chez nous au mois d'août. La fièvre jaune n'a pas encore entièrement disparu.
Le Brésil a une surface de 8,352,000 kilomètres carrés, la France n'en a que 530,000, et 1,027,000 avec ses colonies. L'Angleterre, avec ses colonies, possède 22,418,400 kilomètres carrés; la Russie, 21,745,000. La Chine a 11,500,000 kilomètres carrés, les États-Unis de l'Amérique du nord 9,333,000; en sorte que le Brésil est le cinquième de tous les États du monde quant à la surface. Il confine au nord avec le Venezuela et la Guyane (p. 036) française, à l'est avec l'Atlantique, à l'ouest avec le Pérou et la Bolivie, au sud avec le Paraguay, l'Uruguay et la Confédération argentine. Il est divisé en 20 provinces, et sa population est évaluée à 10 ou 12 millions d'habitants, parmi lesquels 1,300,000 encore esclaves. Il y a, en plus, 500,000 Indiens ou indigènes dans l'intérieur. La forme du gouvernement est une monarchie constitutionnelle avec un empereur et deux Chambres électives. Le trône est héréditaire sans exclusion des filles. L'empereur actuel n'ayant point de garçons, aura pour héritière sa fille aînée, mariée au comte d'Eu d'Orléans, fils du duc de Nemours.
C'est en 1822 que don Pedro I de Bragance (don Pedro IV de Portugal), régent du Brésil pour son père Jean VI, d'accord avec celui-ci, proclama l'indépendance de la colonie. En 1826, il hérita de la couronne de Portugal, et y renonça en faveur de sa fille aînée, doña Maria II, mère du roi actuel.
Il mourut régent du Portugal en 1834, après avoir abdiqué en 1831 la couronne du Brésil en faveur de son fils don Pedro II, alors âgé de 6 ans et empereur actuellement régnant. Il a été couronné à sa majorité, à 16 ans, le 18 juillet 1841, et marié le 4 septembre 1841 à Teresa-Christina-Maria, née le 14 mars 1822, à Naples, et fille de François I, roi des Deux-Siciles. L'héritière présomptive, doña Isabella-Cristina, est née le 29 juillet 1846. La constitution de 1824, modifiée en 1834, en 1840, et sans cesse améliorée, est très libérale.
(p. 037) L'empereur exerce le pouvoir législatif avec le concours de deux Chambres: le Sénat et la Chambre des députés. Les sénateurs, actuellement au nombre de 57, sont nommés à vie par l'empereur sur une liste triple votée par les électeurs. Les députés, au nombre de 122, répartis par province, selon le chiffre de la population, sont, depuis deux ans, élus pour trois ans au scrutin direct. Sont électeurs et éligibles ceux qui, sachant lire et écrire, paient une contribution de 12,000 reis (25 fr. environ) ou justifient d'un petit revenu de 200,000 reis (400 fr.). La législature actuelle est la dix-huitième; elle a commencé avec la nouvelle loi électorale en 1882 et finira en 1885.
Le revenu de l'État est d'environ 250,000,000 de francs. La dépense excède la recette de plusieurs millions. La dette atteint près de 2 milliards, dont le quart a été occasionné par la guerre du Paraguay.
Il n'y a pas d'impôt foncier: le revenu principal provient des droits de douane à l'entrée et à la sortie. L'importation atteint le chiffre d'un demi-milliard de francs, l'exportation le dépasse de quelques millions.
Les principaux produits sont: le café, le sucre, le coton, le maté, espèce de thé consommé dans la république argentine; le caoutchouc, l'or, le diamant, les drogueries et matières médicinales, les peaux et le suif.
L'armée compte environ 13,000 hommes, et la flotte comprend, entre gros et petits, 52 navires, dont 4 cuirassés. Ils portent ensemble 118 canons, jaugent 26,071 (p. 038) tonnes, disposent de la force de 26,140 chevaux; le tout dirigé par 215 officiers et environ 2,000 matelots. Les gros navires sont construits en Angleterre. On y achève en ce moment un nouveau cuirassé: le Riachuelo. Les petits navires sont construits au Brésil, dans les divers arsenaux de Corte, Bahïa, Pernambuco, Para, Mattogrosso. Le matériel de guerre est fourni par la maison Krupp. Le budget annuel de la marine s'élève à environ 12,000,000,000 de reis, soit environ 25,000,000 de francs. Les villes principales sont Rio-de-Janeiro, Bahïa et Pernambuco. De ces deux dernières j'ai déjà parlé, me voici à Rio-de-Janeiro. Son nom, traduit en français, signifie «fleuve de janvier.» Les Portugais arrivèrent ici en janvier, et prenant la baie pour l'entrée d'un fleuve, nommèrent l'endroit Rio-de-Janeiro, et ce premier nom est resté.
La vieille ville, bâtie sur une langue de terre basse qui s'avance dans la baie, ressemble à toutes les villes portugaises. Les rues sont étroites et mal pavées. La rue la plus fréquentée, celle d'Ouvidor, qu'à Rome on appellerait le Corso, n'a guère plus de 6 à 7 mètres de largeur. De nombreuses églises élèvent leurs dômes et leurs clochers, mais elles sont presque toujours fermées. Il y a peu de vespasiennes, et comme la chaleur du climat invite à boire, le peuple fait de la ville une vespasienne générale. Or, cela n'augmente pas la salubrité. Il me semblait être débarqué dans une ville chinoise; le mouchoir bien garni d'eau de Cologne n'est pas de trop. C'est pourtant dans cette partie de la ville que se trouvent les (p. 039) banques, la poste, la douane, les principaux magasins, et que se font les affaires. C'est aussi dans cette partie que la fièvre jaune a élu son quartier général. Mais si on pousse jusqu'aux faubourgs, à Butafogo, Ingenio nuovo, c'est autre chose. Là, de gentilles maisonnettes entourées de jardins sont d'agréables et saines demeures; toutefois, la forme chalet qu'ont généralement ces maisons peut bien convenir aux montagnes de la Suisse, la plupart du temps couvertes de neige, mais me paraît peu adaptée à un climat qui ignore la neige et qui est brûlant même en hiver. Garnir les maisons de portiques et de vérandas garantirait les murs des rayons du soleil et rendrait les chambres plus fraîches. Les portiques sont aussi fort commodes pour s'y délasser le matin et le soir. Le tout devrait être caché dans un bouquet de verdure. La chose n'est pas difficile avec la luxuriante végétation de ces lieux. Tel est le système qu'ont adopté les Anglais aux Indes et dans l'Extrême-Orient pour se défendre d'une chaleur analogue. L'étranger qui n'y est pas encore habitué remarque aussi le grand nombre de degrés dans la couleur de la peau des habitants, depuis le noir du nègre jusqu'au blond et au blanc de l'Européen. Le croisement avec les nègres et avec les Indiens a produit toutes ces nuances.
Rio, capitale du Brésil, pour la population est la première ville de l'Amérique du sud. Elle compte 500,000 habitants. L'Hôtel de France qu'on m'avait indiqué comme le meilleur est loin d'être confortable. Après la visite (p. 040) réglementaire à la douane, je peux retirer mes bagages, et je prends un ferry, nom qu'on donne ici aux bateaux traversant la baie, au-delà de laquelle s'élève la ville de Nicteroy. Je réservais ma première visite aux enfants de dom Bosco qu'on m'avait dit habiter à Santa-Rosa di Nicteroy. De l'autre côté de la baie que je traverse en une demi-heure, on me dit que Santa-Rosa est à une lieue de distance; je monte sur une voiture de tramways, et je parcours une vallée magnifique qui me dédommage un peu des odeurs de Rio. Après une heure, j'arrive sur un monticule à une chapelle fermée et la maison attenant ne contient que des nègres. C'est bien ici la chapelle Santa-Rosa, me disent-ils en portugais, mais personne que nous n'y demeure. Après avoir demandé à bien des maisons et des passants, on me conduit à une maisonnette cachée dans un bouquet d'arbres au pied d'une colline: C'est ici, me dit-on, la maison achetée pour les enfants de dom Bosco, et ils y seraient déjà sans la fièvre jaune; mais l'évêque, Mgr Lacerda, a préféré laisser éteindre le terrible fléau avant de les y installer. Je reprends le bond et le steamer et arrive à l'Hôtel de France bien tard pour le dîner. Je passe la nuit sur le lit dur: ils le sont tous ici. Il paraît que dans les climats chauds la couche dure est plus saine: je ne dis rien des rats dans la chambre et des mille-pattes, cet horrible insecte que je trouve dans mes draps. Ici il est inodore, mais ce qui n'est pas du tout inodore sont les cuisines et waterclosets qui parfument toute la maison. S'il en est ainsi partout, il faudrait (p. 041) s'étonner seulement qu'il n'y eût pas de fièvre jaune. Aussi dès le lendemain, je me préoccupe de changer de quartier et d'hôtel, mais le Grand-Hôtel n'a point de place, l'Hôtel des Étrangers et d'Angleterre n'ont plus que de petites chambres, et je me sauve à l'hôtel Vista Allegra sur la colline de Santa-Tereza. On arrive en tramway au pied d'une colline qu'on escalade par un chemin de fer à ficelle, et un autre tramway nous conduit par la colline jusqu'aux grands réservoirs publics ou dépôts d'eau qui alimentent la ville. Cette excursion est magnifique: on domine la ville, la rade et les environs, le coup d'œil est ravissant; à l'hôtel Vista Allegra on respire un air pur et on jouit du même panorama.
Une fois mon domicile fixé, je commence mes visites. Le grand séminaire est tenu par les lazaristes français, les élèves y sont au nombre d'une vingtaine. Le P. Henh, supérieur, me renseigne sur les œuvres charitables du pays.
M. Galvao, directeur de l'École polytechnique, me reçoit avec bonté. Il lutte de son mieux pour infuser un peu d'énergie dans les caractères indolents; il me paraît homme de forte volonté, il m'invite à visiter son école fréquentée par 300 élèves; et me donne plusieurs renseignements sur le pays et l'adresse de personnes nombreuses pour lesquelles on m'a remis des lettres.
Je visite entre autres M. Morissy. Cet Anglais de vieille race est depuis longtemps membre de la Chambre de commerce. Il me présente à son président, et (p. 042) me remet une carte pour être admis à la lecture des nombreux journaux dans les salons de la Chambre. Chemin faisant, il me fait remarquer le superbe palais de commerce en construction. Quel dommage de mettre tant de millions en un quartier si malsain! Le président de la Chambre de commerce, avec beaucoup d'amabilité, répond à mes nombreuses questions sur le commerce de la capitale, sur la colonisation et l'esprit qui la guide, et me remet le Relatorio da associacâo commercial do Rio de Janeiro do anno de 1881. En le parcourant je vois que l'association demande instamment au gouvernement la réforme monétaire. Il n'est pas facile, en effet, à l'étranger, de se reconnaître dans ce labyrinthe de mille et millions de reis, et il lui faut longtemps pour s'y habituer. L'unité monétaire est le reis qui vaut ici un quart d'un centime, à peu près la moitié de la sapèque chinoise: en effet, s'il faut 1,200 sapèques pour 5 fr., il faut 2,200 reis pour la même somme. Heureusement le reis n'est pas monétisé; on a de petites monnaies de nikel de la grosseur d'un sou et valant 100 et 200 reis, mais le plus souvent ce sont les sales chiffons de papier-monnaie qu'on reçoit et qu'on donne; ils ressemblent à ceux qu'on a vus en Italie et ailleurs. Les plus petits sont de 500 reis, un peu plus d'un franc. Ce papier perd actuellement environ 10%, quand on veut l'échanger contre métal. Les gouvernements qui ont déjà été assez sages pour former l'union postale, feraient bien de former une union monétaire universelle: tout le monde en profiterait.
(p. 043) Je trouve dans les documents qu'en 1881, la place de Rio a vendu 3,286,813 sacs de café du poids de 60 kilos, au prix de 3,620 reis (un peu plus de 7 fr. les 10 kilogr.). Ce prix était de 5,603 reis en 1879, presque le double; que la valeur des marchandises exportées de Rio en 1881 atteint environ 130,000,000 de fr.
Qu'en 1879-1880, l'Angleterre a importé pour environ 80,000,000 de fr., la France 32,000,000, les États-Unis pour 16,000,000, le Portugal pour 12,000,000, l'Italie pour 1,600,000, l'Espagne pour 1,000,000 de fr.
Pour la navigation, en 1880-81, sont entrés et sortis au port de Rio-de-Janeiro, 847 navires anglais, 257 allemands, 239 français, 232 américains, 137 brésiliens, 117 espagnols, 91 portugais, 89 norwégiens, 77 italiens. La France importe surtout les vins, mais elle vient après le Portugal: celui-ci en effet en 1881 a importé environ 3,300 pipes et la France 2,700. Le chemin de fer D. Pedro II, qui a coûté environ 200,000,000 de fr., en 1881 a donné une rente brute de environ 26,000,000 de fr.; en défalquant les frais d'exploitation, environ 11,000,000 de fr., reste pour le revenu net environ 15,000,000 de fr.
L'immigration au port de Rio-de-Janeiro pour 1881 a été de 1,162 immigrants subventionnés et 19,362 immigrants libres; mais il y a eu aussi 9,434 départs.
Dans l'après-midi, je me rends au petit séminaire au Palacio épiscopal de Rio Comprido: il est au loin à la campagne, mais les tramways vont partout. Une magnifique allée de palmea gigantea conduit à la maison. Elle (p. 044) a une cour intérieure et paraît bien disposée pour l'éducation. Dans le salon, je vois une espèce d'oiseau noir à gros bec; c'est le bicudo, me dit le professeur. Il est ainsi appelé à cause de son gros bec: il n'est pas joli, mais il chante comme le rossignol; la nature ne donne jamais tout à tous. Quatre-vingts élèves sont là instruits dans les lettres et sciences par les lazaristes français et plusieurs prennent plus tard le chemin du grand séminaire. Dans le jardin, je remarque une magnifique allée plantée de bambous; ils sont si serrés qu'ils forment une barrière impénétrable aux rayons du soleil. Un peu plus loin, une vaste piscine sert aux bains quotidiens des élèves. À côté, un grand potager fournit non seulement tous les légumes à la maison, mais encore un revenu locatif. Une église nouvelle est en construction; la matière employée est la brique, quoique les pierres ne manquent pas: les environs de Rio sont remplis de granit.
Un peu plus loin, je visite un collège tenu par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elles donnent l'instruction à 80 garçons et à 100 filles; la pension est d'environ 100 fr. par mois; mais les garçons sortent à l'âge de 12 à 14 ans. Toutefois, cette faculté d'enseigner la classe riche n'est accordée qu'exceptionnellement aux Sœurs de Charité, lorsqu'elles sont en mission et qu'il n'y a point d'autre ordre enseignant. Saint Vincent de Paul les a spécialement établies pour se dévouer à la classe populaire, et pour ne pas l'oublier, les Sœurs tiennent dans ce même collège 30 garçons et 40 filles pauvres. Je parcours (p. 045) la maison: classes, dortoirs, cours de récréation, tout est bien disposé. De nombreux petits réservoirs servent pour les bains des élèves. Sans le bain quotidien, me dit la Sœur, nous aurions dans ce climat bien des maladies de peau. Le bon lazariste qui m'avait reçu au petit séminaire m'avait donné son domestique pour me conduire chez les Sœurs; il me conduit encore au palais Impérial à Saint-Sébastiao. Le baron de Buon Ritiro, chambellan de l'empereur, se trouve de service au palais: il me reçoit avec prévenance, et me promet pour le 13 juin une audience de Sa Majesté.
Poursuivant ma route, après plusieurs changements de tramways et une heure de voiture, j'arrive à la villa Moreau à la Tijuca. La chaleur était forte à Rio, je voulais passer une nuit à la campagne.
La Villa ou Hôtel Moreau est située au milieu d'un magnifique parc au pied des montagnes de la Tijuca: je trouve à table d'hôte beaucoup d'Anglais qui, en gens pratiques, s'en vont le matin à leur bureau à Rio et reviennent le soir à l'air pur. Parmi les convives, je distingue un jeune couple en lune de miel.
Le lendemain, de grand matin, je gravis la Tijuca dans un break. Durant une heure, quatre vaillantes mules nous tirent le long de la montagne, au milieu d'une végétation tropicale. Le gouvernement rachète ces montagnes pour laisser repousser la forêt et en faire une promenade publique. Les pics les plus élevés ont 1,000 et 1,200 mètres d'altitude: on les atteint en deux heures de cheval du (p. 046) plateau de la Cascatella ou petite cascade, près de laquelle passe la voiture. Nous voyons par-ci par-là quelques fabriques de papier pour lequel on emploie ici les fibres du bananier. Nous apercevons sur le plateau quelques gracieuses villas, et après une courte descente, nous arrivons à deux hôtels situés l'un près de l'autre, White Hôtel et Hôtel Jourdain. Les noms indiquent que l'un est anglais et l'autre français. Ils occupent deux maisons ayant fait partie d'une même fazzenda de café. L'endroit est extrêmement pittoresque; beaux ombrages, vallons, cours d'eau. Aussi c'est un rendez-vous populaire le dimanche. À dix heures et demie j'étais de retour à l'Hôtel Moreau, et après un bon moment de natation dans la fraîche piscine, je trouve le déjeuner excellent. Un jardinier français très instruit m'accompagne à mon excursion dans le parc. Il le garnit avec les plantes qu'il va chercher dans la montagne, et il en découvre toujours de nouvelles; mais il a à se défendre contre les serpents, peu habitués à être dérangés dans la forêt vierge. Le Copi, qui a environ 1m50 de long, est inoffensif; le Corail, ainsi nommé à cause des anneaux rouge-corail qui ornent sa peau, est venimeux, mais il ne s'en prend à l'homme que lorsque celui-ci l'attaque. Le Churucu est sérieusement dangereux; il est noir, gros et court; il n'a que 75 centimètres de long: mais s'il voit l'homme, il se roule, l'attend, s'élance et mord, laissant dans la plaie son venin mortel. Aussi le jardinier ajoute qu'il ne va jamais dans ses excursions qu'armé d'un flacon d'alcali.
(p. 047)
Brésil: Diverses sortes de Palmiers.
Mon guide me fait remarquer les belles plantes du parc, et d'abord le jacquier ou artocarpus, qui est de deux sortes: l'integrifoglia donne toute l'année des fruits, ils pendent directement du tronc; l'incisafoglia ne donne le (p. 048) fruit qu'une fois l'an; ce fruit, sauté au beurre, a le goût du pain; c'est pourquoi on appelle cet arbre l'arbre à pain. Le manguier ou manguifera borbonica devient colossal et donne des fruits pesant jusqu'à 1 livre 1/2. Le giroflier, dont la tige des étamines est le clou de girofle, bien connu de nos cuisinières. Presque tous ces arbres sont couverts de parasites; ce sont des picarnia, des broumelias verdifolias et autres qui pendent en lianes. Parmi les palmiers nous voyons le cameodora elegans ou palmaria gigantea qui vient si bien ici et atteint jusqu'à 30 mètres de haut; malheureusement il ne donne aucun fruit utilisable; puis l'areca rubra ou areca madagascarensis, avec d'immenses palmes; l'areca bambousa ou palmier bambou, dont la tige ressemble au bambou. Le cariotta aureus à feuille trilobée, le felix reclinata, et autres sortes de cocotiers. L'avocatier donne un fruit excellent en forme de poire, mais rempli d'une espèce de crème ou beurre végétal. Le treligea regina ou arbre du voyageur, semblable à un immense éventail, formé de feuilles à forme de bananier; il sort plus d'un litre d'eau de chaque feuille si on la coupe, c'est pourquoi il a reçu le nom d'arbre du voyageur. Le teophrasta imperialis à large feuille donne une espèce de nèfle du Japon. Le mammea americana à belles feuilles de magnolia, donne toute l'année un excellent abricot, dit de Saint-Domingue. Nous voyons une grande variété de mimosa et d'acacias parmi lesquels je remarque le flamboyant, de la famille des césalpinées. Dans la famille des pandanées (p. 049) nous trouvons le pandanus utilis, le pandanus juvonicus, le pandanus graminiformis, le pandanus inermis. Dans la famille des sicadées, le sicas revoluta, le sicas circinalis; parmi les dracœnas, le dracœna umbraculifera, le dracœna rubra terminalis; le poincentia pulcherrima à belles feuilles rouges, qui commence à faire son apparition en Europe; le califa, etc. Dans les cucurbitacées, le mamou, qui donne un fruit jaune dont les habitants du pays font une compote; l'arbuste croton et une infinité d'autres dont une bonne partie sont utilisés en cuisine ou en pharmacie.
Rentré à Rio dans la soirée, je rends visite à M. le vicomte Barbacena, d'une des plus anciennes familles du pays. Il me renseigne sur les principales plantations de café et de cannes, et m'en facilitera la visite.
13 juin.—À l'approche de la fête de saint Antoine, on tire force fusées et pétards tous les soirs, mais on se soucie fort peu de la fête religieuse.
Au musée on venait de terminer une exposition anthropologique; le directeur, M. Netto, avec beaucoup de bonté, met un employé français à ma disposition pour la visite des nombreuses salles. Tout ce qui concerne les Indiens: céramique, armes, filets, embarcations, s'y trouve à profusion; on a même copié d'après nature les principaux types. J'en ai vu d'absolument identiques à la race jaune, et d'autres de race pure indo-européenne; preuve certaine que les hommes ont abordé ici de divers lieux et à des époques diverses. Les nombreux vases de (p. 050) terre ressemblent, par la forme et le travail, à la céramique des Étrusques. On peut voir bien des objets qui rappellent l'Égypte, entre autres la momification; mais les momies indiennes ne sont pas couchées au long; le corps est plié, les genoux touchant la poitrine, selon la manière dont les Japonais disposent leurs morts dans le cercueil avant de les brûler. Les pirogues sont des troncs d'arbres creusés, ou des écorces liées: les lances et les flèches ont le bout en pierre ou en os; elles sont parfois imbibées d'un poison végétal. Certaines flèches légères étaient lancées en soufflant dans un bambou qui les contenait. On trouve aussi des casse-tête et une quantité d'instruments de pierre absolument identiques à ceux que j'ai vus en Allemagne, en Norwège, en Russie. L'homme a certainement abordé l'Amérique par le détroit de Behring, d'où il est descendu vers l'Amérique centrale; mais, à plusieurs reprises, des embarcations y ont été entraînées par des tempêtes où des courants, et on peut ainsi s'expliquer la présence des différentes races et des différentes civilisations.
Le soir, à cinq heures, j'étais à San-Christovao, au Palais impérial. M. le vicomte de Buon Ritiro me présente à Sa Majesté l'empereur qui m'accueille avec bonté. La conversation roule sur les voyages, sur l'enseignement, sur la charité: il importe, dit l'empereur, de bien s'assurer de l'exactitude de ce que l'on dit, mais il importe aussi beaucoup de ne jamais cacher la vérité. L'empereur m'a paru animé d'intentions droites et de bonne volonté.

Brésil: Palais Impérial.
(p. 051) Un ingénieur venait après moi pour le renseigner sur un chemin de fer de Pernambuco. Il reçoit avec facilité, écoute avec attention, et se rend compte des affaires. On loue sa simplicité et sa charité. On lui reproche d'un peu trop sacrifier à l'amour de la popularité.
Je prends congé de Sa Majesté pour passer chez l'impératrice. Elle est dans un salon, assistée d'une dame d'honneur. Elle m'accueille avec bienveillance, et, puisqu'elle est de famille italienne, je lui parle des œuvres de dom Bosco, saint prêtre italien qui renouvelle les merveilles de saint Vincent de Paul. Sa Majesté apprend avec plaisir que dom Bosco va fonder sa première maison dans le Brésil. Puisse-t-il, comme partout ailleurs, y développer, chez les enfants abandonnés, le sentiment chrétien et l'amour du travail.[Table des matières]
Excursion à Pétropolis. — Rencontre du comte d'Eu. — Sa famille. — La colonie allemande. — L'ingénieur Bonjean. — La filature la Pétropolitana. — Les bois de construction. — Pourquoi on délaisse l'industrie française. — Le corps diplomatique. — L'internonce et l'administration religieuse. — Le téléphone. — La Chambre des députés. — Les chemins de fer. — Le baron de Teffé et l'exploration de l'Amazone.
Le 14 juin, à trois heures, j'étais sur le petit steamer qui traverse la baie pour rejoindre le chemin de fer de Pétropolis. Nous longeons à gauche une quantité d'îles verdoyantes et pittoresques. À mesure que nous avançons, les montagnes de Pétropolis et de Teresopolis appelées de los organos, à cause de leur forme en guise de tuyaux d'orgues, nous paraissent plus hautes. Peu de monde dans le navire; j'ai près de moi un voyageur à physionomie française, je lui demande divers renseignements sur le pays que je vais visiter. Il répond à mes questions avec beaucoup de bonté; je lui demande aussi si M. le comte d'Eu est à Pétropolis. «Je ne pense pas,» me dit-il (et en effet, il n'y était pas en ce moment), mais comme je lui montre une lettre pour Ramiz Galvao, instituteur de ses enfants, il me dit: «Vous êtes sans doute M. Ernest Michel?» Sur ma réponse affirmative, il ajoute: «Je suis moi-même le comte d'Eu; M. le vicomte (p. 054) de Buon Ritiro m'a parlé de vous, et M. le comte de Noiac m'a écrit de Paris pour m'annoncer votre visite; je serai heureux de vous recevoir.» J'exprime ma satisfaction et mon étonnement pour la simplicité des chefs de l'Empire. Dans un siècle où on ne cesse de parler d'égalité, le peuple aime et apprécie cette simplicité.
Le long de la route, l'auguste prince n'a cessé de me renseigner sur une quantité de choses concernant le pays, et notre conversation variée m'a laissé de lui le meilleur souvenir. Le navire est à la jetée et nous montons dans de larges wagons pour traverser la forêt qui sépare la baie du pied des montagnes. Partout d'impénétrables fourrés, mais pas d'arbres de haute futaie, la main de l'homme a déjà fait ici ses ravages. Il faudra maintenant dix ans pour que le petit bois soit un taillis ou puera, comme disent les Brésiliens, et quarante ans pour qu'il soit forêt ou pueran.
Au pied de la montagne, on quitte les grands wagons et on prend place dans des petits wagons. La large voie de 1m50 est remplacée par la voie étroite d'un mètre. Une locomotive nous pousse lentement sur une voie à crémaillère à pente de 15%. C'est le système du chemin de fer du Righi, mais adouci, car celui-là a une pente de 25%. À mesure que la locomotive s'élève, la nature alpestre nous apparaît dans toute sa beauté: forêts, ravins, cours d'eau, cascades, etc. Au loin la vue plonge sur la rade, sur Rio et les pics environnants. Derrière ces pics, le soleil se couche enveloppé dans un nuage aux riches (p. 055) couleurs. En une demi-heure, nous atteignons 7 à 800 mètres d'altitude. Sur le plateau, une locomotive nouvelle reprend le train à l'avant et nous traversons une charmante petite vallée parsemée de blancs chalets alpestres. C'est la demeure des bonnes familles allemandes venues ici il y a quarante ans. Les vieillards seuls ont vu la mère patrie, la jeune génération est brésilienne. Le terrain qui entoure les chalets est cultivé en potagers: c'est bien petit pour faire vivre une famille; mais ces bons Allemands ont apporté avec eux leurs industries: ils font le beurre et fabriquent la bière.
À cinq heures et demie, le train nous dépose à Pétropolis. Une pleine voiture d'enfants autour de leur mère envoyent avec leurs mains mignonnes des baisers vers le train: ce sont les enfants du comte d'Eu qui ont aperçu leur père. «Voilà pour vous du nouveau,» me dit le prince en me montrant un bond ou tramway tout neuf; j'y monte, et quelques instants après, je suis à l'Hôtel d'Orléans. Ce vaste établissement à peine achevé ne figurerait pas mal même au milieu des meilleures stations hivernales ou balnéaires d'Europe.
La chaleur et les odeurs de Rio m'avaient fatigué. Après le dîner je gagne mon lit et le lendemain à sept heures j'inspecte la ville.
Pétropolis m'a paru comme Cannes, comme Menton à leur début, une ville à la campagne. Partout chalets, villas entourées de parcs gracieux, aux plantes variées, aux fleurs éblouissantes. En passant devant la villa du (p. 056) comte d'Eu, j'admire encore une fois la simplicité de la famille régnante. Je rends visite à M. l'ingénieur Bonjean. Né au Brésil, mais d'origine savoisienne, il est parent du président Bonjean, fusillé sous la Commune. Lauréat de l'École centrale à Paris, il s'est occupé ici de chemins de fer et dirige actuellement deux usines de filature et tissage de coton. Il me donne des détails très intéressants sur le pays et sur ses immenses ressources. L'esprit de routine laissé par les Portugais fait qu'on n'a pas encore bien compris l'importance de l'immigration. On néglige les moyens de la faire affluer. Les immenses ressources de la contrée sont donc encore perdues pour tout le monde. Les terrains accessibles sont presque tous propriété privée, et les propriétaires incapables d'en tirer parti en demandent des prix qui éloignent tout acheteur. Les terrains plus éloignés appartiennent à l'État, qui les donne au prix minime de 15 à 20 fr. l'hectare, 1 reis par mètre carré, mais le manque de routes les rend peu abordables à l'immigrant. Les compagnies qui se formeraient pour construire des chemins de fer traversant les terrains riches et vierges et recevant comme gratification une large bande sur les deux côtés de la voie, feraient certainement ici comme aux États-Unis, d'excellentes affaires. Le gouvernement, en facilitant l'action de ces compagnies, bénéficierait le premier par l'augmentation de la population, par l'impôt direct qui est minime, et surtout par l'impôt indirect qui, par les droits de douane, est très productif. Ce sera toujours un mérite pour ceux (p. 057) qui ont la direction de la chose publique, de sortir de l'horizon étroit des préoccupations locales ou personnelles et de regarder les choses du point de vue élevé qui embrasse l'humanité. Or, la nature qui a produit les immenses terrains encore vierges de l'Amérique du sud, ne les a pas produits pour les reptiles et les animaux sauvages qui les parcourent, mais pour en faire bénéficier l'homme, auquel Dieu a dit: «allez, croissez et remplissez toute la terre.» Qu'importe la nationalité et la race, si on veut bien utiliser le sol à la sueur de son front? À la longue, tous ces travailleurs venus de tous les points du globe feront une race qui, pour être le résultat du mélange de nombreux éléments actifs, n'en sera pas moins homogène et plus forte.
M. Bonjean veut bien me conduire à la Pétropolitana, fabrique qu'il dirige depuis peu de temps. Après une heure de voiture, le long d'un charmant cours d'eau, nous arrivons à un point où il se précipite d'une vingtaine de mètres en cascade à deux étages le long d'un rocher de granit: c'est la cascatella. On refait le pont de bois qui traverse le torrent. À cette occasion, M. Bonjean me fait remarquer les jolis bois de construction de la contrée. C'est d'abord le vignatico, de la famille des cèdres, dont on fait de beaux meubles, des marches et des parquets; le tapinhoam à bois jaune; le masananduba, à bois rouge; le cèdre à feuilles larges; le paineira au tronc épineux, qui donne la paina, espèce de fruit rempli d'une soie végétale, qui sert pour garnir les oreillers; le pigno (p. 058) ou sapin du pays, dont les feuilles courtes et larges piquent comme des épines.
Il y a actuellement au Brésil 40 filatures de coton, dont 2 à Pétropolis. La plus importante est celle de Macaco, que M. Bonjean dirige depuis huit ans; la seconde est la Pétropolitana, dont il vient de prendre la direction en février dernier. La première donne un dividende de 15%, la seconde cause encore des pertes, preuve de l'importance de la direction pour le résultat d'une affaire.
Le moteur est l'eau du ravin avec une chute de 40 mètres. La toiture, échelonnée en petites bandes en forme de scie, éclaire à grand jour la vaste construction. Au rez-de-chaussée sont les ateliers de réparation: forgeron, rabotage, ferrage, tournage de fer, charpentiers et ajusteurs; puis les ateliers de teinture du fil et les entrepôts divers. Au premier étage sont alignés sur cinq rangs 5,000 broches à filer et 100 métiers à tisser, outre les batteuses et les cardeuses de divers degrés. La toile confectionnée atteint environ 6,000 mètres par jour, emballée mécaniquement en ballots de 340 mètres prêts à être dirigés sur les marchés du pays. La bonne toile blanche de coton de 0m90 de largeur revient à environ 1 fr. le mètre; elle sert au vêtement des esclaves. Celle qui, par les dessins variés et ses teintes brillantes, sert au vêtement du peuple, coûte 1 fr. 50 le mètre. On fabrique aussi de la toile à voiles pour les navires. Le soir, la lumière est fournie par le gaz de ricin: on met dans les cornues les graines et bois de ricin et on opère comme (p. 059) avec le charbon. Déjà, j'avais vu l'hôtel éclairé par un extrait de pétrole appelé la gazotine.
Dans ces pays nouveaux on observe ce qui se produit en Europe en fait d'invention, et on introduit toujours les dernières découvertes. Ainsi, on voit partout fonctionner ici le téléphone, pendant qu'il est à peine en usage dans quelques rares établissements des grandes villes de France. Sur le steamer, j'ai fait route avec un Portugais qui importe ici les tramways mus par l'électricité, pendant qu'on commence à peine à en parler chez nous.
En examinant les nombreuses machines de la Pétropolitana, je remarque qu'elles sont presque toutes de construction anglaise et américaine, et je demande au directeur s'il n'aurait pas intérêt à les commander en France. Les machines françaises sont plus chères, me dit-il, mais la fabrication est meilleure, et à la longue elles procurent encore une économie; mais il est difficile de traiter avec les maisons françaises, car elles sont ou lentes ou chicaneuses, et en tout cas elles manquent d'esprit pratique. Vous voyez ces dessins; ils marquent les machines montées et les machines démontées avec les numéros d'ordre à chaque pièce. Si j'ai besoin d'une pièce de rechange, je n'ai qu'à écrire à Manchester en indiquant simplement le numéro, et la pièce m'arrive par le premier navire; mais s'il s'agit d'une maison française, rien de semblable. Je suis obligé de dessiner la pièce, de bien donner la dimension, et souvent on aura besoin de (p. 060) nouvelles explications qui font perdre des mois, et à la fin la pièce arrive peut-être incomplète ou mal adaptable. J'aurais eu cent fois l'occasion de faire d'importantes commandes en France, soit pour les chemins de fer, soit pour l'industrie; j'ai échoué: quand je télégraphiais, on mettait un mois à me répondre parce que tel inspecteur ou tel autre était en voyage, et en attendant, l'occasion d'une affaire était manquée. Quand je demandais les prix ou les devis, on me répondait qu'on ne pouvait les donner de suite, et on les envoyait six mois après. Si je réclame un nouveau modèle, on me répond qu'on a le leur, et qu'on ne saurait en adopter un autre. Par contre, lorsque je vais chez l'Américain du Nord ou chez l'Anglais, il me montre les modèles et je choisis. Si j'en veux un autre, il me le fait sans retard: il me donne le devis et le prix, et je puis contracter immédiatement en saisissant l'occasion. Les hommes intelligents et sérieux ne manquent pas en France: il est certain que s'ils connaissaient ce qui se passe par le monde, ils organiseraient mieux leurs affaires, s'affranchiraient un peu du fonctionnarisme et de la routine, et se mettraient en mesure de lutter avantageusement sur les divers points du globe avec l'industrie de leurs voisins. Jusqu'à ce jour, le Français reste chez lui, et réduit le monde à l'Europe. Le personnel consulaire qui devrait le renseigner sur ce qui se passe n'a pas été préparé par des études professionnelles, et pourtant le monde marche, et celui qui négligera de se tenir au courant du mouvement de tous les jours sera (p. 061) nécessairement dominé par les plus habiles. Or, il ne faut pas l'oublier, dans les pays nouveaux, si le champ ouvert au commerce et à l'industrie devient tous les jours plus vaste par l'introduction des chemins de fer et des usines, l'Europe entière est là pour offrir ses services: et non seulement l'Europe, mais encore l'Amérique du Nord qui, non contente de s'être en cela émancipée de l'Europe, lui fait maintenant concurrence.
M. Bonjean me fait remarquer les divers avis affichés à la porte de l'usine: ce sont des recommandations ou des prohibitions. Au commencement, me dit-il, j'avais introduit les règlements des usines d'Europe, mais le résultat n'était pas satisfaisant. Alors j'ai jeté les règlements au loin, et me suis borné à recommander, et au besoin ordonner ce qui m'a paru bon, et à défendre ce que je trouvais mauvais. Je laissais ainsi le règlement se former par lui-même à la suite des années par l'action de la coutume. Ce système m'a parfaitement réussi à l'usine de Macaco et je le reproduis ici. J'ai 460 ouvriers à l'autre usine et je cherche à les attacher à l'établissement en leur rendant la vie facile et commode pour eux et pour leur famille. Moyennant une redevance annuelle, au bout de quelques années, ils sont propriétaires de la maison qu'ils habitent, d'un lot de terrain précieux pour les légumes, et menus produits qu'il procure à un ménage. Quand j'ai pris la direction de l'usine, je l'ai trouvée entourée de débits de boissons, source de désordres, et je me suis empressé de les expulser; mais sachant que (p. 062) l'ouvrier a besoin de délassement, j'ai organisé pour eux et par eux une bande musicale, et une salle de gymnastique au moyen d'une association dont le médecin est le président. Ils ont leur société de secours mutuels, et la chapelle occupe le centre de l'usine. Je témoigne à tous une affection paternelle, mais j'évite la familiarité. Tous les mois cinq récompenses en somme d'argent sont données aux cinq ouvriers ou ouvrières qui se sont distingués par la conduite et le travail. La plus grande impartialité préside à ces distributions; précaution d'autant plus nécessaire que je suis en présence de plusieurs nationalités souvent disposées à se jalouser.
Les infractions sont punies au moyen d'amendes rendues publiques par l'affichage. Le résultat de ce système a été la paix et la stabilité dans le personnel des ouvriers, le relèvement du niveau moral, l'aisance dans les familles, l'augmentation des dividendes; en un mot, la prospérité de l'usine. Heureux les hommes qui savent ainsi procéder par l'expérience plutôt que par la théorie, et s'inspirer de l'amour de leurs frères: ils recueillent l'affection en même temps que l'abondance.
La maison du directeur est bien disposée pour le climat, entourée d'un beau jardin dans lequel je trouve, à côté des fleurs et des fruits des tropiques, les poires, les pommes, les figues, les raisins, les asperges, les salades et les choux, et jusqu'à une plante de thé. Le tout est encadré par les bois, dans lesquels on retrouve les espèces les plus odoriférantes, depuis le colosse, qui (p. 063) produit le clou de girofle, jusqu'au canela capitanmor, dont l'odeur rappelle absolument les matières fécales.
Pour rentrer en ville, nous parcourons la route pittoresque du matin: il me semble que je traverse un coin de la Suisse. Nous nous rendons à une autre filature de coton: l'usine de San-Pedro de Alcantara. Là, nous trouvons 180 ouvriers et ouvrières faisant manœuvrer 5,000 broches et 70 métiers. Le directeur, avec beaucoup de complaisance, nous explique comment, par suite d'insuffisance d'eau, il a été obligé d'établir une machine à vapeur à côté de sa roue hydraulique. Je l'engage à remplacer celle-ci par une turbine, qui exige moins d'eau que la roue: il en convient, mais la roue, il l'a, et la turbine devrait être achetée. Ainsi, n'ayant pas le courage de donner peu pour se rattraper grassement, il continue de voir passer en combustible une bonne partie des bénéfices. Combien de calculateurs à courte vue on rencontre dans la vie! M. Bonjean aussi avait trouvé à Macaco des turbines insuffisantes, et n'hésita pas à sacrifier 30,000 fr. en s'imposant un mois de chômage pour les remplacer par des turbines plus puissantes. Le résultat a été une telle augmentation dans la quantité de toile produite qu'immédiatement les frais furent couverts, et tout le surplus est maintenant bénéfice. Je demandais à M. Bonjean ce qu'il avait fait de ses ouvriers durant le mois de chômage. Je les ai employés, dit-il, aux travaux nécessités par le changement des machines et autres travaux supplémentaires. C'est de l'administration paternelle!
(p. 064) Le corps diplomatique du Brésil passe la plus grande partie de l'année à Pétropolis, où il paraît subir les atteintes de l'ennui. J'appris trop tard, pour lui rendre visite, que le chargé d'affaires d'Italie était un Niçois, le comte Deforesta.
Je me rends chez Mgr Felici, l'internonce apostolique. C'est un Romain calme comme les habitants de l'ancienne capitale du monde. Il me fait bon accueil, et me présente son secrétaire, abbé sicilien au regard de poète. Il me renseigne sur les choses religieuses du Brésil, et m'assure que pour lui il ne connaît pas l'ennui, vu qu'on le tient constamment occupé par les formalités de dispenses en matière matrimoniale.
Il y a 12 diocèses au Brésil pour une population d'environ 12 millions d'habitants, et une étendue presque aussi grande que celle de l'Europe. Plusieurs n'ont même pas de séminaire; mais Dieu supplée à ce que les hommes ne peuvent faire. Les Indiens, au nombre d'environ 500,000, sont évangélisés par des Ordres divers, et surtout par les capucins italiens, qui dépendent directement de la Propagande. Les évêques sont présentés par l'empereur et confirmés par le Pape.
Je passe chez M. Ramiz Galvao, ancien directeur de la bibliothèque publique et précepteur des enfants de Son Altesse le comte d'Eu. M. le comte de Noiac m'avait envoyé une lettre pour lui. Nous causons éducation et instruction, et je peux bientôt me convaincre combien mon interlocuteur est digne du poste de confiance qu'il (p. 065) occupe. Il comprend à merveille la haute importance de diriger les premiers pas dans la voie du savoir de celui qui sera appelé plus tard à régler les destinées de l'Empire. Il sait bien que tout en armant l'intelligence, il faut surtout cultiver le cœur.
Je ne pouvais quitter Pétropolis sans présenter mes hommages à Son Altesse le comte d'Eu; il est Français, fils du duc de Nemours, et son oncle le prince de Joinville a épousé une des sœurs de l'empereur. Comme je l'ai déjà dit, la loi salique n'étant pas en vigueur au Brésil, sa femme, fille unique de Pedro II, règnera après lui et aura pour successeur son fils aîné âgé de dix ans actuellement. Le comte d'Eu aura donc à remplir ici le rôle qu'a si bien rempli le prince Albert en Angleterre.
Je me rends au palais impérial: même simplicité qu'à Rio, auprès de la Cour et des grands. La porte est grande ouverte: pas de concierge, je traverse le parc, j'arrive au palais; là aussi la porte est ouverte, et pas de portier. Je parcours les corridors, me dirigeant du côté du bruit de rires enfantins. J'arrive à une chambre où le prince joue avec ses enfants et guide les premiers pas d'un bébé de deux ans. Il interrompt ses amusements pour s'entretenir une demi-heure avec moi. Il me parle d'une exposition pédagogique dont il préside la commission: cela me rappelle que j'avais eu pour compagnon de cabine sur le steamer le Niger un journaliste de Paris, délégué à cette exposition. Est-ce hasard ou coïncidence? Deux jours après l'arrivée du Niger, j'aperçois dans la rue Ouvidor, aux vitrines du (p. 066) libraire qui sert de correspondant au journal dirigé par ce délégué, une exposition de Vénus et de Cupidons sous lequel on lisait en grandes lettres: novedades, nouveautés. C'est aussi de l'enseignement, mais du mauvais.
Le discours tombe sur l'esclavage qui va en diminuant. Il n'y a plus actuellement que 1,346,648 esclaves au Brésil: la loi de 1871 rend libre tout enfant né d'une femme esclave. Ces enfants restent jusqu'à dix-huit ans sous la tutelle du maître de la mère. Naturellement ils sont un peu négligés et Son Altesse projette une association pour s'occuper d'eux, les patronner et les instruire. L'association est le levier des sociétés modernes. Elle sera toujours le plus grand instrument du bien et du mal. Tous les jours je lis dans les journaux l'annonce d'esclaves rendus à la liberté par leur maître, ou rachetés par des associations. On en affranchit aussi un grand nombre par testament; et Son Altesse me cite une dame qui vient de léguer sa vaste propriété à ses 400 esclaves, voulant qu'elle soit partagée par familles. Belle et grande pensée de cette propriétaire qui fait de ses esclaves ses héritiers! Une commission a été nommée pour exécuter la pensée de la noble dame. Tout le monde s'accorde à croire que dans vingt ans il n'y aura plus d'esclaves au Brésil et que le travail libre les remplacera avec avantage. Nous causons enfin de dom Bosco, dont Son Altesse a visité l'établissement à Turin; je lui raconte ses succès à Lyon, à Paris, à Amiens, à Lille, et le prince m'apprend la mort de M. de Laboulaye, chez lequel j'avais conduit le (p. 067) saint prêtre quelques semaines avant. Un grand nombre d'enfants court dans les rues de ce pays. Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul ont de nombreux établissements dans lesquels elles prennent soin des orphelins; mais les garçons sont livrés à l'abandon, et Mgr Lacerda, qui sent la nécessité de s'occuper aussi du sexe masculin, a appelé les missionnaires de dom Bosco.
Il est bien tard quand je quitte le prince pour rentrer à l'hôtel prendre un repos nécessaire.
J'aurais voulu passer la soirée avec un avocat auquel on m'avait adressé. Nous aurions causé sur les lois et la magistrature. Déjà je savais qu'imitant un peu notre code, les lois brésiliennes, en fait de succession, avaient réduit au tiers la portion disponible, et j'avais entendu des plaintes à ce sujet. On y voyait un obstacle à la stabilité des familles. J'aurais voulu connaître l'appréciation d'un homme compétent à ce sujet, mais les forces étaient à bout, et je dus renoncer à cette visite. Le lendemain matin à six heures je suis sous la douche froide qui ranime les nerfs; j'admire le beau lever du soleil, je revois encore une fois les têtes blondes et les yeux bleus des enfants des colons, et à sept heures je suis à la gare. Mme la comtesse de Barral, qui avait été l'institutrice de la princesse, y accompagnait son fils récemment marié à Mlle de Paranagua, fille de l'ex-premier ministre. Elle me parle de la famille Bernis, ses parents qui habitent Nice. Peu après, la locomotive nous entraîne sur la pente de la montagne d'où nous dominons la plaine et la baie couvertes (p. 068) d'épais nuages que nous atteignons bientôt. À neuf heures et demie le bateau me dépose à Rio. Je me rends au bureau télégraphique pour voir si par hasard quelque dépêche d'Europe m'y attendait. L'agence Havas a ici son bureau; elle perçoit 17,000 reis pour le premier mot et 5,000 reis pour chaque mot suivant. Le bureau anglais perçoit 7,000 reis indistinctement pour chaque mot. Cette Compagnie, au capital de un million et demi de livres sterlings, a une recette d'environ 4,000,000 de francs par an. C'est bien faire ses affaires.
À la Chambre des députés pas de séance, mais plusieurs députés semblent occupés à des travaux et discussions. Grande simplicité dans le monument et le mobilier. Ces députés de l'Empire sont moins exigeants sous ce rapport que ceux de certaines républiques. Ils ne laissent pas quelquefois d'être irascibles. Je lis en effet qu'il y a peu de jours un d'entre eux, qui s'est cru insulté dans les colonnes d'un journal, a voulu se faire justice à coups de canne sur le nez du journaliste. Il est vrai d'ajouter que la presse ne comprend pas toujours sa mission et qu'elle confond trop souvent la licence avec la liberté.
Au bureau de la colonisation, le directeur me remet une carte de la province de San-Paulo et une de la province de Santa-Cattarina, avec un règlement en 5 langues relatif à l'hôtel des immigrants à Rio-Janeiro. J'y lis que les immigrants y sont logés et nourris pendant 8 jours, mais je n'y trouve aucun renseignement sur les conditions auxquelles ils reçoivent les terres et en quelle quantité. (p. 069) Les Yankees sont plus habiles: ils multiplient les prospectus et les programmes avec gravures et toute sorte de détails. On les trouve à tous les hôtels, dans les gares, et on les reçoit dans les trains. Ici je n'ai même pu trouver à la gare un indicateur de chemin de fer. Le chef de gare s'est contenté de me dire que l'horaire et les prix sont collés aux murs de là station; en sorte que je dois aller les consulter toutes les fois que je projette une excursion. C'est peu pratique et surtout peu commode. On pourrait croire que cela tient au peu d'importance des lignes dans un pays nouveau.. Erreur! il y a environ 5,000 kilomètres de chemins de fer en exploitation au Brésil, dont le coût moyen a été d'environ 100,000 fr. le kilomètre; 15,000 autres kilomètres sont en construction ou concédés.
Mais revenons à mes visites. Je traverse la ville vieille et me rends aux quartiers nouveaux, chez le baron de Teffé, chef de division à l'arsenal de marine. M. de Teffé est un officier distingué qui revient de l'expédition organisée pour observer le passage de Vénus. Il me donne sur son travail des détails intéressants: il en envoie les résultats à l'Académie des sciences à Paris, où se réuniront les savants en congrès pour se mettre d'accord sur les conclusions définitives.
M. le baron de Teffé me parle longuement de ses explorations dans l'Amazone, où il a passé deux ans et neuf mois. Il dirigeait la Commission qui devait, avec celle du Pérou, tracer les frontières des deux pays, pendant que (p. 070) deux autres Commissions traçaient celles de la Bolivie. Une première Commission péruvienne avait été anéantie par les Indiens. Son chef, amputé d'une jambe par le fait de cinq flèches empoisonnées, avait survécu et avait eu le courage de se mettre à la tête de la seconde expédition; mais, durant les opérations, il fut enlevé par la fièvre paludéenne. Les rivières débordent et se retirent laissant d'immenses marais mortels.
Les Brésiliens aussi furent très éprouvés. Sur 80 personnes, M. de Teffé en perdit 27 de la fièvre, parmi lesquelles son propre frère. Les Indiens leur causèrent bien des difficultés, mais il avait trouvé moyen d'échapper à leurs flèches en couvrant complètement les canots d'une toile métallique derrière laquelle se tenaient les rameurs.
La Commission rencontra un jour un superbe emplacement qu'avait visité Humbold en 1808. L'illustre explorateur y avait laissé une inscription enthousiaste pour déclarer que c'était là un endroit admirable pour une grande ville, et que dans cinquante ans il serait couvert de maisons et de monuments. Or, M. de Teffé, plus de cinquante ans après, n'y avait encore vu que de l'herbe. La prophétie pourra se réaliser; mais Humbold s'était trompé de date.
De Paris, sur la demande d'un ami, M. de Thurino, illustre Brésilien que j'avais connu à Nice, m'avait envoyé des lettres nombreuses pour ses amis du Brésil, et entre autres une pour son fils. Je me rends donc chez lui, mais, à mon grand étonnement, je trouve le père en personne. (p. 071) Il était arrivé de la veille, et nous pouvons ainsi causer, des choses de l'Europe.

Brésil: Chef indien.
Continuant ma course, j'arrive chez le comte d'Ignassu, chambellan de l'empereur. Il était de service au Palais. Il est frère du comte de Barbacena dont j'ai déjà parlé. Ils appartiennent à la famille des Brants, contraction de Brabant, originaires de la Belgique. Après s'être perpétués sans interruption de mâle en mâle depuis cinq siècles, les deux frères n'ont maintenant chacun qu'une fille. Après ce pèlerinage, lorsque nous nous trouverons réunis dans le sein de Dieu, nous verrons qu'il n'y a qu'une grande famille humaine, dont Adam est l'arrière-grand-père.
(p. 072) Je clos ma série de visites par celle de M. le comte de Paranagua, jusqu'au mois dernier président du Conseil des ministres. Sa maison est celle d'un bourgeois. Heureux pays, où les grands savent donner un si bon exemple! M. de Paranagua comprend le français et parle le portugais, mais si clairement que je ne perds rien de la conversation. Elle roule sur des sujets multiples, et j'admire dans mon interlocuteur l'homme calme, au jugement clairvoyant, aux appréciations bienveillantes: c'est l'homme habitué à la conduite des hommes. Il se rend à San-Paulo pour voir son fils au petit séminaire, et si je puis trouver le temps de faire cette intéressante excursion, il me dirigera dans la visite des choses intéressantes de cette province, la plus avancée de l'Empire, pour l'industrie comme pour l'agriculture.[Table des matières]
Excursion à Copa-Cabana. — Sauvés par un bambin. — Le jardin botanique. — L'Hospicio Don Pedro II. — L'orphelinat de Sainte-Thérèse. — Le Casino Fluminense. — Encore le bureau de colonisation. — Le téléphone. — Le marché. — Les aumônes impériales. — L'Hospicio de la Misericordia.
Le 17 juin, à six heures du matin, le soleil darde ses rayons derrière les montagnes, de l'autre côté de la baie et sur les cimes opposées. La ville au pied de la colline se réveille, et les gens endimanchés se meuvent, dans toutes les directions; je descends à Praja do Framengo, chez M. Duvivier. Sans perdre du temps, nous montons à cheval et nous voilà en route pour Copa-Cabana, où l'aimable banquier veut me montrer le nouveau quartier qu'il va faire surgir en cet endroit. Il est concessionnaire d'un tramway qui aboutit à une plage superbe. Il se propose d'élever dans la mer, sur des poteaux de fer, un magnifique établissement de bains. Je l'informe de la destruction par le feu de la Jetée-promenade de Nice et l'engage à prendre ses précautions. Après une heure de marche au pas et au trot, nous laissons à gauche le cimetière, garni de monuments de marbre, et gravissons une charmante colline que le tramway traversera en tunnel. Au sommet, un docteur, fusil au bras, fait mine de nous (p. 074) barrer le passage; il entend nous conduire chez lui et nous offrir café et vin de Porto. Comme il apprend que nous pressons le retour pour assister à la messe, il nous dit: «Voilà, sur ce rocher là-bas, la chapelle; la messe s'y dit à dix heures, il est neuf heures; vous n'avez que le temps d'arriver.»
Nous descendons donc l'autre pente de la colline et arrivons à la plage, couverte d'un sable fin et blanc qui éblouit nos yeux. Le soleil est brûlant, il faut attirer un peu d'air par la vélocité du galop, et nous voilà galopant, galopant. À dix heures moins cinq minutes nous sommes au pied du rocher, sur lequel les pêcheurs étendent leurs filets. La montée est rude, au point que mon compagnon voit sa selle retomber en arrière. À dix heures nous étions à la chapelle, mais la messe avait été dite à neuf heures. Le docteur, sans doute, n'y était jamais venu. Déjà, en approchant de Rio, j'avais admiré cette gracieuse coupole couronnant le rocher en dehors de la baie; jamais je n'aurais pensé qu'un jour je me trouverais sur la terrasse de ce petit monument. La vue en est excessivement gracieuse; les lames de l'Océan se brisent à ses pieds et on a en face un îlot sur lequel un ingénieur français élève un phare électrique. Mais l'heure avancée nous laisse peu de temps pour la contemplation. Nous saluons deux amazones et leur cavalier qui nous avaient rejoints, et, pour éviter le sable brûlant, nous nous engageons à gauche dans une petite forêt, avec l'espoir aussi d'abréger la route par une diagonale. Mal nous en prit, (p. 075) car, une demi-heure après, ayant perdu le sentier, nous nous trouvons engagés dans les broussailles, sans issue. Les branches menacent nos corps et nos têtes; les chevaux eux-mêmes ne peuvent avancer qu'avec peine. Forcés de descendre et de les conduire à la main, nous errons par des tours et détours, revenant sur nos pas, et nous engageant dans toutes les directions, lorsque enfin, en percevant au loin le toit d'une maison, M. Duvivier pousse à pleins poumons ce cri: O di casa. Une voix répond, mais on ne voit personne. À la fin, un enfant de sept ans paraît, et nous reconduit jusqu'au chemin. Sauvés par un bambin!

Rio-de-Janeiro. Avenue des Palmiers au Jardin botanique.
Nous aurions eu envie de fouetter le docteur, mais le temps pressait et un galop effréné nous conduit bientôt à Praja de Buttafogo. M. Duvivier trouve prudent de ne plus affronter le soleil et laisse les chevaux, dans une écurie pour prendre le tramway. À midi nous rentrions chez lui; un bain froid restaure les membres et un bon déjeuner redonne des forces. Mme Duvivier fait les honneurs de la maison avec (p. 076) grâce et simplicité. On fait un peu de récréation avec ses quatre charmants bébés, puis M. Duvivier prend le chemin de la ville pendant que, dans la direction opposée, je me rends à l'Orto botanico.
Après une heure de bond sur une route pittoresque j'arrive à ce superbe jardin. Une allée de palmea gigantea s'étend jusqu'au pied de la montagne. Ces véritables géants portent leur plumet à 30 mètres dans les airs; ils n'ont que le défaut d'être trop hauts. Le vert gazon qu'on appelle ici grama forme partout une gracieuse pelouse sur laquelle s'élèvent par-ci par-là des bouquets de bambou, des espèces de joucas dont les feuilles tournent autour du tronc en forme de spirales; des bouquets de palmiers variés, parmi lesquels je remarque le palmier bambou et une espèce de palmier qui laisse tomber du tronc des racines qui, venant se souder au sol tout autour forment comme une rangée de pieux qui l'étayent. Parmi les géants, je compte le jacquier, le manguier, l'araucaria et bien d'autres dont j'ignore les noms. Je vois par-ci par-là de gracieuses pièces d'eau, et j'arrive à une charmante petite cascade à plusieurs étages, ombragée par des géants séculaires. Là-dessous sont disposés des bancs et des tables de pierre sur lesquelles diverses familles étendent des journaux en guise de nappe et distribuent la nourriture à de joyeux enfants. Excellent usage que celui des piques-niques à la campagne, mais je doute que le jardin botanique, si admirablement disposé pour cela, soit accessible au grand nombre. Il faut environ deux (p. 077) heures pour l'atteindre en tramway, et le prix est de 400 reis (1 fr.) pour l'aller et autant pour le retour. Une famille de 10 personnes aura donc à dépenser 20 fr. seulement pour le transport. Il est bien vrai que l'ouvrier est, ici, dans l'aisance, puisqu'il gagne de 7 à 8 fr. par jour, mais les nombreuses familles absorbent facilement ce gain dans la nourriture, le logement et le vêtement. C'est pourtant la famille ouvrière qui a le plus besoin de respirer, le dimanche, l'air des champs; de ranimer ses forces à l'atmosphère pure, de relever son esprit et son cœur aux beautés de la nature.
En face du jardin, une grande affiche, avec le mot Restaurant, me fait croire que j'y trouverai patron ou domestique français; pas un ne parle cette langue, et j'ai recours à mon mauvais portugais. À l'ombre des manguiers, sur une grande table, des mets variés sont étalés: un mécanisme en forme d'horloge fait tourner deux grandes ailes qui, se promenant au-dessus des plats, en chassent les mouches. Je goûte la bière du pays; elle ressemble bien plutôt au cidre de Normandie. Enfin le bond arrive et me ramène à Buttafogo, d'où je gagne l'hospice don Pedro II.
Cette immense construction a été commencée en 1841, et forme un véritable palais, plus somptueux que celui de l'empereur. C'est la royauté du pauvre, du malheureux, qui se trouve ainsi honorée, c'est de l'ordre chrétien. L'établissement est en effet destiné à la plus grande des misères qui affligent l'humanité: c'est l'hôpital des fous. (p. 078) Il a la forme d'un immense carré coupé en deux par la chapelle; à gauche sont les hommes, à droite les femmes. Les malades tranquilles occupent le premier étage; les furieux, le rez-de-chaussée. Dans le grand salon, je vois la statue de l'empereur Pedro II, protecteur de l'établissement: il a à sa droite le buste de José Clément Pereira, et à sa gauche celui de Ivan de Boles Pinto, les deux promoteurs de l'institution. Il y a aussi celui du commendator Thomé Rivero de Farias, qui a donné le terrain. On ne saurait jamais assez honorer la mémoire de ces hommes qui mettent leur fortune et leur activité au service de leurs frères malheureux; ils sont les instruments fidèles de la bonté du Père céleste, qui a créé le riche pour qu'il soit le serviteur du pauvre. Vingt-deux Sœurs de Charité prennent soin de l'établissement, et la cornette se tire d'affaire, même avec les fous. Le Père Henh, lazariste, survient avec le supérieur du petit séminaire de la ville de San-Paulo, et nous formons ainsi: une petite caravane pour parcourir les différentes salles.
Partout grande élévation des plafonds, aération parfaite; aussi, malgré la haute température, on ne sent ici aucune de ces odeurs fétides habituelles aux établissements de cette nature. La maison abrite environ 400 malades; les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes; mais, par contre, celles-ci, de l'aveu des Sœurs, donnent plus de fil à retordre. Il y a 15 pensionnaires de première classe, logés en chambre; ils payent 5,000 reis (p. 079) par jour (10 à 12 fr.); 24 sont dans la deuxième catégorie, et payent une pension de 3,000 reis par jour; 40 de la troisième catégorie donnent une pension de 2,500 reis; le reste est gratuit. Dans la première et la deuxième classe on compte des personnes distinguées. Dans ce siècle de la vapeur et de l'électricité, bien des cervelles sont emportées par le mouvement trop rapide de la vie.
Les bonnes Sœurs se livrent à des études comparatives entre les folies des diverses nationalités, car il y a ici des gens de tous les pays. Pour confirmer leur dire, elles nous appellent tantôt un Allemand, tantôt un Français, tantôt un Portugais ou un Brésilien, et toujours l'examen de l'individu donne raison à leurs observations. Le Brésilien a la folie douce; le Français, furieux ou gai, fait volontiers de l'esprit; celui que nous interrogeons se dit Jonathas: Vous aimez donc le miel? lui dis-je; et il répond: J'aime l'abeille, elle est discrète et gracieuse ... et ainsi de suite. L'Anglais est morne; l'Allemand, têtu, et l'Italien déclame: celui qu'on me présente est Génois, il préfère me demander des sous pour acheter des cigares. L'Espagnol est méchant, et le nègre insolent.
À la chapelle, de beaux chandeliers et candélabres exécutés par les fous ornent l'autel; dans le compartiment des femmes une salle d'exposition contient des fleurs artificielles et des broderies exécutées par les folles et vendues au profit de l'œuvre. La maison vit de dons et de legs, et quatre loteries annuelles complètent les sommes nécessaires à son entretien.
(p. 080) Les Sœurs élèvent là 40 orphelines qui sont employées comme domestiques dans la maison. Nous passons à la cuisine. Au réfectoire nous trouvons les bols prêts à recevoir le thé. L'ordinaire est ainsi composé: à sept heures, café; à midi et demi, dîner avec mets variés et viande fraîche cinq fois par semaine; à cinq heures et demie, le thé. La pharmacie, les douches, les bains sont des modèles d'ordre. Chez les femmes, une vieille Espagnole, couronne en tête, se croit l'impératrice et nous aborde avec une grande dignité; mais, au rez-de-chaussée, les pauvres furieux inspirent des sentiments de profonde pitié. Le P. Henh réunit les Sœurs, heureuses de voir un compatriote porter intérêt à leurs œuvres. Je quitte ce séjour de la douleur pour me rendre, un peu plus loin, au Recoglimento das orphas de la Santa Casa, connu aussi sous le nom d'orphelinat de Sainte-Thérèse. Cet établissement, confié aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul, est sous la direction de l'administration de l'hôpital de la Miséricorde. Il est richement doté et contient 200 orphelines de toute nationalité. Ne sont admises que les orphelines de père, et nées d'unions légitimes. Lorsqu'elles sont majeures, on les marie avec une dot de 2,500 fr. et un trousseau confectionné par elles. La maison n'a qu'un rez-de-chaussée; elle est vaste et bien aérée. J'y vois une grotte de Lourdes, une belle chapelle et un petit théâtre: la récréation est, aussi bien que la prière, un besoin de la nature humaine. Là encore les bonnes Sœurs se livrent à des études sur les (p. 081) caractères des diverses nationalités: les Brésiliennes et Portugaises aiment la danse; les Espagnoles excellent dans les castagnettes; les Anglaises sont masculines; les Italiennes aiment la poésie; les Françaises, la coquetterie; les Allemandes sont entêtées; les négresses orgueilleuses. Nous parcourons les classes, et les élèves, croyant me saluer en français, me disent: Bonjour, Señor; d'autres, plus habiles, disent: Bonjour, Seigneur. Sur toutes ces jeunes figures de toutes les nuances, on lit la joie, la paix, le contentement. Déjà, j'avais visité les établissements des Sœurs sous tous les climats. En Orient, les Arabes les appellent les filles du ciel; et la joie, la paix et le contentement sont en effet des fruits du ciel.
Qui est l'étranger qui nous fait l'honneur de nous visiter? demande la supérieure. C'est Michel, répondis-je. Pressé par le temps, je les laisse à deviner qui peut bien être cet étrange Michel et me sauve à l'hôtel Vista Allegre, où j'arrive après deux heures, bien avant dans la nuit.
Le lendemain fatigué de l'excursion et du soleil de la veille, je reste à l'hôtel pour écrire aux amis et rédiger mon journal de voyage. Le 19 juin, je rends visite à M. Galvao, directeur de l'École polytechnique. Cette école réunit environ 300 élèves, mais l'École de droit en a 700 et celle de médecine 1,000. Clients, sur vos gardes! Il y a une seconde école de droit à San-Paulo. Les pays gouvernés par les avocats en général ont peu prospéré.
Je vais prendre congé de M. Netto, directeur du musée; (p. 082) il veut bien accepter d'envoyer quelques objets à la fête projetée par la Société de géographie de Lyon. Avec beaucoup d'amabilité, il m'offre de m'envoyer quelques-uns de ses écrits que j'échangerai avec mes récits de voyage.
Enfin, je remplis un devoir en allant remercier le vicomte de Buon Ritiro pour toutes les bontés dont il m'a comblé. Il demeure à la campagne, à 2 lieues de la ville; la route est pittoresque, et son gentil pavillon est caché dans un bouquet d'arbres et de bambous, sur un des monticules du quartier Ingenio nuovo. Il est à dîner, mais l'étranger ne fera pas antichambre. À peine annoncé, il est introduit et admis à la table de famille, où il reste le temps nécessaire pour exprimer ses remerciements. Pour ne pas abuser, je me retire, encore une fois charmé de la bonté et de la simplicité des grands de ce pays.
Le soir, à sept heures, je redescends la colline de Santa-Theresa pour assister à une réunion de charité. J'y trouve des professeurs, des conseillers de la Couronne, des avocats, des hommes du monde. On m'apprend l'existence d'une association de dames de charité pour la visite des pauvres. Je leur indique le précieux concours que ces associations, en France, trouvent dans les Sœurs de Charité; j'engage ces messieurs à organiser un cercle de jeunes gens; ils portent au bien l'ardeur de leur âge, et si on néglige de les diriger vers le bon côté, ils plieront vers le mal. Leur activité ne pourrait rester (p. 083) sans emploi. M. Galvao me présente à M. Lopo Denis et Cardeiro: ce monsieur est un des administrateurs du Casino Fluminense, et veut me faire visiter ce magnifique établissement. Il me montre avec enthousiasme les lambris dorés de la grande salle de bal, les nombreuses glaces, les appartements pour la toilette de l'impératrice et de ses dames, et celui destiné à l'empereur. Il me fait remarquer quatre grandes amphores, pour les rafraîchissements, qui ont coûté 15,000 fr. Ce cercle, le plus important de Rio, appartient à une Société d'actionnaires; les actions sont d'un conto de reis ou million de reis, soit 2,500 fr. On est reçu sur présentation et moyennant 120 fr. l'an. L'administration organise quatre bals dans l'année; toute la société distinguée du Brésil y assiste, et la famille impériale ne manque jamais d'y venir. Le 29 nous avons le bal d'hiver, me dit M. Lopo, je serai heureux de vous donner une carte d'invitation; vous pourrez ainsi voir réunie toute notre noblesse. Je remercie M. Lopo, mais obligé de continuer ma route, je ne pourrai profiter de son invitation. L'administration du casino met son superbe local à la disposition des œuvres charitables. Tous les ans, environ douze concerts de charité ont lieu dans ses vastes salons. M. Lopo est président du Jockey-Club et voudrait me voir assister aux prochaines courses; mais j'ai moi-même une course bien longue qui m'empêche de trop m'arrêter dans chaque ville.
Me disposant au départ, je prends des renseignements auprès des diverses compagnies de bateaux à vapeur qui (p. 084) vont à Montevideo. Les Messageries maritimes et le Pacific Steam Co refusent de prendre des passagers pour cette destination: elles pensent ainsi éviter la quarantaine. La Compagnie brésilienne n'a que de petits navires, qui font escale à tous les ports du littoral, et mettent dix jours dans le trajet; mais la Royal-Mail de Southampton a un navire qui doit toucher à Santos le 27, et je me dispose à gagner ce port qui, cette année, a été exempt de la fièvre jaune. Cette combinaison me permettra de visiter en route une fazzenda de sucre et une de café, de parcourir 700 kilomètres dans l'intérieur et de voir la ville de San-Paulo. Je ne veux pas quitter Rio sans voir le marché et l'Hospicio de la Misericordia, et sans essayer d'avoir encore des renseignements plus précis sur la colonisation. J'étais déjà allé au bureau de renseignements das terras sans y avoir appris grand'chose. M. Duvivier me fait observer que je me suis présenté sans lettre de recommandation; il m'en procure une par un de ses amis et me fait espérer meilleure réussite: or, il advint que la lettre était pour un employé et non pour l'inspecteur. Celui-ci déclare que, ne lui étant pas adressée, il ne peut l'ouvrir, se montre un peu étonné de ma nouvelle démarche, et dit qu'il n'a pas d'autre renseignement à me donner. Sur mon insistance et mes interrogations, il m'apprend qu'on vend aux immigrants de 30 à 60 hectares de terre au prix de 2 reis la brasse carrée (un peu plus de 4 mètres carrés) et qu'ils le paient par cinq acomptes égaux dans les cinq ans qui suivent les deux (p. 085) premières années, pendant lesquelles ils ne paient rien. Ils peuvent se libérer avant ce temps, et aussitôt le prix payé, ils sont propriétaires définitifs. Ils peuvent demander la naturalisation. Dans ce cas, ils acquièrent les droits politiques et sont éligibles et électeurs lorsqu'ils possèdent une rente de 200 fr. et qu'ils savent lire et écrire. Ils peuvent aussi garder leur nationalité, et leurs enfants nés ici sont traités sur le pied de la réciprocité de leur nation.
Comme j'insiste pour avoir un manuel ou traité indiquant ces choses, il me fait remettre un opuscule imprimé en 1865, ayant soin d'ajouter que son contenu a subi de nombreuses modifications. Ce bureau serait mieux nommé le bureau de non-renseignement. Aux États-Unis l'immigrant trouve à ce bureau, non seulement les brochures, mais toutes les explications verbales qu'il désire, avec les échantillons des blés, maïs, soie, vins, grains, etc. Lorsqu'il désire aller visiter les terres, les compagnies de chemins de fer lui donnent un billet gratuit pour l'aller et il n'aura que le retour à payer. Rien donc d'étonnant que l'immigration, qui, aux États-Unis, s'élève déjà à 7 ou 800,000 immigrants par an, se chiffre à peine ici par une moyenne annuelle de 27,000 colons, desquels il faut défalquer les départs. Mais aux États-Unis, le plus souvent l'immigration est provoquée par des compagnies qui ont des terres à la suite de concessions de chemins de fer. Pour vendre ces terres et rendre le chemin de fer productif, elles ont intérêt à faire connaître (p. 086) les richesses à exploiter, pendant qu'ici le soin de l'immigration est confié au gouvernement. Celui-ci n'aura jamais l'énergie et l'activité de l'intérêt privé.
M. Duvivier me conduit encore au bureau central d'une seconde compagnie de téléphones dont il est membre. Elle ne fonctionne que depuis trois mois, et déjà elle a plus de 300 abonnés. Quatre employés sont occupés à joindre les fils selon les demandes: ils parlent à voix presque basse, car, obligés de parler du matin au soir, ils ont besoin de ménager leurs poumons.
Au marché je remarque presque tous les fruits et légumes de l'Europe, à côté des fruits et légumes de la zone tropicale. Les légumes sont un peu plus chers que chez nous; la viande fraîche coûte 1 fr. le kilo, la viande salée des pampas 1 fr. 25, mais elle est sans os; en cuisant elle augmente en volume. Un poulet se vend 1 fr. 50, une poule 3 à 4 fr., les œufs 2 fr. la douzaine.
En passant devant le palais de l'empereur, je vois un attroupement de pauvres; on me dit que c'est le jour de la distribution des aumônes. L'empereur, non seulement fait une large distribution chaque mois, mais il fait étudier à ses frais des garçons intelligents appartenant aux familles nombreuses: une personne bien renseignée m'assure qu'il dépense ainsi en bienfaits 500,000 fr. par an: le quart de sa dotation. Puisse l'exemple être suivi par tous les souverains! Il y aurait moins de nihilistes!
Désireux d'emporter une collection de photographies de ce pays, je parcours un grand nombre de magasins, (p. 087) mais elles sont rares, chères et d'une exécution qui laisse à désirer. Les Japonais ont fait plus de chemin dans cet art.
Enfin j'arrive à l'Hospicio de la Misericordia. C'est un riche et vaste palais, à côté duquel ceux de l'empereur disparaissent. Il a 500 pieds de long et quatre ailes parallèles de même longueur, séparées par jardins et cours Il n'a qu'un étage sur rez-de-chaussée, mais la hauteur des plafonds est au moins de 7 mètres: aussi l'aération est parfaite et on ne sent pas l'odeur d'hôpital.
Soixante Sœurs françaises de Saint-Vincent de Paul servent les 1,200 malades de l'établissement et distribuent en outre journellement, sur recette du médecin, des médicaments à environ 600 personnes qui viennent du dehors.
Sous le vaste porche, je remarque la statue des deux Pères jésuites fondateurs de l'œuvre. Je parcours les vastes salles, les cuisines, la pharmacie, les lingeries. Partout propreté et ordre parfait. J'aurais voulu voir les malades de la fièvre jaune, mais ils ne sont pas là. Pour éviter la contagion, on envoie les fiévreux dans un établissement spécial au-delà de la baie. Cette année, les cas ont été nombreux au fort de l'été (décembre et janvier); ils dépassaient cent par jour et presque tous étaient mortels. Les étrangers y sont plus sujets que les autres, spécialement les natures fortes des Portugais et des Italiens. Cette horrible maladie, importée de l'Amérique centrale, est connue ici sous le nom de febbre amarilla, (p. 088) ou vomito negro. Elle consiste en un empoisonnement du sang qui se traduit souvent par des vomissements et des selles noirâtres: on en meurt au bout de quelques jours. Si on traverse le septième jour, on peut en guérir; on la soigne ou par la glace, qui arrête le vomissement, ou par les sudorifiques et les purgatifs.
Je crois que le jour viendra où chez toutes les nations on comprendra la nécessité de ne plus parquer les malades dans les vastes salles d'immenses établissements où ils s'empoisonnent mutuellement.
Le système allemand de les placer à la campagne au milieu des arbres, de séparer les maladies par maisons isolées, et les degrés de la même maladie par des chambres contenant au plus quatre malades, a donné d'excellents résultats: le nombre des guérisons est bien plus considérable que dans les anciens hôpitaux, et déjà il est imité avec succès au Japon et aux Indes orientales.[Table des matières]
Départ pour l'intérieur. — L'esclavage. — La filature de Macaco. — La plantation de D. Pedro Paes-Leme. — Son usine à sucre. — Une famille heureuse. — J'arrive à Barra do Pirahy. — La fazenda de café du baron de Rio Bonito. — La forêt vierge. — La plantation des caféiers. — Cueillette du café. — Préparation. — Coût de production et prix de vente. — Les 800 esclaves. — Les fauves et le gibier.
Je devais dans l'intérieur visiter les fazendas de M. Pedro Paes-Leme à Bélem et du baron de Rio Bonito à Barra do Pirahy. Après le dîner, je boucle mes malles et recommande au garçon de ne pas manquer de m'éveiller le matin pour que j'arrive à la station pour le train de 7 heures. Au milieu de la nuit, il frappe à ma porte en me disant: «Le coq a chanté et il fait clair.» C'était le clair de lune, et je l'envoie dormir. Je dors moi-même encore quelques heures, et à 7 heures je suis à la gare du chemin de fer D. Pedro II. Le matériel a été construit par les Américains du Nord, et il me semble voyager sur une ligne de New-York.
Je suis heureux de retrouver ici M. Bonjean, qui se rend à son usine de Macaco: il me présente M. Oliveira, un des trois propriétaires de l'usine. Chemin faisant, la conversation tombe sur la question de l'esclavage. La loi de 1871, qui a déclaré libre tout enfant né d'un esclave, en a (p. 090) diminué le nombre de 300,000 jusqu'à ce jour, soit par les décès, soit par l'affranchissement volontaire ou le rachat au moyen des fonds établis par la susdite loi. L'empereur et les communautés ont affranchi 9,000 esclaves; les particuliers, 70,000. Il en reste encore environ 1,300,000, et on voudrait voir la besogne marcher un peu plus vite. Le parti libéral verrait volontiers la mise en liberté immédiate de tous les esclaves avec ou sans indemnité pour les propriétaires. Le parti conservateur désire voir cesser au plus tôt l'esclavage, mais il croit atteindre le but en améliorant simplement la loi de 1871. De par cette loi, tout esclave qui n'a pas été déclaré devient libre. On recherche les omissions de déclaration et on espère arriver ainsi à en délivrer une centaine de mille. Peut-être augmentera-t-on la capitation ou impôt sur chaque tête d'esclave; cela déprécierait la marchandise et faciliterait le rachat. Entre les impatients et les attardés, les sages trouveront le juste milieu pour faire cesser cette plaie hideuse sans causer trop de perturbation et en ménageant une heureuse transition au travail libre.
M. Oliveira me parle aussi d'un essai de colonisation qu'il fait dans la province de Santa-Catharina, sur les terres du comte d'Eu. Les colons, en arrivant, y trouvent leur petite maison et reçoivent assez de terres pour faire de brillantes affaires: ils appellent alors leurs parents et leurs amis, et la propagande se fait d'elle-même. Pour que l'émigrant quitte volontiers son pays natal, il faut: (p. 091) qu'il puisse se dire: un tel que je connais a fait dans tel pays sa fortune, j'y ferai aussi la mienne.
Tout en causant, nous arrivons vers neuf heures et demie à Bélem. Là, un nègre se présente au nom de M. Paes-Leme, pour m'annoncer que la voiture qui doit me conduire chez lui est à la gare; mais MM. Bonjean et Oliveira désirent me faire visiter leur belle usine de Macaco. Je renvoie donc la voiture, déclarant que dans deux heures j'arriverai dans la fazenda, à cheval, à travers champs. À Macaco, M. Bonjean me présente à un ingénieur français qui dirige, dans les environs, une fabrique de dynamite; Cette dangereuse matière est employée, ici pour faire sauter la roche dans la construction des voies ferrées. Deux charmants enfants, arrivés depuis quatre mois de Paris, semblent regretter les boulevards. Des vendeurs nous offrent de beaux poissons; ils sont ici si nombreux, qu'au dire d'un mécanicien, on les tue parfois à coups de bâton, et on en détruit un grand nombre par la dynamite. L'homme abuse des biens qu'il a en abondance. Le chemin de fer de Bélem à Macaco a été construit par les propriétaires de l'usine, et ils l'ont donné ensuite au gouvernement, qui l'exploite. Nous montons sur la locomotive pour franchir le petit trajet entre la gare et l'usine, et bientôt nous sommes en face d'une immense construction en briques, à rez-de-chaussée et 3 étages, ayant une longueur de 130 mètres sur 15 mètres de large. Deux tours coupent gracieusement la façade. Au rez-de-chaussée sont les magasins, les ateliers, (p. 092) les batteuses et les cardeuses; au premier, les fileuses à machine automatique, dernier modèle; aux deuxième et troisième fonctionnent 450 métiers à tisser, dont les plus rapides battent jusqu'à 120 coups à la minute. Les métiers seront bientôt portés au nombre de 600. Le Brésil consomme annuellement pour 125 millions de francs de tissus de coton, et les 40 fabriques du pays en produisent à peine pour 15 millions de francs; il y aura encore, pour de longues années, beaucoup d'argent à gagner sur ce produit protégé par les droits de douane.
L'usine de Macaco, qui est la plus importante du Brésil, produit en ce moment 15,000 mètres de toile par jour, d'une valeur d'environ 8,000 fr. Les 450 ouvriers sont payés partie à la journée, partie à la tâche, et gagnent de 3 à 8 fr. par jour. Les femmes s'acquittent plus délicatement du tissage et filage; aussi tendent-elles peu à peu à remplacer les hommes. Le mouvement est donné à cet ensemble de machines par une chute d'eau de 78 mètres sur des turbines. Deux machines à vapeur fonctionnent comme supplément. Les propriétaires de l'établissement, comprenant leur devoir de paternité sociale, prennent soin de leurs ouvriers et ouvrières. Les sexes, autant que possible, sont séparés, et on donne à l'ouvrier, non loin de l'usine, un petit lot de terrain sur lequel il construit sa case, et où la famille cultive les fruits, les fleurs, les légumes. M. Bonjean veut bien s'inscrire à l'Union de la paix sociale et enverra à la Revue la monographie de l'usine de Macaco.
(p. 093) En sortant de l'usine, je trouve un cheval sellé, bridé, et accompagné d'un cavalier mulâtre: je trotte à travers champs et forêts pour arriver chez M. Paes-Leme. Les collines sont pittoresques, la forêt vierge toujours admirable. Après une heure de marche, nous arrivons dans une plaine couverte d'une espèce de roseau sauvage qu'on appelle matto; il est si élevé dans ce terrain marécageux, que le cheval disparaît littéralement, et c'est à peine si nos têtes surnagent. C'est avec difficulté que nous avançons dans ce fourré, et, après une demi-heure de cette épreuve, nous nous trouvons en pleins champs de cannes à sucre. À midi et demi je descends devant la porte de Don Pedro Paes-Leme.
Ce gentilhomme s'occupe depuis longtemps d'agriculture; il a été délégué du gouvernement à l'exposition universelle de Philadelphie. Il a parcouru en observateur les États-Unis et a tiré de ses voyages grand profit pour lui et pour son pays. Il me reçoit avec bonté, et me présente à sa jeune dame et à sa gentille famille, composée d'un garçon de sept ans et de 3 jeunes filles. Après le déjeuner il me conduit à la visite de la fazenda, c'est le nom qu'on donne ici aux propriétés ou fermes. Celle-ci comprend 800 hectares, la plupart plantés de cannes à sucre. C'est par boutures couchées dans la terre qu'on la propage: après 18 mois elle produit un plumet, elle est mûre; alors on la coupe, mais elle repousse et on la coupe une seconde fois après 8 mois; elle repousse encore et on la coupe une dernière fois après 8 autres (p. 094) mois. Après 3 coupes on laboure la terre avec des charrues américaines et on la plante à nouveau. 70 personnes suffisent à D. Paes-Leme pour cultiver sa terre. Sur ce nombre, 20 seulement sont esclaves, les autres sont des familles de cultivateurs lombards ou vénitiens, ou des Chinois qui cultivent librement aux conditions suivantes: le propriétaire fournit la terre nécessaire; une famille peut cultiver de 4 à 5 hectares: ce qu'elle produit de maïs, fruits, grains, légumes, est sa propriété; la canne à sucre est vendue au propriétaire, qui la paie à raison de 5,000 reis (10 à 12 fr.) la tonne. Un hectare de canne à sucre donne environ 100 tonnes par an. Ainsi une famille peut gagner 4 à 5,000 fr. l'an et vivre bien plus à l'aise que sur les terres d'Italie surchargées d'impôts.
Le prix des terres à cannes est d'environ 600 fr. l'hectare. La canne donne de 6 à 7% de sucre; ainsi, il faut 100 tonnes de cannes pour extraire 6 à 7 tonnes de sucre. M. Paes-Leme produit une moyenne de 150 tonnes de sucre raffiné par an, mais il se propose de construire une nouvelle et grande usine et de multiplier ses plantations avec le travail libre. Il compte bientôt donner la liberté à ses derniers esclaves, qui la désirent de grand cœur et qui la recevront avec reconnaissance.
Nous visitons l'usine actuelle; le mouvement est donné par une roue hydraulique: elle fait tourner des cylindres entre lesquels la canne est broyée et laisse tomber son jus. Celui-ci passe dans des chaudières, où il laisse évaporer la partie aqueuse au moyen de l'ébullition; le (p. 095) sirop se cristallise et se blanchit par le soufre et la chaux, et se sèche à la turbine. Tous les jours, des machines perfectionnées arrivent d'Europe et des États-Unis.
Dans le beau verger qui entoure la maison, M. Paes-Leme cueille des oranges de qualités multiples: il y en a de plus grosses que l'espèce de Jaffa. Il me fait remarquer et goûter des fruits nouveaux pour moi: le cambuca et l'abuticaba, deux fruits noirs et parfumés; le caju, espèce de figue portant au bout une sorte de châtaigne; le caranbola, gousse blanchâtre ayant le goût de l'ananas, et l'abiu, sorte de caki du Japon. Il me fait remarquer deux espèces de manioc: le doux, qui est inoffensif, et l'autre espèce qui, mangé frais, est toxique.
Enfin nous retournons à la maison pour la collation. Des fruits de toute sorte couvrent la table, mais le plus bel ornement sont les personnes. Les enfants viennent d'achever leur leçon de chant et de musique; ils entourent avec amour leurs parents, qui les voient grandir avec bonheur. La vie à la campagne, avec identité de goût dans les époux, le temps partagé entre les travaux de l'esprit et celui des champs, les soins de nombreux enfants, et le dévouement au personnel d'exploitation, telle m'a toujours paru la meilleure condition pour obtenir la plus haute dose de bonheur ici-bas. La famille Paes-Leme a réuni ces conditions.
Mais le temps marche et la voiture est à la porte. C'est une espèce de tarantas russe suspendue sur de longues lattes de bois: le pas du train est très long et les roues (p. 096) posées à grande distance; ces précautions sont nécessaires pour éviter de tourner dans ces chemins qui n'en sont pas. Je prends congé de l'aimable dame et des gracieux enfants, et nous voilà en route avec M. Paes-Leme et le professeur de musique. Après une demi-heure, nous arrivons à l'endroit de la propriété cultivée par les Chinois: ils sont six, venus de Cuba; ils n'ont pas ici, comme en Californie, la queue légendaire et le costume national; ils sont habillés en Brésiliens, et on ne les distingue qu'à leur teint jaune et à leurs yeux en amande. Un d'eux est malade dans sa case. M. Paes-Leme ordonne aussitôt les remèdes nécessaires. Nous quittons là ce bon propriétaire, et la voiture, suivant sa route, nous dépose une heure après à la station de Bélem. Chemin faisant, le professeur de musique me fait remarquer des passants au teint rougeâtre. Ce sont des Indiens ou descendants d'Indiens, aborigènes du pays. À mes questions sur sa profession, il répond qu'il donne environ 10 leçons par jour au prix de 3,000 reis la leçon (10 à 12 fr.), et que la leçon chez M. Paes-Leme lui est payée 35,000 reis, environ 80 fr. Il gagne ainsi de 30 à 40,000 fr. l'an, plus que nos bacheliers de France.
Enfin, à six heures le train arrive, et après deux heures et demie d'ascension dans les montagnes de la Serra, il me dépose à la station de Barra do Pirahy. Là, un jeune monsieur, teneur de livres chez le baron de Rio Bonito m'attendait: il fait charger mes bagages, et trois quarts d'heure après, la voiture nous dépose à la fazenda. Le baron (p. 097) ne s'y trouve pas en ce moment, mais il a télégraphié à son fils, et celui-ci me reçoit à la manière des grands seigneurs. Bientôt un copieux souper est servi, puis on cause de chose, et d'autres avec les quelques visiteurs qui sont déjà à la fazenda, et à onze heures on va au repos.
Le lendemain matin, à sept heures, les chevaux sont sellés. M. de Rio Bonito monte une belle mule de 3,000 fr. Avec une pareille bête, me dit-il, on peut facilement voyager plusieurs jours à 60 kilomètres par jour. Je monte un cheval fringant d'égale valeur; un vaillant piqueur, dompteur d'ânes sauvages, ouvre la marche; un Corse employé à la fazenda forme l'arrière-garde. Durant deux heures nous parcourons le flanc des collines plantées de café, parsemées d'orangers, de limiers, de bananiers, d'ananas et de maïs; puis nous arrivons à la forêt vierge, avec ses inextricables lianes. Les ouvriers viennent d'achever l'abattage d'une partie et sont en train de la planter. Voici comment ils procèdent: les arbres de haute futaie sont coupés, équarris et mis à part pour la construction; le reste est coupé et brûlé sur place; ce que le feu ne peut consumer pourrit lentement et engraisse la terre. Sur le terrain ainsi préparé, un esclave intelligent trace au cordeau et marque par des piquets les points où seront posés les plants: ils sont distancés d'environ 16 pieds. Cinq autres esclaves suivent et enfoncent les jeunes plants enlevés au pied des anciens buissons. Trois ans après, le caféier commence à donner sa première récolte; à 7 ou 8 ans, il atteint sa plus grande vigueur, et (p. 098) ne s'épuise qu'au bout de 20 à 25 ans, selon les terres et les soins. Alors il perd sa feuille et meurt; nos vieillards aussi laissent tomber leur chevelure au déclin de la vie. Lorsqu'une terre est épuisée, on laisse de nouveau repousser la forêt durant 25 ans, ensuite on la coupe et on replante.
Le buisson de café est à feuille verte et persistante, de l'épaisseur et grosseur des feuilles moyennes du mûrier; il atteint ici la hauteur de 2 à 3 mètres, mais, dans la province de San-Paulo, il prend les proportions d'un arbre, et produit le double. Le caféier donne tous les ans quantité de petites billes vertes qui, en mûrissant, deviennent rouges et de la grosseur des cerises. Les esclaves les ramassent durant 6 mois, les mettent en paniers, puis sur des chars qui les portent à l'usine. Par-ci par-là nous voyons des hangars où ils préparent les aliments et s'abritent de la pluie, puis des dortoirs où ils couchent pendant la semaine, afin d'éviter l'aller et le venir, parfois fort éloigné de la maison.
La première chose pour défricher la forêt vierge, c'est d'y construire un chemin de 3 mètres de large, afin de pouvoir l'atteindre avec les chars; la construction de ces chemins est donnée à forfait aux Portugais, qui les font au prix de 2,200 reis le mètre ct (environ 5 fr.). Les mesures de surface sont ici la sesmaria (ou demi-lieue carrée). La lieue, au Brésil, est de 6 kilomètres, ce qui forme un carré ayant 1,500 brasses de côté. La brasse carrée équivaut à 4m85 c. et la brasse linéaire à un peu plus de (p. 099) 2 mètres linéaires. La sesmaria se compose de 225 alqueires ou carrés ayant 100 brasses de côté. Dans la province de San-Paulo les mêmes mesures équivalent à la moitié de celles de Rio-de-Janeiro. La forêt vierge vaut environ 225 contos de reis la sesmaria; le conto de reis, soit 1,000,000 de reis, équivaut à 2,500 fr.
Voici le coût du défrichement de la forêt vierge: un planteur peut aligner 50 pieds de café par jour. L'alqueire contient 3,000 pieds; il faut donc 60 journées pour planter un alqueire à 1,500 reis ou 3 fr. par jour, y compris
| la nourriture | 90,000 | reis. |
| Pour marquer le terrain qui doit recevoir les plants | 20,000 | |
| Abattre le bois, brûler le matto (herbe sauvage) | 80,000 | |
| ——— | ||
| 190,000 | reis, |
soit environ 400 fr. l'alqueire de 4 hectares, ou 100 fr. l'hectare. Plus le coût des chemins.
Les 3 fazendas du baron de Rio Bonito, contiguës l'une à l'autre et actuellement gérées par son fils, comprennent environ 6 sesmarias, soit 60,000 hectares. Le fils vient d'en acheter une d'une sesmaria pour son compte, il l'a payée 500 contos de reis, soit 1,250,000 fr.
On calcule que le coût de production du café est, pour la main-d'œuvre (il faut le labourer à la pioche 3 fois l'année) de 3,000 reis, soit 7 fr. pour chaque aroba de 15 kilog.; le transport à Rio est de 400 reis, et le droit dû (p. 100) au commissionnaire, à Rio, de 3%, soit 300 reis. En tout, 3,700 reis l'aroba, soit 8 à 9 fr. les 15 kilos. On le vend, en ce moment, 10,500 reis, soit environ 22 fr. l'aroba de 1re qualité. Les frais de transport sont plus considérables dans l'intérieur: il faut payer un droit de province lorsqu'on passe d'une province à l'autre, et le prix du café était tombé l'an dernier à 4 ou 5,000 reis, en sorte que les planteurs de la province de Minas Geraes ne purent couvrir leurs frais. Ajoutez à cela que, depuis la guerre du Paraguay, le gouvernement perçoit un droit de douane de 10% sur le café exporté.
Les trois fazendas du baron de Rio Bonito donnent en moyenne 50,000 arobas de café par an. Il a environ 3,000,000 de pieds de caféiers; on calcule que 1,000 pieds de café produisent de 30 à 50 arobas l'an; ils donnent le double dans la province de San-Paulo.
Le Brésil produit le quart du café consommé dans le monde entier, mais les java, les ceylan, les moka ont plus de parfum et un prix supérieur. Après deux ou trois heures de cavalcade, nous rentrons à la maison, où un bon déjeuner nous attendait pour refaire nos forces. M. de Rio Bonito est époux de 4 mois; il me présente à sa jeune et jolie femme, qui dit se plaire à la vie champêtre, mais qui paraît, regretter parfois la vie plus animée de la ville. Plus tard, la distraction des bébés lui fera trouver la campagne plus douce. Dans l'intervalle, le dévouement aux nombreux enfants de la ferme pourra utilement occuper ses loisirs.
(p. 101) Après le déjeuner, on me fait visiter les dortoirs des nègres: ils sont 800 dans les trois fazendas. Hommes et femmes sont séparés: ils couchent comme les soldats au corps de garde et ont la discipline militaire; les moins dociles risquent la salle de police. À l'infirmerie, il y a une vingtaine de malades; ce sont tous des enfants atteints de la rougeole; leurs mamans les soignent: un pharmacien est attaché à la fazenda et un médecin est appelé toutes les fois qu'on en a besoin. Les maladies habituelles au pays sont les maladies de cœur, de foie et de poitrine. On transpire constamment, et les courants d'air établis pour la fraîcheur sont souvent désastreux. Le régime journalier est le suivant: l'esclave se lève à cinq heures, et on lui sert du café; à neuf heures et demie, il a un déjeuner composé de viande salée, de haricots noirs et de légumes; à trois heures et demie, idem. Le soir, polenta ou pâtée de maïs blanc. À neuf heures et demie les portes sont fermées, tout le monde est au logis. Les esclaves ont un jour de repos sur sept. Ce jour, ici, c'est le jeudi. Chaque fazenda prend un jour différent, pour éviter le mélange ou les querelles avec le personnel des fazendas voisines.
L'esclave peut, ce jour-là, se reposer, travailler pour le maître au prix de 1,000 reis, ou pour lui-même en cultivant le morceau de terre qui lui est assigné. Il sème du maïs, plante du café, élève des poules et vend le produit au maître. Avec l'argent ainsi gagné, il peut s'acheter des objets de vêtements, ou autres: il a toujours un (p. 102) compte courant où est marqué son doit et avoir. Le maître le nourrit, le soigne s'il est malade ou infirme, et lui donne 2 vêtements par an. Ce vêtement consiste en une chemise et un pantalon pour les hommes; une chemise et un jupon pour les femmes, le tout en cotonnade blanche et solide. Le prix d'un esclave valide est actuellement de 5 à 6,000 fr.
La famille n'existe pas. Les nègres changent souvent de femmes: quelques-uns pourtant sont fidèles, et M. de Rio Bonito me citait un maçon qui avait eu 7 enfants de la même femme, formant une famille modèle. Les enfants appartenaient au maître de la mère; maintenant ils sont libres, mais ils doivent rester avec la mère jusqu'à un certain âge. J'en ai vu un grand nombre qui jouaient gaiement à la ferme ou grouillaient au soleil. Il est regrettable qu'ils n'aient pas encore d'écoles. Ils sont censés catholiques; le vicaire du village vient leur dire la messe à la chapelle de la fazenda deux fois le mois et baptiser les nouveau-nés; la cloche sonne l'angélus trois fois le jour; et la salutation en usage est: sia lodato Jesu Cristo, auquel on répond sempre sia lodato; c'est ce qui leur reste de l'ancienne évangélisation par les missionnaires.
À la lingerie, je vois bon nombre de jeunes mères. Elles ne vont pas aux champs et raccommodent le linge tout en soignant leur négrillon: celui-ci souvent est mulâtre, parfois presque blanc.
Près des usines, s'étendent par-ci par-là d'immenses glacis en ciment: ce sont les séchoirs pour le café. Nous (p. 103) arrivons au point où les chars laissent tomber leur cargaison de cerises-café dans un bassin d'où l'eau les entraîne dans un canal. De grosses pierres y sont posées de distance en distance. Les cerises se heurtent contre ces obstacles et se dépouillent de la terre qui se perd dans les grillages placés à courts intervalles. Elles arrivent ainsi bien propres à l'usine; mais là, celles qui surnagent s'en vont tomber sur un glacis où elles sèchent au soleil; les plus lourdes au fond de l'eau sont entraînées dans un cylindre qui, par le frottement de chevilles, les dépouille de l'écorce rouge. Les deux graines intérieures se séparent, passent à un tamis, tombent dans un deuxième cylindre qui les roule et les délivre de la gomme, et arrivent ainsi sur les séchoirs. Après 10 jours de soleil, pendant lesquels les esclaves les tournent et les retournent avec des râteaux, elles passent sous des pilons qui les dépouillent de la deuxième écorce; une seconde opération sépare les graines rondes qui sont vendues pour moka, puis le tout est porté sur de grandes tables, où les femmes qui ont des bébés enlèvent les quelques graines défectueuses, et la marchandise est mise en sac pour l'exportation. Le café ainsi préparé s'appelle café despolpado. Il est moins fort, plus délicat et plus cher; il prend le chemin du Havre. Celui qui est séché en graine est séparé des deux peaux par une machine américaine, bruni à un cylindre et envoyé de préférence aux États-Unis. Il s'appelle café terrero; il est plus fort que le premier. Le café s'améliore en vieillissant: on m'a montré des échantillons de dix (p. 104) ans d'un parfait arôme. M. de Rio Bonito plante aussi la canne et prépare le sucre pour son nombreux personnel; il opère à peu près comme M. Paes-Leme, mais il fait aussi de l'eau-de-vie qu'il donne quelquefois à ses travailleurs; ils en consomment une centaine d'hectolitres par an.
Dans la même usine, on pile, pour le blanchir, le riz récolté à la fazenda pour les ouvriers, et une machine égrène les épis de maïs. La qualité blanche sert pour la nourriture des gens, la jaune pour les animaux; le bois de l'épi est passé au moulin, et, mélangé au son et à la farine, sert à engraisser les porcs; les feuilles et le résidu de la canne à sucre sont convertis en fumier; l'écorce de la cerise du café donne un excellent combustible, et de ses cendres on extrait 40% de soude. Un administrateur intelligent sait tirer parti de tout.
Prévoyant la fin prochaine de l'esclavage, le propriétaire se préoccupe de préparer graduellement la transition au travail libre et rétribué. Les esclaves étant bien traités chez lui, il compte qu'ils lui resteront presque tous comme travailleurs à gages.
Le jeune baron me cite l'exemple d'un employé qui est resté cinquante ans dans sa maison; il accumulait ses gages, et avait réuni une somme de 250,000 fr. En mourant, il a légué 5 contos de reis (12,500 fr.), à chacun des enfants de son maître. C'était le vrai serviteur qui est considéré et se considère comme étant de la famille.
Au verger, je remarque encore les fruits nombreux et variés des tropiques; le palmier de Madagascar déploie (p. 105) ses immenses branches et laisse tomber ses longs épis; l'arbre à cannelle donne son écorce de senteur, et l'arbre à girofle ses clous parfumés; le palmito, ou palmier mince et long, fournit un excellent légume dans sa partie supérieure, et le sagou ressemble aux fougères arborescentes. Après le dîner, j'interroge encore sur les conditions auxquelles le gouvernement concède les terres de l'intérieur, et j'apprends qu'il fait des concessions d'une sesmaria (1/2 lieue carrée), à condition qu'on y bâtisse une maison et qu'on y place une famille pour la culture. Le prix demandé est minime: 1/2 reis (1/8 de centime) par brasse carrée, payable à long terme. Ces renseignements ne concordent pas avec ceux fournis par le bureau de la colonisation à Rio-Janeiro; là, en effet, on m'avait indiqué 2 reis pour prix de la brasse carrée; en sorte que je suis en présence d'un mystère, lorsque je cherche à m'expliquer la conduite de ce bureau; voudrait-on éloigner l'étranger capitaliste et intelligent, de l'achat des terres, pour n'avoir que des bras ignorants, afin de remplacer l'esclave? Il n'y a que le cœur grand et l'esprit large qui aboutisse aux choses grandes et profitables!
Enfin la conversation roule sur la chasse. Un pays presque encore vierge doit, nécessairement, abonder en gibier: il y a, en effet, ici, pour les amateurs, 4 espèces de tigres ou oncas, 3 sortes de chats sauvages, 4 qualités de cerfs, 4 qualités de sangliers, une grande quantité de lapins.
(p. 106) La Prighizza ou le paresseux, animal lent qui met un jour à grimper sur un arbre, mais qui serre tout à coup ses ongles allongés, et gare si on est pincé; le paca qui a la face du phoque et le goût du mouton; le capivara, le cutia, plus petit que le paca, et l'anta, qui tient de l'éléphant et du mulet, mais plus petit que celui-ci; s'il est poursuivi, il brise tout avec sa poitrine dans la forêt vierge: son cuir, très épais, est fort recherché.
Le gibier de plume n'est pas moins abondant. On me cite le macuco, espèce de dinde sauvage; le jacu, sorte de coq de bruyère; le jao, poule sans queue; l'uru, un peu plus gros qu'un pigeon; le mutu, espèce de coq; le pavon, sorte de faisan; le jaburo, oiseau piscivore, dont les ailes ont une brasse d'envergure; le pattu silvestre ou canard, le marecu et l'ariri, autres variétés de canards; le curicaca, qui ressemble à un oiseau de proie, etc.[Table des matières]
Route vers San-Paulo. — Deux musiques de nègres. — La fête de saint Jean et les pétards. — Un étrange garçon. — La ville. — L'hôpital et les Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry. — Un vigneron français. — Départ pour Sanctos. — Les entrepôts de café. — La Casa di Misericordia. — Navigation vers la République orientale. — En quarantaine à l'île de Florès.
Il est dix heures lorsqu'on va au repos. À sept heures je prends congé de l'aimable hôte qui m'a comblé d'attentions, et avec son beau-frère, qui revient d'Espagne, nous montons en voiture. À sept heures et demie, nous visitons la belle église de Sainte-Anne, à peine achevée, par les soins et presque entièrement aux frais du baron de Rio Bonito, propriétaire du village; et à huit heures, le train m'emporte vers le sud, dans la direction de San-Paulo. Le soleil est ardent et la poussière envahit les wagons; la voie suit le fleuve Parahyba, qui coule à travers de gracieuses collines, bornées au loin, à droite et à gauche, par deux chaînes de montagnes. Partout le café, la canne et la forêt vierge. À la station de Divisa, une bande composée de noirs joue la marche nationale italienne pour la réception d'un personnage dont j'ignore la qualité. À Cocheira, on change de compagnie et de train; la voie large est remplacée par la voie étroite. Une autre (p. 108) bande de musiciens nègres s'en va à Lorena pour rehausser une fête au profit des pauvres. C'est demain la Saint-Jean, une des fêtes des nègres. Nous quittons le Parahyba pour entrer dans une plaine où paissent les bœufs et les mules. Elle est couverte de petits monticules de terre, maisons des coupis, espèce de guêpe. La voie continue à s'élever jusqu'à atteindre une altitude de 700 mètres. À six heures, nous sommes à San-Paulo. Durant la route, après Cocheira, le conducteur du train prend et arrange à part mes deux valises qui étaient venues jusque-là dans mon wagon. Comme il laisse celle des autres passagers, je pense qu'il veut me faire une politesse, mais à San-Paulo il réclame 12,000 reis pour les rendre et ne me donne pas même une quittance; il y a donc des compagnies qui exploitent plus que d'autres!
À San-Paulo, les pétards, les fusées vont leur train, mon garçon de chambre est Napolitain; ils sont donc bien dévots à saint Jean ici, lui dis-je. Le malicieux garçon me répond: «tutto fumo, poco arrosto» (tout de fumée, peu de rôti). Cette manie de jouer avec la poudre pour la Saint-Jean est si grande, qu'on tire les fusées même en plein midi. À table, je remarque l'air distingué de celui qui me sert; il parle le français, le portugais, l'italien. Je l'interroge et il m'apprend qu'il est le neveu de tel banquier de Milan. Comment êtes-vous donc ici à servir?—En venant dans ce pays, j'étais teneur de livres dans une compagnie de chemins de fer: après un an, elle a fait faillite et j'ai perdu mes gages. Le séjour au milieu des (p. 109) terrassements m'avait donné la fièvre intermittente, et j'ai passé 7 mois à l'hôpital, où les Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry m'ont bien soigné; je suis ici pour gagner ma vie, mais peu fait pour ce métier, je soupire après la main secourable qui m'en tirera. Les épreuves sont partout!
Le 24 juin, saint Jean. Mon esprit se reporte au loin à ces belles fêtes de famille qu'en ce jour organisait et présidait le grand-père: il me semblé voir les bouquets et entendre les poésies sur saint Jean-Baptiste que récitaient au vieillard les enfants et les nombreux petits-enfants: il y a des joies à côté des épreuves dans la famille chrétienne! La ville compte 40,000 habitants, ses rues sont étroites, une partie de ses maisons en pisé. À la Casa di Misericordia, les Sœurs de Saint-Joseph soignent une centaine de malades: je remarque un bon vieillard anglais; sa barbe blanche et son air vénérable l'ont fait surnommer par les Sœurs le Père Éternel. Une pauvre Française est brisée par la fièvre tierce. «D'où êtes-vous,» lui dis-je? Elle me répond: «Je suis des Hautes-Pyrénées.» Les nègres sont nombreux, une salle est réservée à la vieillesse. Les Sœurs ont aussi une école gratuite avec 100 élèves. Les Ordres enseignants auraient ici bien à faire. À quelques heures de chemin de fer, à Itu, les Pères jésuites de la Province Romaine ont un collège avec 400 élèves; les riches arrivent encore à faire instruire leurs enfants, mais le peuple, surtout dans les campagnes, manque du nécessaire, sous ce rapport; aussi les neuf dixièmes de (p. 110) la population sont illettrés. Si au moins le clergé pouvait donner l'enseignement religieux; mais il est insuffisant. Douze évêques pour 12 millions d'habitants, sur une surface dix-huit fois grande comme la France, et la plupart sans séminaire! Aussi on compte les personnes qui ont reçu la première communion: heureusement ce peuple est bon, et le Père Céleste demeurera toujours pour tous le Prêtre Éternel!
M. Judalessio me renseigne sur les œuvres charitables du pays.
On m'avait dit qu'à une heure de la ville, un Français, le comte de Milville, plantait la vigne. Belle occasion pour me renseigner. À deux heures, par un soleil de feu, je m'achemine vers l'ouest; je traverse une plaine marécageuse, et, arrivé à un cours d'eau, je demande la propriété du comte de Milville. On m'indique la direction et on ajoute qu'il me faut une demi-heure pour l'atteindre. Après trois quarts d'heure, j'ai traversé toute la plaine, et au pied des collines je demande encore: on me dirige à gauche en m'indiquant d'avoir à traverser, la montagne; on ajoute que j'en ai encore pour une heure. Cette fois, on disait vrai. Enfin, un peu en m'égarant, après deux heures et demie de bonne marche, j'arrive chez M. le comte. La vaste maison de terre rouge couverte en tuiles repose vers le bas d'un mamelon qui domine la plaine. La vue s'étend au loin jusqu'à la ville de San-Paulo. Le comte est heureux de voir un Français, et Mme la comtesse apprête en quelques instants un petit dîner que la (p. 111) course me fait trouver délicieux. Une petite fille de dix-huit mois et un autre à la mamelle sont toute la compagnie des jeunes époux. C'est la vie écossaise.
Nous parcourons la propriété: elle est d'environ 120 hectares et lui a coûté 5 contos de reis, soit de 10 à 12,000 fr.; environ 80 fr. l'hectare. En arrivant dans ce pays, il avait espéré obtenir des terres du gouvernement et planter le café; mais les terres qu'on lui proposait étaient aux confins militaires, à 500 lieues dans l'intérieur, sans communication et sans issue. Il se décida alors à en acheter et à planter la vigne. Il a déjà 6,000 ceps. Ceux qu'il a plantés en septembre dernier ont poussé de beaux sarments. Après trois ans ils produisent: le raisin mûrit en janvier. On plante par boutures dans des trous de 40 centimètres, et à une distance de 2 mètres, parce qu'ici la vigne est très vigoureuse. Un hectare de vigne contient 2,500 pieds donnant par an 50 hectolitres de vin, ce qui, au prix de 80 fr. l'hectolitre, donne un revenu de 4,000 fr. l'hectare.
La plantation revient à peu près à 1,500 fr. l'hectare: on ne laboure pas la vigne; on la nettoye simplement trois fois l'an, ce qui coûte environ 300 fr. l'hectare. Ajoutez à cela les frais de vendange, l'intérêt du capital, l'amortissement du matériel, etc., et tout en calculant largement, on trouvera encore un revenu net de 100%.
C'est ce qu'assurent les autres planteurs, dont quelques-uns récoltent déjà plus de 1,200 hectolitres de vin. L'opération est donc meilleure qu'en Algérie. La vigne (p. 112) employée est l'américaine, et la main-d'œuvre n'est guère plus chère qu'en France, excepté la nourriture en plus; mais ici, avec la viande à 16 sous le kilo, les haricots et le maïs pour peu de chose, elle ne coûte pas beaucoup. Le foin donne un revenu encore supérieur à la vigne.
Je m'étonne alors qu'on ne draine pas la plaine marécageuse dont j'ai parlé, et qui couvre la ville de brouillards chaque matin, d'autant plus que cette plaine appartient à la municipalité. Une administration intelligente le ferait elle-même, ou céderait la terre avec obligation de drainage à une compagnie qui, en transformant le marécage en prairie, réaliserait d'immenses bénéfices.
Les collines que j'avais traversées étaient sans culture, ou terras de pastos, quelques bœufs ou vaches y paissaient, beaucoup de serpents s'y promenaient, et pourtant elles avaient une profonde couche de terre rouge qui semble fort propre à la culture du blé. Avec ces terres qui ne demandent qu'à produire, ce pays va encore demander le blé et la farine à Buenos-Ayres et à New-York. Rien d'étonnant que le pain coûte 0 fr. 75 le kilog., presque aussi cher que la viande.
La formation et la plantation des haies, malgré l'abondance du bois, est assez chère: le bois pourrit vite durant les trois mois de pluies de l'été, de novembre à janvier, et si on le plante en terre, il en sort des arbres.
M. de Mirville m'apprend qu'il y a environ 1,500 Français à San-Paulo, et plus de 9,000 Italiens. En effet, dans les rues, j'entendais parler tous les dialectes de la Péninsule, (p. 113) et j'ai même trouvé un Niçois, pharmacien, dont les fils, naturalisés, sont devenus, l'un, docteur; l'autre, député et journaliste.
Je prends congé de l'excellente famille de Mirville, et, retraversant les collines, j'arrive à la colonie de Santa-Anna, à la nuit close. Je le regrette, car j'aurais voulu interroger sur place les bons Italiens du nord, qui l'occupent; on me dit que leurs terres ne sont ni assez bonnes, ni assez grandes pour les nourrir; mais ils sont industrieux, la famille travaille à la ville et ils arrivent ainsi à l'aisance. Ajoutez à cela que tout individu qui le veut, s'en va, ici, à la montagne, brûle un lot de forêt, plante, sème, récolte, et l'année suivante s'en va renouveler l'opération ailleurs. Le pays n'a point d'impôt foncier. Si un impôt, aussi minime qu'il fût, venait à grever les terres, les accapareurs qui la possèdent s'empresseraient de s'en défaire.
Le lendemain, à sept heures et demie du matin, je monte dans le train qui va à Sanctos. La plupart des voyageurs sont Anglais. Nous traversons des plaines, contournons des collines, et, toujours au milieu de la forêt vierge, nous arrivons à Alto do Serra, à plus de 700 mètres d'altitude: de là, pour atteindre la plaine, on a disposé un immense plan incliné coupé en quatre stations. Le train descend au moyen d'un câble d'acier; à droite, les montagnes; à gauche, de profonds précipices; par-ci, par-là, des vallons franchis sur des ponts métalliques de 50 mètres de haut. C'est grandiose, on ne se (p. 114) lasse d'admirer, mais tout le monde a le mal de mer. Je ne sais comment fonctionnent les machines; elles impriment aux wagons de petits mouvements saccadés qui produisent sur l'estomac l'effet d'un fort tangage. Au Baiz do serra, le baromètre anéroïde me dit que nous sommes à peu près au niveau de la mer. La plaine est marécageuse et couverte de flaques d'eau, sur lesquelles je vois plusieurs canots creusés dans un tronc d'arbre. Enfin, à onze heures, nous sommes à Sanctos. En ville, on manipule le café dans d'immenses entrepôts. La population est de 18,000 âmes, et comprend toutes les nationalités; mais il n'y a qu'une cinquantaine de Français.
La Casa di Misericordia est dirigée par des laïques, et contient une cinquantaine de malades. L'Anglais qui me conduit me fait remarquer une Française. «D'où êtes-vous, lui dis-je?—De la Mayenne; je suis venue ici avec mon mari, il est mort, mes enfants aussi.» Et elle pleure.... Je l'engage à s'adresser à sa famille pour être rapatriée. Je demande quelles sont les curiosités de Sanctos. On me répond: «Il n'y en a pas, mais l'ascension de la colline est fort intéressante; il faut la faire le matin.» Je n'avais pas le choix: je gravis donc sous un soleil ardent les flancs de la montagne, et après une demi-heure de marche et deux litres de transpiration, me voilà au sommet, où s'élève une chapelle. La vue est merveilleusement belle et fait oublier la fatigue: d'une part, la baie qui s'avance dans les terres en contours bizarrement (p. 115) découpés avec îles et presqu'îles; de l'autre côté, l'Océan et son immensité; au pied, la jeune ville; tout autour, les collines et leurs forêts vierges. En descendant, je m'arrête à la prison, dont la façade forme un des côtés du jardin public. Les prisonniers sont bien gardés derrière leurs portes grillées. J'interroge un Américain: «Why are you here?—On m'accuse de vol, mais c'est à tort.» Je demande à un matelot de Brème ce qui l'a conduit au cachot: «J'étais ivre et je me suis battu.» Un Belge m'assure qu'il n'était qu'un peu gris lorsqu'on l'a recueilli et coffré; enfin, plusieurs nègres sont à l'ombre pour des peccadilles diverses.
Je vais moi-même me mettre en prison, en me rendant au Mondego, navire de la Royal-Mail de Southampton, qui doit me conduire à Montevideo.
Je dis prison, car ce navire ne déplace que 2,300 tonnes: il est moitié plus petit que ceux des Messageries. Il devait partir aujourd'hui, mais, d'une part, la douane ferme ici à 4 heures, et il faut arrêter les opérations de déchargement; d'autre part, il sait qu'en arrivant à Montevideo il sera en quarantaine jusqu'à l'expiration de 7 jours depuis son départ de Rio: il préfère donc attendre ici et ne se presse pas. Le capitaine m'assure que nous partirons le matin à 6 heures. Je profite de ce temps pour écrire mon journal et envoyer des nouvelles aux amis.
Le lendemain en effet, à 6 heures, à peine l'aube paraît, on commence à travailler pour tourner le navire; une heure après, il présente la proue vers l'entrée de la (p. 116) baie. Un individu arrive essoufflé et me dit: «Je viens de San-Paulo pour rejoindre un débiteur; il est sur le navire, il se sauve, je veux le faire arrêter par la police.» Je l'adresse à un des officiers, qui lui répond en anglais; mais le Brésilien n'en comprend pas un mot, et pendant qu'il se perd en explications, le navire part, emportant créancier et débiteur. Heureusement que la baie est longue et qu'il faut une heure pour en sortir. Pendant ce temps, on peut faire comprendre la malencontreuse aventure au capitaine, qui fait déposer à l'entrée de la baie le trop empressé créancier. Celui-ci s'en retourna sans argent, trop heureux de ramener sa personne. Le Mondego est surtout disposé pour les marchandises. Les passagers, toujours en petit nombre, sont relégués à l'arrière et presque sur l'hélice; les secousses que celle-ci imprime au navire se communiquent au corps des malheureux voyageurs et redoublent leur mal de mer.
Nous avons à bord, outre les officiers, un Autrichien, inspecteur de la maison Rimmel pour ses fabriques de parfumerie au Brésil et à la Plata; un Canadien anglais avec sa femme, de Chicago; leur fils, âgé de dix ans, est porté au bras depuis qu'il a été mordu à la jambe par un gros chien, à Rio-Janeiro. Nous avons aussi un Romain, qui a inventé une manière de conserver la viande. Il vient d'avoir la fièvre jaune à Rio, et il se sauve. Un docteur italien a aussi perdu de la fièvre jaune à Rio sa jeune femme de 22 ans un mois après son arrivée: il s'en va avec son fils à Buenos-Ayres.
(p. 117) Le 29 juin, nous longeons les montagnes de la province de Santa-Cattarina, le vent est debout: nous ne filons que 9 nœuds 1/2, le tangage rend la promenade impossible.
Les émigrants à bord sont une centaine, Italiens et Espagnols; les Napolitaines vivent un peu trop à la japonaise, et le capitaine soupire après le moment de s'en débarrasser.
La machine, construite depuis 12 ans, manque des derniers perfectionnements. Le 30 juin, navigation tranquille: c'est samedi. Les officiers font la visite réglementaire du navire, et l'équipage, la manœuvre de l'incendie. Je rends encore visite aux émigrants. Je trouve des Espagnols, des Napolitains, des Piémontais, quelques Françaises et une Niçoise. Ils se plaignent du désordre produit par quelques émigrants et surtout émigrantes; ils se réjouissent de voir approcher la fin du voyage. Plusieurs reviennent de Rio-de-Janeiro, où ils ont été malades et ont perdu des parents. Je distribue des gâteaux aux nombreux enfants, toujours heureux quand on pense à eux. À propos de chant et de musique, grande querelle entre un Anglais et un Américain; l'harmonie n'est pas parfaite entre ces deux peuples.
1er juillet.—Mer très calme; mais roulis très fort, probablement à cause des courants à l'approche du grand fleuve de la Plata. Nous avons toujours la côte à droite, mais elle est si basse qu'elle ne peut être vue que de la dunette.
Le 2 juillet.—Durant la nuit, on a ralenti la machine (p. 118) pour arriver à la pointe du jour. À quatre heures, nous sommes en face de Montevideo. Le phare tourne ses feux sur le sommet du Cerro, la ville dort, et les nombreux navires à l'ancre semblent dormir aussi. À sept heures, le soleil dore l'horizon de ses rayons de feu. Nous attendons avec impatience la visite de la Santé pour connaître notre sort. À neuf heures, un steamer accoste et nous envoie en quarantaine pour vingt-quatre heures à l'île de Florès, à douze lieues d'ici. Les passagers alors ressemblent fort à ces clients qui, au sortir de l'audience, où ils ont été condamnés, ont vingt-quatre heures pour maudire leurs juges: ils maudissent la quarantaine, la fièvre, le Brésil, l'Uruguay, et je ne sais quoi encore. Pour se consoler, on va déjeuner, et pendant ce temps, le navire arpente les eaux bourbeuses de la Plata pour nous conduire à l'isola de Florès, ainsi appelée du nom d'un des présidents de la République orientale.
À midi, nous sommes en face de l'île, mais il faut longtemps pour débarquer les émigrants et leurs bagages. Le pursuer (économe), qui fait l'appel des noms italiens et espagnols avec l'accent anglais, ne peut être compris et jette un peu de gaieté parmi ce monde attristé. À deux heures, notre petit canot nous dépose sur la plage, où nous trouvons nos bagages. On nous fait ouvrir nos malles pour que nos effets prennent l'air pendant un certain temps; enfin je puis me dégager et obtenir une chambre au lazaret, au compartiment des premières. Pas de chaise et pas de table; je vole une chaise au voisin et (p. 119) m'empare d'une mauvaise table à la salle à manger. Je puis ainsi rédiger mes correspondances à divers journaux.
Le ciel est pur, le panorama magnifique; l'air frais redonne la vie; je bénis Dieu d'une prison si bénigne. Le garçon qui me sert est Espagnol: il sait un mot anglais: all right, deux de français, trois d'italien; il est fort prévenant et veut que je note son nom: Francisco-Fernandes Martines.
Que de pauvres passagers ayant envie de grogner il voit tous les jours! Dans cette année, cinq seulement ont eu ici la fièvre jaune; trois sont guéris, deux sont morts: un Français et un Allemand.
À cinq heures, on sonne le dîner; il est mauvais, mais l'appétit le rend délicieux. Après le dîner, pendant que mes compagnons jouent au billard, à la clarté du phare, j'inspecte l'île; mais lorsque je me dirige vers le phare, je me heurte à un fil de fer posé à 10 centimètres du sol; immédiatement la porte de la tour s'ouvre et un soldat sort en criant: Qui vive?—Se puede visitar el fanal?—No se puede da nuece, convien tornan a magnana.—Sta bueno.
La nuit était froide, le vent parlait comme notre mistral. À cinq heures et demie, j'allume une bougie et reprends mon travail. À huit heures sonne le café, et peu après on présente la note: deux pesos et demi, environ 14 fr. À onze heures, déjeuner et ensuite départ.[Table des matières]
L'Uruguay et la Plata.
Montevideo. — La République orientale ou de l'Uruguay. — Population. — Surface. — Produits. — Exportation. — Importation. — Les Saladeros. — Fray-Bentos et l'extrait de viande Liebig. — Un calcul pour s'établir dans le pays. — Forme de gouvernement. — L'armée. — Rôle de la petite république. — Villa Colon. — Le velario. — Traversée de la Plata. — Buenos-Ayres. — Rues et monuments. — Climat. — Agriculture. — Colonies. — Industrie. — Commerce. — Chemins de fer. — Presse. — Navigation. — Postes et télégraphes. — Budget. — Armée. — Marine. — Main-d'œuvre. — Immigration. — Monnaie. — Dette. — Culte. — Instruction publique. — Assistance publique. — Justice.
C'est le mardi 3 juillet, vers midi, que je quitte l'île de Florès et la quarantaine, et vers trois heures le petit vapeur me dépose sur le quai de la douane, à Montevideo. La visite des effets ne fut pas longue. Je les dépose à l'Hôtel Oriental et parcours la ville dans toutes les directions pour remettre les nombreuses lettres de recommandation aux banquiers, commerçants, missionnaires et hommes de lois.
La ville de Montevideo, sur une presqu'île en colline, est bâtie régulièrement; ses rues sont assez larges et se (p. 122) coupent à angle droit; la partie haute est plate et occupée surtout par les édifices publics: la cathédrale, qu'on appelle ici la Matriz, vaste église en style romain à croix latine avec coupole; le palais du gouvernement local, le théâtre, le palais du gouvernement de la République, etc. Les autres rues descendent à l'est et à l'ouest vers la mer; les maisons ont généralement un étage sur rez-de-chaussée et sont ornées en style italien parfois un peu surchargé. On peut dire que Montevideo figurerait bien parmi les belles villes européennes. Elle est la capitale de la République orientale de l'Uruguay et compte 100,000 habitants. Son nom lui vient de Magellan, qui le premier, découvrant le Cero, mont qui fait face à la ville, dit: Montem video; d'où le nom de Montevideo.

Montevideo.—Boulanger portant le pain.
(p. 123) La majeure partie des habitants sont Européens ou fils d'Européens, principalement Italiens, Basques, Français et Espagnols; les Italiens possèdent environ la moitié des immeubles de la ville.
La République de l'Uruguay est située entre le 30° et le 35° de latitude sud et limitée à l'est par l'Atlantique, à l'ouest par la République argentine, dont elle s'est séparée en 1825 après des guerres sanglantes; au nord par le Brésil, au sud par l'estuaire de la Plata, formé de la jonction des deux fleuves Parana et Uruguay.
La superficie est d'environ 187,000 kilomètres carrés, divisés en 15 départements, et la population d'environ 450,000 habitants, mélange d'Indiens, d'Espagnols et d'autres Européens. Les principales sources de produits sont l'agriculture et l'élevage du bétail. En 1882, l'exportation comprend, pour les produits animaux, 49,180 balles de laine, 456,100 cuirs salés de bœuf, 1,289,900 cuirs secs, 1,615 balles de cornes, 1,285 balles de soies de porc, 5,475 pipes de suif.
Pour les produits agricoles, en 1882, on a exporté 13,500 kilos de millet, 53,664 sacs de son, 41,500 sacs d'avoine, 610 chevaux, 10,660 moutons, 5,000 sacs d'orge, 183,500 sacs de farine, 132,000 sacs de maïs, 2,800 mules, 10,000 sacs de pommes de terre, 9,000 quintaux de foin, 19,500 sacs de blé, 440 quintaux de luzerne.
L'importation pour 1881 s'est élevée à 8,514,000 piastres fortes, soit environ 43,000,000 de francs.
Dans cette somme, la France figure pour 1,371,130 (p. 124) piastres fortes, soit environ 7,000,000 de francs, en huiles, absinthe, sucre, bière, cognac, sardines, vermouth et vins.
En 1882, les neuf saladeros[1] de Montevideo ont tué 217,984 animaux, qui ont produit 241,660 quintaux de viande, et les six autres saladeros situés sur l'Uruguay ont tué 520,300 animaux, qui ont produit 452,000 quintaux de viande. Cette viande, salée et séchée au soleil, est expédiée presque par parties égales au Brésil et à Cuba, pour la nourriture des esclaves.
Parmi les saladeros de l'Uruguay figure celui de Fray-Bentos, pour la préparation de l'extrait de viande Liebig. En 1882, il a tué 170,300 animaux, avec un profit net d'environ 2,000,000 de francs. Cet établissement est le plus important du pays. Il possède 76,500 acres de terre et en loue 52,000, sur lesquels il nourrit 41,000 têtes de bétail. Il vient d'acheter un nouveau terrain de 10,000 acres pour environ 2,300,000 fr. Pour cette année, qui a été mauvaise à cause de la cherté des animaux et de leur mauvais état, il a pu donner aux actionnaires un intérêt de 10% et mettre environ un demi-million de francs à la réserve. Je comptais visiter cet établissement sur le fleuve Uruguay, à deux jours de navigation de Montevideo, mais un des directeurs, à Buenos-Ayres, m'apprit qu'il venait de prendre son repos d'hiver, et que depuis une semaine tout était fermé: je dus donc renoncer à (p. 125) cette visite et me contenter d'en voir les opérations sur le dernier compte rendu de la Société, dont j'ai extrait les chiffres que je viens d'indiquer.
De la Rivista mercantil de la Republica Oriental, je relève le calcul ci-après, pour une famille composée de père, mère et un enfant, qui voudrait s'établir dans la République pour s'occuper d'agriculture sur un terrain de 15 hectares:
Naturellement je ne garantis pas l'infaillibilité de ces chiffres!
La forme de gouvernement est la République avec un président et deux Chambres électives. Le président actuel est le général Sanctos, porté à cette haute situation par le parti militaire. Tout le monde dans le pays sait qu'il y a quinze ans il était charretier. On voit souvent dans l'histoire des personnes de la plus basse condition élevées au faîte des honneurs et du pouvoir, et on leur pardonne l'obscurité de leur origine si, par une grande droiture et honnêteté et par de vrais talents, ils font le bien public. L'armée compte de 6 à 7,000 hommes, costumés et équipés à la française; mais on dit qu'un trop grand nombre sont officiers.
L'Uruguay, comme la Suisse, la Hollande, la Belgique, en Europe, est un petit État qui sert de tampon entre des États plus forts et jaloux. À ce titre, il rend un véritable (p. 127) service; mais pour conserver son indépendance dans ces conditions, il a besoin d'une grande sagesse et doit donner une sérieuse prospérité à ses habitants. Les troubles prolongés, les souffrances du peuple seront un facile prétexte à l'un ou l'autre de ses voisins pour se l'annexer au nom du rétablissement de l'ordre ou d'un meilleur gouvernement.
Mais revenons à l'emploi de mon temps. Après avoir vu les diverses personnes pour lesquelles j'avais des lettres, je me rends à la station du ferro-carril central, en route pour Villa Colon, chez les Salésiens, enfants de dom Bosco. Dans le train, je rencontre le supérieur du collège, D. Lasagna, que j'avais connu à Nice, et D. Borghino, nommé chef de la maison qui va être ouverte à Nycteroy, dans le Brésil. Après trois quarts d'heure de chemin de fer, nous trouvons une voiture qui nous conduit au collège par une demi-heure de route dans un chemin fangeux. On appelle Villa Colon un vaste terrain acheté par une compagnie dans le but de le lotiser et de le revendre pour villas.
À cet effet, on avait tracé de magnifiques allées plantées d'eucalyptus, construit une église et un collège, dans la pensée d'amener là les familles riches durant l'été. La mode ne s'en étant pas mêlée, la compagnie a fait faillite, mais le collège est resté et on l'a confié aux prêtres Salésiens. La construction est bien disposée, la chapelle gracieuse, les cours vastes. Le bon P. Lasagna me fait visiter les classes et les études; puis, au réfectoire, (p. 128) après le souper, il présente le voyageur aux élèves, et le voyageur leur parle en langue française, comprise par la plupart d'entre eux.
Nous passons une partie de la soirée en causeries. Le Père m'apprend qu'il a dans le collège 70 élèves des meilleures familles, payant une pension qui varie de 50 à 100 fr. par mois; 16 professeurs font tous les cours de l'enseignement secondaire jusqu'à la philosophie inclusivement. Ils dirigent en même temps un Observatoire qui recueille trois fois par jour les données météorologiques et sera un peu plus tard en état de signaler l'approche des tempêtes. Dans un temps où le monde se montre si avide des données de la science, il est fort habile et fort pratique pour une Congrégation religieuse de s'imposer le travail facile mais incessant d'un Observatoire.
À las Piedras, à quelque distance de Montevideo, les Salésiens ont une paroisse et un collège avec 27 internes pauvres et 90 externes payant 2 fr. 50 par mois. À la Pax, ils ont une chapelle pour la messe et le catéchisme.

Uruguay.—(El Velario). Réjouissances à la mort d'un enfant.
À Payssandu, ils desservent une paroisse et des missions. Ils font des excursions périodiques au loin dans la campagne pour les mariages, les baptêmes et autres Sacrements. Les campagnards, souvent fort éloignés les uns des autres, privés de tout secours spirituel, laissent parfois pénétrer peu à peu certains désordres ou superstitions. Le Père me raconte qu'un jour une femme lui dit: «Grondez un peu ma voisine, elle n'a pas voulu me prêter son petit enfant mort pour organiser le bal; et (p. 129) pourtant je lui avais prêté le mien.» Renseignement pris, le Père apprend qu'à la mort d'un jeune enfant on réunit la famille, les voisins, les amis lointains, et, sous prétexte de se réjouir de ce qu'un ange est entré au ciel, on organise un bal en règle; puis ils prêtent le petit cadavre à d'autres, qui le colportent et en profitent pour organiser d'autres bals. Cette réjouissance s'appelle velario dans le pays. Quoi d'étonnant que nous retrouvions chez les Indiens de ces pays certains usages qui nous étonnent! L'isolement en produit bientôt de singuliers, même parmi les civilisés.
Mais tout en causant nous nous apercevons que la nuit s'avance; nous visitons les dortoirs, où les élèves dorment du plus profond sommeil, et allons nous-mêmes goûter un repos nécessaire.
Le lendemain matin je rentre à Montevideo, où M. Buxareo, un des protecteurs de Villa Colon, me fait promettre qu'à mon retour de la République argentine je m'arrêterai quelques jours pour qu'il puisse m'en faire visiter les principales institutions et me conduire à quelques-unes de ses nombreuses campagnes. Il m'apprend qu'il y a à Montevideo cinq associations de charité pour les hommes, et autant pour les dames. Chez les Sœurs de Charité, dans la ville, je trouve une belle école avec 300 élèves gratuites, le tout aux frais de la famille Buxareo. Enfin, à quatre heures et demie, je suis au quai de la Douane, et à cinq heures, à bord du Cosmos, en partance pour Buenos-Ayres. Le navire porte des plants (p. 130) d'oliviers et d'orangers, et j'y rencontre avec plaisir plusieurs des passagers du Mondego.
La rivière fut calme et la nuit courte. Dans moins de douze heures nous avons passé d'une rive à l'autre de la Plata, large en cet endroit de 200 kilomètres.
Le jeudi 5 juillet, à cinq heures du matin, nous stoppons au large devant Buenos-Ayres, attendant le jour. À sept heures nous montons sur des canots qui nous déposent à un môle se prolongeant au large sur des poutrelles de fer. Les effets et marchandises sont transbordés sur des charrettes, que des chevaux traînent dans l'eau, sur le sable, l'espace d'un kilomètre, pour arriver à terre. Les grands navires sont obligés de s'arrêter à 10 ou 12 milles au large, faute de fond vers le bord de la rivière.
En ville, les distances sont grandes, mais il y a partout des tramways. Les rues, larges de 10 mètres, se coupent à angle droit. Les maisons n'ont en général qu'un rez-de-chaussée, quelquefois un étage; elles ont presque toutes un patio ou cour intérieure, garnie de plantes et de fleurs, sur laquelle donnent les chambres. Les rues centrales sont mal pavées, et les autres ne le sont pas du tout. Il est impossible d'y circuler autrement que sur les trottoirs. On voit quelques beaux, monuments: sur la place Victoria, le palais de justice, que domine un grand clocher, et la cathédrale, à croix latine, avec haute coupole et un beau péristyle à douze colonnes. Le Correo ou poste est aussi de bon goût, mais construit pour un (p. 131) climat du nord. La douane, le collège San-José et quelques maisons particulières sont d'un bel effet. Les deux plus riches monuments sont les banques nationale et provinciale.

Buenos-Ayres.—Place Victoria.
Buenos-Ayres est la capitale de la Fédération ou République argentine. Cet État, au sud de l'Amérique du Sud, a une surface de 3,027,088 kilomètres carrés; elle est donc six fois plus grande que la France; et comme ses terrains sont fertiles, le jour où elle sera peuplée comme la France, elle contiendra plus de 200 millions d'habitants. Organisée sur le modèle de la Fédération des États-Unis de l'Amérique du Nord, la République argentine comprend 14 provinces ou États autonomes, portant les noms ci-après: Buenos-Ayres, Entre-Rios, Corrientes, Santa-Fé, Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, la Rioja, San-Juan, Mendoza et San Luiz; plus 9 territoires destinés plus tard à devenir des provinces; trois sont situés au nord, vers le Brésil et la Bolivie, et sont les territoires del Bermejo, du grand Chaco et des Missiones; six sont au sud et s'appellent territoires de la Pampa, de los Andes, del Rio Negro, de Limaï, de Chubut, de la Patagonie.
La population totale, d'après la dernière statistique, s'élève actuellement à 2,942,000 habitants, mais elle augmente assez rapidement par l'immigration; 363,743 sont étrangers; sur ce nombre, 123,641 sont Italiens, 55,432 Français, 59,022 Espagnols, 8,616 Allemands, 19,950 Anglais et 99,084 de nationalités diverses.
(p. 132) Le président est éligible au suffrage direct tous les six ans; les provinces nomment chacune deux sénateurs, et cette élection est faite par les députés provinciaux; les députés au parlement national sont nommés au scrutin direct et au nombre de un par 20,000 habitants; les conditions d'éligibilité pour les sénateurs sont: 30 ans d'âge, 10,000 fr. de revenu, être citoyen argentin depuis six ans au moins, natif de la province où on est élu, ou l'habiter depuis deux ans au moins. Les sénateurs sont élus pour neuf ans, mais le sénat se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les conditions d'éligibilité pour les députés sont: 25 ans d'âge, être natif de la province où on est élu ou l'habiter depuis deux ans, être depuis quatre ans au moins citoyen argentin. Les députés sont élus pour quatre ans, et la Chambre se renouvelle par moitié tous les deux ans. Pour être élu président, il faut avoir 10,000 fr. de rente, être né dans la République argentine ou fils de citoyen, quoique né en pays étranger, et appartenir à la religion catholique.
Le climat est tempéré vers le centre, tropical au nord, froid au sud; le territoire de la République s'étend en effet depuis le 22e degré latitude sud à son confin avec le Brésil jusqu'au 50e au bout de la Patagonie. À Buenos-Ayres, le thermomètre descend quelquefois en hiver (juillet et août) sous le zéro, mais ne s'y maintient pas. On y voit parfois la gelée, jamais la neige. Pour l'agriculture, elle se développe tous les ans et donne des produits divers selon les provinces: ainsi, dans la province de (p. 133) Tucuman, un hectare de terrain donne 35 hectolitres de maïs, ou bien 15 hectolitres de blé, ou 45 de riz, ou 850 kilog. de tabac, ou 33 hectolitres de vin, ou 150,000 kilos de canne à sucre. Dans la province de Santa-Fé, un hectare donne 15 hectolitres de blé; dans celle de Salta, 17 ou bien 30 de maïs; dans la province de Catamarca, un hectare donne 19 hectolitres de blé ou 125 hectolitres de vin; dans celle de San-Luiz, un hectare ne donne que 24 hectolitres de maïs ou 14 de blé.
Les colonies se multiplient aussi; plusieurs sont des entreprises privées, et huit nationales: celles-ci sont au nombre de trois dans le Chaco, de deux à Entre-Rios, de deux en Cordoba, et une en Patagonie, comprenant ensemble 9,360 habitants, dont 7,294 étrangers, et cultivant 93,321 hectares. Il y a aussi un grand nombre de colonies établies par des particuliers ou des compagnies. Elles possèdent ensemble 12,608 maisons, 434,093 têtes de bêtes à cornes, 132,410 chevaux, 1,687 mules, 162,957 brebis, 26,521 porcs, 30,573 instruments aratoires, 7,651 charrettes. Elles occupent 720,638 hectares, le tout s'élevant à une valeur d'environ 150 millions de francs. Le gouvernement fait son possible pour mélanger les diverses nationalités, afin de favoriser la formation d'une population homogène.
Pour l'industrie, une des principales est de préparer et saler la chair des animaux, opération qui se fait dans les saladeros. En 1882, les sept saladeros de la province de Buenos-Ayres ont tué 187,600 bœufs ou vaches, qui ont (p. 134) produit 275,300 quintaux de viande; et les onze saladeros de la province d'Entre-Rios ont tué 247,100 bœufs ou vaches, qui ont produit 314,90.0 quintaux de viande expédiés à peu près en parties égales au Brésil et à Cuba.
L'industrie sucrière prend aussi un grand développement, et nous aurons occasion d'en parler. Les mines enfin commencent à prendre de l'importance dans les Andes, où l'on trouve le cuivre, l'or et l'argent, surtout dans la province de la Rioja.
Pour le commerce, l'importation en 1882 a atteint le chiffre d'environ 280,000,000 de francs, et l'exportation celui de 275,000,000 de francs.
Les chemins de fer sont en progrès; 2,633 kilomètres sont en exploitation, et 2,777 en construction ou concédés; ils donnent un revenu qui varie de 2 à 10%. Leur marche est lente et peu régulière; la plupart ne marchent que le jour. Presque tous ces chemins de fer appartiennent à des compagnies anglaises.
La presse est grandement répandue: la seule ville de Buenos-Ayres possède 98 journaux, dont trois en langue allemande, cinq en italien, trois en français, trois en anglais, le reste en castillan.
Pour la navigation extérieure, en 1882 sont entrés dans les ports de la République 6,071 navires, portant 1,528,054 tonnes, et en sont sortis 4,765, portant 1,448,189 tonnes. Dans ces chiffres la marine française concourt pour le 16%, l'anglaise pour le 31%. Pour la navigation intérieure, sont entrés 21,727 navires, portant 1,829,933 (p. 135) tonnes, et sortis 22,207 navires, portant 1,798,871 tonnes. Le gouvernement projette une ligne subventionnée, desservant la côte sud jusqu'à la Terre de feu, pour aider au développement des ressources de la Patagonie.
Les postes ont porté, en 1882, 17,757,610 lettres ou plis, et les télégraphes ont expédié 438,090 dépêches.
Le budget de 1882 a donné à l'entrée 40,609,148 piastres fortes de 5 fr. pour la nation, et 4,517,988 piastres fortes pour les municipalités. La sortie a été de 42,544,970 piastres fortes pour la nation, et 4,106,531 piastres pour les municipalités.
L'armée se compose de 57 officiers généraux, 484 officiers, 6,977 soldats.
La marine compte trois cuirassés, un torpilleur, six canonnières, deux transports, six avisos, et plusieurs autres petits navires pour le service des fleuves.
Le prix de la main-d'œuvre varie de 5 à 10 fr. par jour, mais il va en diminuant, à mesure que l'immigration augmente. Celle-ci varie de 30 à 80,000 immigrants par an, mais une vingtaine de mille retournent, pour les récoltes, dans leurs pays, après avoir économisé ici une petite somme; ce sont généralement des Italiens; en venant comme émigrants, ils ont le passage gratuit; ils ne paient que 150 fr. pour le retour.
Buenos-Ayres compte 300,000 habitants et 22,701 maisons, de la valeur ensemble d'environ un milliard de francs. Elle possède 152 kilomètres de tramways, et un appareil de téléphone pour 173 habitants. Paris n'en possède (p. 136) qu'un par 865, Vienne 1 par 1179, Berlin un par 1930 et Londres un par 2,375 habitants.
La monnaie a pour base le peso fuerte, qui vaut un peu plus de 5 fr.; mais le papier-monnaie, qui a cours forcé, abonde et a pour base le peso moneta corriente, qui vaut 20 centimes. Ces petits papiers sont dégoûtants de saleté. Dans les provinces on se sert des pesos boliviens, qui valent 3 fr.
La dette consolidée de la nation atteint environ 100,000,000 de piastres fortes, ou demi-milliard de francs. Le culte est desservi par 4 évêchés, suffragants de l'archevêque de Buenos-Ayres, qui forme le cinquième. Jusqu'à ces dernières années, un grand nombre de prêtres étaient étrangers et surtout italiens: plusieurs visaient à faire fortune pour rentrer chez eux; maintenant les séminaires, sous la direction de diverses communautés, fonctionnent et donnent un clergé indigène. La religion catholique est celle de l'immense majorité, mais les cultes dissidents sont libres. Il y a encore beaucoup de religiosité dans le pays, et les autorités ne rougissent pas d'invoquer le Très-Haut; j'ai sous les yeux le message par lequel le président de la République, à l'ouverture des Chambres, en mai dernier, rend compte au Congrès des opérations de l'année. Il conclut par ces paroles:
«Dando gracias a la divina Providencia per los beneficios che a dispensado a la Republica, declaro abiertas vuestras sessiones.—Rendant grâces à la divine Providence (p. 137) pour les bienfaits qu'elle a accordés à la République, je déclare ouvertes vos sessions.» La religion catholique est encore la religion d'État, l'art. 2 de la Constitution dit: «El gobierno fédéral sostiene el culto catolico, apostolico, romano.—Le gouvernement fédéral professe le culte catholique, apostolique et romain;» et dans la préface de la même Constitution on lit: «Nos los representantes del pueblo ... invocando la protecion de Dios, fuente de toda razon i justicia, ordonamas, etc....—Nous, les représentants du peuple ... invoquant la protection de Dieu, source de toute raison et justice, ordonnons, etc.»
Mais il arrive ici (ce qui est malheureusement trop fréquent dans les nations latines), qu'on réduit beaucoup trop la religion au culte, qui est le moyen, et l'on ne va pas assez au commandement, qui est le but; en sorte que les francs-maçons profitent des abus pour décrier la religion et ne manquent aucune occasion de la battre en brèche.
L'instruction supérieure est donnée à Buenos-Ayres dans une Université qui comprend les trois facultés de droit, de lettres et de sciences; il y a aussi quelques autres facultés dans les villes de province. L'instruction secondaire est donnée dans des collèges nationaux qui sont loin de professer l'athéisme. L'instruction primaire compte dans la capitale 170 écoles publiques subventionnées et fréquentées par 33,196 élèves; mais dans les provinces, et surtout à la campagne, le besoin d'écoles se (p. 138) fait vivement sentir. Dans la seule province de Buenos-Ayres, qui est la plus avancée en fait d'instruction, sur 116,000 enfants de 6 à 14 ans, à peine 33,000 reçoivent l'instruction, les autres 88,000 restent dans l'ignorance forcée, faute d'écoles.
L'enseignement libre à tous les degrés est amplement répandu dans la capitale et les villes principales. L'assistance publique, les asiles, les hôpitaux sont bien tenus et suffisent à tous les besoins. L'administration de la justice comprend des juges de paix, qui sont compétents jusqu'à 2,000 fr. dans les campagnes, puis des tribunaux ordinaires, des tribunaux d'appel et une Cour suprême.
Mais assez de digressions sur l'État et ses différents services. Revenons à l'emploi de mon temps.[Table des matières]
San Carlo Almagro. — Dom Bosco et ses institutions. — Les Sœurs de Marie-Auxiliatrice. — La Société d'agriculture. — Prix des terrains. — Les œuvres charitables. — Les Lazaristes. — Les Sœurs de Charité. — L'Hospicio de los Mendigos. — La distribution de l'eau. — La fête nationale. — La législation. — Une stancia modèle. — L'autruche et ses mœurs. — Détails sur l'agriculture et l'élevage.
Nous sommes au 5 juillet: après avoir fait de nombreuses visites et reçu partout bon accueil, je prends un tramway et me rends à San-Carlo Almagro, au collège de los artes y officies, confié à la Congrégation de dom Bosco. Je trouve là 200 enfants, dont la moitié appliquée à apprendre les divers métiers d'imprimeur, de menuisier, de serrurier, tailleur, etc.; l'autre moitié suit les classes élémentaires et secondaires. Parmi ces enfants, j'en distingue quelques-uns au teint brun, au visage épaté, à l'œil noir, grand et égaré: ce sont des orphelins patagons; ils parlent l'espagnol et je peux causer avec eux. Ils savent me dire que leur père était cacique de telle et telle tribu; qu'ils ont été pris par les soldats et transportés dans cette maison; mais ils n'en savent pas davantage. Le supérieur m'apprend qu'il y a quatre ans, lorsque le général Rocca, promenant ses 2,000 hommes dans les terres comprises entre le Rio Negro et le Rio (p. 140) Cébut, a chassé devant lui les Patagons qui l'habitaient, a tué ceux qui résistaient et recueilli plusieurs orphelins, les pères de ceux que je vois étaient parmi les morts: il ajoute qu'ils sont intelligents, doux, appliqués, et témoignent d'un grand bon sens.
Près du collège, de l'autre côté de la rue, on a construit un couvent pour les Sœurs de Marie-Auxiliatrice; elles sont 30 dans la Province et 25 novices, parmi lesquelles plusieurs indigènes. La supérieure vient de mourir: celle qui la remplace est fort jeune; elle me fait parcourir la maison et me donne avec timidité les renseignements concernant la Congrégation dans la République. À la paroisse de la Bocca, à Buenos-Ayres, les Sœurs ont un externat avec 200 élèves, et un Oratorio festivo fréquenté par 400 jeunes filles. À Marou, elles ont un collège et externat; à San-Isidro, externat avec 120 élèves et Oratorio festivo; à Carmen, en Patagonie, un externat de 80 externes, et 100 filles à l'Oratorio; toutes leurs maisons ont la Congrégation des Enfants de Marie.
Au collège, une magnifique imprimerie a ses presses mues par la vapeur. Le même moteur donne le mouvement aux scieries mécaniques et autres instruments. Les Pères desservent encore à Buenos-Ayres la chapelle appelée Matris Misericordiæ ou des Italiens; à San-Nicolas, sur le Parana, ils ont un collège avec 70 internes payant 75 fr. par mois. Dans la Patagonie, ils ont à Carmen un collège avec 70 internes et un Oratorio festivo (p. 141) qui réunit 100 enfants. De l'autre côté du Rio Negro, à Biedma, ils desservent une paroisse et dirigent un Oratorio. Ils ont enfin une dizaine de stations dans l'intérieur de la Patagonie, tels que: Conessa, Guardia-Pingle, Choelechoel, Rocca, Nahuel, Huapi, San-Xavier, etc.
Dom Bosco, à Turin, avait été frappé, dès le début de sa carrière sacerdotale, de l'abandon dans lequel étaient laissés un grand nombre de garçons pendant qu'abondaient les asiles pour les filles. Il comprit bientôt combien il importait de s'occuper de l'homme. Depuis deux cents ans, le clergé s'était plus spécialement adonné au ministère plus facile auprès de la femme; mais l'homme n'en demeure pas moins le chef de la famille, et du temps de saint François de Sales les efforts étaient avec raison plus portés de son côté. Je lis en effet dans les écrits de ce docteur (Œuvres complètes de saint François de Sales, tome II. Migne, 1861, p. 427), les conseils que ce saint si doux et si pratique adressait à un de ses confrères: «Comme évêque, vous devez surtout veiller sur deux sortes de personnes, qui sont les chefs des peuples: les curés et les pères de famille, car d'eux procède tout le bien ou tout le mal qui se trouve dans les paroisses ou dans les maisons.»
M. Wagner, notre consul, est parfaitement au courant des choses du pays et adresse au gouvernement des rapports qui seront certainement utiles à la France s'ils ne sont pas enterrés dans les cartons du ministère à Paris; (p. 142) il a habité divers pays à l'étranger, et en observateur attentif il a pu voir le bien à imiter, le mal à éviter.
M. l'avocat Zeballos, président de l'Institut géographique, me donne des lettres pour le Chili, le Pérou et la Bolivie.
À la Société d'agriculture, j'apprends, à propos de prix de terrains, qu'on a vendu dans la quinzaine, à Bahia Blanca, pour 40,000 fr. la lieue carrée (2,600 hectares), des terrains qui avaient été achetés pour 2,000 fr. en 1880; qu'une compagnie anglaise vient d'acheter 70 lieues carrées de terrain au cinquième méridien; qu'une autre compagnie anglaise a acheté 100 lieues carrées à San-Luiz, à raison de 10,000 fr. la lieue, soit 4 fr. l'hectare, et que Richmond et Cie ont proposé au gouvernement de lui acheter 100 lieues de terrain à Santa-Cruz, en Patagonie, au prix de 100 fr. la lieue, à condition de la peupler en cinq ou six ans et d'y établir 200 familles européennes, 50,000 brebis, 5,000 bœufs et vaches. Plusieurs autres particuliers et compagnies font des demandes analogues pour établir des colonies.
M. l'avocat Caranza, qui est à la tête des œuvres charitables, me présente à sa famille et me met au courant de tout ce qui se fait de bien dans la République.
Sa Grandeur Mgr l'archevêque a la bonté de me faire visiter son palais et sa cathédrale. Le palais est seigneurial, et à la cathédrale les autels sont ornés non de tableaux, mais de statues habillées à l'espagnole, avec robes brodées. La nef est vaste, et les salles au service (p. 143) du Chapitre grandes et nombreuses. Sa Grandeur me présente à son vicaire général, dom Spinoza, qui me renseigne sur l'importance du diocèse: il comprend 300,000 âmes, 14 paroisses, 50 églises et chapelles, 9 Ordres religieux d'hommes de toute nationalité et 13 de religieuses, dont 4 cloîtrées. Il veut bien me conduire au bout de la ville, à la Maison mère des Pères lazaristes. Ils sont 6 Pères et 8 novices, dont un Indien; ils font l'école gratuite à 200 externes.
De l'autre côté de la rue, les Sœurs de Charité tiennent le collège de la Providence, où 20 Sœurs instruisent 200 externes et 80 internes payant 100 fr. par mois; elles prennent soin, en outre, de 40 orphelines.
Le dimanche les magasins sont fermés le matin à dix heures, de par la loi. On respecte donc encore officiellement le repos du septième jour. Je prends un tramway et me rends à un des bouts de la ville, au parc de la Recolleta. Il y a là le cimetière del Norte, semé de riches chapelles, tombeaux de familles, remplis d'inscriptions. Sur la plus élevée, je lis Pantheon de l'Association espanola de socorros mutuos. À côté, dans l'ancien couvent des Récollets, on a établi l'hospicio de los mendigos, contenant 220 vieillards et 110 femmes aux soins des Sœurs de la Charité. Elles se louent des bons procédés de l'administration; leurs pauvres sont logés dans de grandes salles à un seul rez-de-chaussée, espacées dans le jardin; ils ont cuisine bourgeoise et le maté deux fois par jour. À côté de l'hospice s'étend un petit parc orné de rocailles, (p. 144) et un peu plus loin je trouve les pompes à vapeur qui pompent l'eau de la rivière dans les réservoirs de distribution pour toute la ville. Les pompes font trente tours à la minute, et chaque coup de piston relève 120 litres d'eau. Elles sont insuffisantes, et on en construit de nouvelles plus puissantes. Je retourne à l'hospicio de los mendigos; l'ancien aumônier de l'hôpital français y prêche en castillan, puis les vieillards chantent des litanies et des cantiques avec l'accompagnement de l'orgue, tenu par un aveugle; les servants ont le vrai type indien.
Le 9 juillet, c'est la fête nationale. En effet, c'est le 25 mai 1810 que les Espagnols furent chassés de ces contrées, et c'est le 9 juillet 1816 que fut déclarée l'indépendance. Ces deux anniversaires sont fêtés tous les ans avec solennité. Les deux généraux qui, par leurs victoires, obtinrent ce résultat, le général Saint-Martin et le général Belgrano, étaient deux chrétiens. Se considérant comme des instruments de la Providence, après leur victoire, ils envoyèrent leurs épées, le premier à Notre-Dame du Carme, à Mendoza, le second à Mercedes.
Le matin, de ma chambre, je vois débarquer quelques compagnies de marins, traînant leurs canons; à midi, des bataillons se rangent sur la place Victoria; mais bientôt une légère pluie les renvoie à la caserne. On fait économie de poudre; pas de coups de canon, pas de cloche: et pourtant ces bruits sont bien faits pour réveiller chez le peuple les fortes émotions. À une heure, les autorités se rangent à la cathédrale sur de superbes (p. 145) fauteuils; un immense et riche tapis en couvre le pavé. L'archevêque entonne le Te Deum, que des artistes chantent en musique; puis on rentre chez soi. Pour moi, je me rends chez l'avocat Lamarca, qui veut bien me donner quelques renseignements sur la législation du pays. Le père peut disposer d'un tiers de ses biens s'il laisse père et mère et pas d'enfants; d'un quart, s'il a des enfants. Il y a dans ce pays des estancieros (propriétaires) qui ont jusqu'à 400 lieues carrées de terre, et des compagnies qui en possèdent jusqu'à 700 lieues; il n'est pas mauvais que d'aussi grandes surfaces se subdivisent. La femme est protégée: elle hérite comme les garçons; la recherche de la paternité n'est pas interdite. L'épouse a droit à la moitié des biens gagnés après le mariage. La famille est assez bien constituée; mais, dans les classes élevées, le père passe trop de temps au club. Les enfants s'aiment entre eux, mais s'émancipent de bonne heure: ils sont aussi plus précoces; les jeunes filles se marient souvent à dix-sept ans, et au même âge les garçons occupent parfois des places importantes, qu'on donne tout au plus chez nous aux jeunes gens de vingt-quatre ans. Les mères n'ont pas toujours une assez forte instruction.
Le soir, à huit heures, la place Victoria est illuminée à giorno, et on tire un interminable feu d'artifice, miniature de ceux qu'on voit en Europe.
Après avoir parlé avec l'avocat Lamarca de mille et une choses, je lui dis: «La estancia[2] est dans votre pays (p. 146) la chose principale à visiter, et j'espère que vous trouverez l'occasion de m'en montrer une.» Il appelle un de ses amis, cause un instant avec lui; ils parlent de lettres et de télégrammes et il me dit: «Demain, vous pourrez aller visiter, à quelques lieues d'ici, la stancia de San-Juan, la plus importante de la province de Buenos-Ayres. Elle appartient à un de mes amis, M. Léonard Pereira. Vous prendrez à la station centrale le train de huit heures du matin, et vous descendrez deux heures après à la station de Pereyra; mais auparavant, vous viendrez chez moi chercher la lettre d'introduction. Êtes-vous levé à sept heures?—Oui.»—L'imprudent! il ne savait pas que je tiendrais parole malgré le déluge de la nuit. À sept heures, en effet, par une pluie battante, j'étais à sa porte, mais, sans le renfort du marchand de lait, malgré la sonnerie électrique et le marteau, je ne serais pas parvenu à la faire ouvrir. La lettre était prête, mais il fallait prendre le train de dix heures, et on m'avertissait plaisamment d'avoir à porter une ceinture de sauvetage. La recommandation n'était pas de trop, car il pleut depuis trois mois. À peine sorti de la ville, le train traverse, sur des poutrelles de fer, un long espace entièrement inondé. À la station de Baraccas, je vois une ville composée de maisonnettes de bois toutes surélevées de terre d'un mètre et comme sur pilotis. Les rues sont étroites. Quel dommage que sur cet immense terrain vierge on ne laisse pas, comme dans l'Amérique du Nord, des avenues de 40 mètres et des petits jardins. La santé (p. 147) des habitants y gagnerait et les bébés pourraient jouer devant leur maison, sans courir le risque d'être écrasés par les chars. Ces rues étroites sont maintenant couvertes d'une si haute couche de boue, qu'elles sont impraticables aussi bien aux piétons qu'aux voitures; c'est à peine si les cavaliers osent s'y aventurer. Il ne reste aux piétons que les trottoirs.

République Argentine.—Rancho de Pêcheurs.—Arbre appelé Ambico.
La rivière le Riochuelo laisse pénétrer d'assez beaux navires anglais, qui débarquent ici leurs marchandises pour charger les cuirs et la laine. Nous traversons encore une petite ville, puis nous voilà nel campo, soit en pleine campagne.
La prairie s'étend à perte de vue; pas une colline à l'horizon. Les arbres sont rares, c'est à peine si on voit par-ci par-là quelques eucalyptus. La terre est partout si détrempée, que les pauvres animaux font pitié à voir. Aussi, à tout instant, j'en aperçois jonchant le sol, morts ou mourants. Les bœufs sont écorchés sur place, car la peau en vaut la peine; elle se vend environ 40 fr., mais celle de cheval ne vaut que 6 fr., et on l'abandonne; le mouton, avec sa fourrure de laine, semble mieux résister. L'autruche, avec ses longues jambes et ses plumes moelleuses, allonge curieusement son cou de chameau et semble se moquer de l'eau. Les quelques fermes qu'on rencontre ont des maisons en boue couvertes de chaume; c'est le rancho, et à leur approche on voit la vigne, le mûrier, l'oranger, des champs de blé qui sort de terre, des choux énormes, du maïs coupé, de jeunes (p. 148) fèves, et en général tous les fruits et légumes de l'Europe. Les poules, dindons, canards, oies et porcs y sont en abondance. Le bétail paît dans la prairie naturelle, où poussent le chardon et une herbe graminée. On voit aussi de belles prairies artificielles de sainfoin et de luzerne.
À la station de Quilmes, j'aperçois un tramway appelant les voyageurs avec sa trompette. Cet utile moyen de transport se trouve dans toutes les rues des villes des deux Amériques; je ne savais pas que je l'aurais trouvé à la campagne. Cela explique comment on peut, de plusieurs lieues à la ronde, porter les nombreux bidons de lait qu'on voit dans tous les trains. Par-ci par-là je remarque les gardiens de bétail, trottant à la ronde, couverts d'un vêtement jaune ciré comme celui des marins; et presque sur chaque poteau du télégraphe, le ornero, profitant de la pluie, construit son magnifique nid de boue, que des employés démolissent parce qu'il interrompt la transmission des dépêches.
Enfin, à midi, je descends à la station de Pereyra, et je demande au chef de gare s'il n'y a pas là une voiture pour moi; je vois qu'il a de la peine à s'exprimer en castillan et je comprends bien vite que j'ai affaire à un Anglais. Tous les employés de la ligne sont des enfants d'Albion. Il me montre trois chevaux et appelle un grand gaillard botté portant pantalon à la zouave et lui dit: «Voici le monsieur que vous attendez.»
J'enfourche un cheval, et nous voilà galopant et trottant dans la boue, à travers les chemins transformés en (p. 149) rivière, et mieux encore sur les prairies qui les bordent.
Après une demi-heure nous entrons dans un bois d'eucalyptus, nous traversons un superbe parc et arrivons à la maison du propriétaire. Il n'est pas là, mais une lettre, al Señor Ruffino administrador, fait que je suis le bienvenu. Nous ne vous attendions pas par un tel déluge, me dit-il. El tiempo es moeda, répondis-je; si j'attends le beau temps, je pourrais attendre longtemps, car il n'a pas paru depuis trois mois. On me prépare aussitôt un déjeuner confortable, et pendant ce temps j'interroge les deux Ruffino, car ils sont deux frères, depuis quinze ans attachés à la ferme. Leur bisaïeul était Gênois; un des frères a le bras droit coupé. Est-ce le fruit de vos révolutions? lui dis-je.—Non, j'ai reçu un coup de fusil d'un voleur d'animaux.—L'a-t-on attrapé?—Non, il s'est sauvé avec sa bande.
La estancia de San-Juan comprend environ 15,000 hectares, nourrissant 1,000 chevaux, 8,000 bœufs et vaches, 20,000 moutons et 2,000 autruches. Le cheval du pays ne donne aucun profit. Les estancieros le vendent au saladero de 20 à 40 fr., car c'est tout ce qu'on en peut extraire en graisse et en huile. À San-Juan on préfère le laisser mourir surplace; mais on entretient des étalons pour des chevaux de race.
L'autruche aussi ne rapporte presque rien. On néglige la plume et la chair, et on ne mange que les œufs. On en prend l'estomac, qui se vend 5 fr. pour la pepsine. La race américaine est inférieure, comme volume et comme (p. 150) ornement de plumes, à la race d'Afrique. Les mœurs de cet animal, autant que me l'explique le señor Ruffino, sont au moins curieuses: ils s'organisent par tropillas: deux mâles et six à sept femelles: gare aux autres mâles qui voudraient s'adjoindre; ils seraient poursuivis et tués par les deux pachas. Un des mâles construit le nid dans lequel les femelles pondent tous leurs œufs, de dix à douze chacune; puis l'autre mâle les couve durant quarante jours; mais, comme il ne peut en couvrir qu'une partie, les autres pourrissent. C'est comme si l'homme voulait se mêler de faire la nourrice! je crois que si les mâles étaient moins galants et laissaient faire les femelles, elles se tireraient mieux d'affaire. À chacun son métier.
Lorsque le premier poussin paraît, le mâle pique les œufs et y dépose des mouches pour les nouveau-nés. Si l'on touche au nid, le mâle détruit tout, et s'en va ailleurs former un nid nouveau; en sorte que toucher un seul œuf c'est détruire tout un nid.
C'est au printemps (septembre-octobre dans cette hémisphère) que pondent ordinairement les femelles. L'autruche se nourrit d'herbe et en consomme presque autant que le cheval.
Pour les bœufs, M. Pereyra s'applique à l'amélioration de la race; il ne vend pas ses produits au saladero, mais les porte au marché de Buenos-Ayres. Les bœufs de trois ans sont vendus au prix de 250 fr. environ; il vend les taureaux pour la reproduction à des prix plus forts, et jusqu'à 1,500 fr., selon la race. Il vend de 800 à 1,000 (p. 151) bœufs chaque année pour le marché, de 3 à 4,000 moutons de 18 mois à 2 ans, au prix de 10 à 16 fr., selon la qualité. Les moutons produisent une moyenne annuelle de laine mérinos d'environ 3 à 4,000 arrobas, au prix, de 20 fr. l'arroba; l'arroba équivaut ici à 11 kilogrammes environ.
On calcule qu'une cuadra quadrata, un peu plus d'un hectare et demi, soit 16,900mc, peut nourrir 5 bœufs ou bien 12 moutons; or, comme le bœuf vaut 40 fr. et le mouton 10 fr., l'élevage du bœuf est plus productif; toutefois, on tient ensemble moutons et bœufs. Ce qui rapporte encore plus, c'est l'agriculture. On loue pour cela le terrain à raison de 80 fr. la cuadra, ce qui revient à environ 50 fr. l'hectare.
Le locataire y sème le maïs, qu'il vend à raison de 10 fr. les 100 kilos; il l'avait vendu 16 fr. il y a 2 ans et en avait exporté pour 10,000,000 de fr., mais l'an dernier il en a produit pour un tiers de plus, et comme la demande n'a pas augmenté en Europe, le prix a baissé d'autant.
Le personnel de la estancia San-Juan se compose de 50 ouvriers italiens, français et belges; j'y trouve même un berger de la Briga, dans les Alpes-Maritimes. Le salaire est de 80 fr. par mois, plus la nourriture. Une partie des ouvriers sont mariés. La paroisse est fort éloignée; donc pas d'exercice religieux, et ceux qui ont le dimanche libre le passent au cabaret. Pour les mariages et les baptêmes on va à l'église, mais on ignore ce que (p. 152) c'est que la dernière communion; car, en cas de maladie, le pauvre n'a pas 30 à 60 fr. pour payer la voiture qui devrait aller au loin chercher le prêtre; néanmoins, le señor Ruffino m'affirme que ses ouvriers sont de bonnes gens, et qu'il n'a point de coffre-fort ici; il ajoute même qu'il peut confier à chacun de ses gens une somme quelconque pour la porter n'importe où, et qu'il la remettra fidèlement à destination.
Quant au prix de la terre dans ces parages, elle est fort chère et vaut 200 patacones (1,000 fr.) la cuadra de 16,900 mètres carrés, soit environ 600 fr. l'hectare. Ce prix n'est que pour la terre d'agriculture assez élevée pour ne pas craindre les inondations. Cette même terre qui se vend maintenant si cher a été donnée, ou vendue 0 fr. 75 l'hectare. La estancia contient encore 50 cuadras de prairies artificielles: luzerne et sainfoin, et on va les porter à 100 cuadras. La partie réservée à l'agriculture est d'environ une demi-lieue carrée.
Après le déjeuner nous montons en voiture et parcourons le parc. Il comprend plusieurs hectares; ici des bois, là des jardins, plus loin un lac avec des cygnes d'Australie et plusieurs espèces de canards. Je vois les auraucarias brasilienses, les poivriers, les cèdres du Liban, les magnolias, les mimosas, les palmiers, les ligustrums, les dathuras, les grenadiers, les bambous, les lauriers thyms, le tabac, l'abothylum; et dans deux petites serres, le caféier, les arecas, les bégonias, les azaléas et autres plantes des tropiques; il me semble être dans un de nos (p. 153) jardins à Nice, quoique le climat soit ici un peu plus chaud. Par une longue avenue d'eucalyptus le parc aboutit à une station de chemin de fer, particulière à la propriété; 20 ouvriers sont occupés à l'entretien du parc.
Le Señor Ruffino me conduit aux animaux de reproduction. Parmi les taureaux, il m'en fait remarquer un énorme venu d'Écosse; son museau ressemble à celui d'un mouton et le poil est laineux; de son corps pend jusqu'à terre une longue peau de graisse; il a coûté 5,000 fr. Un autre plus grand, venu de Bute (Écosse), a coûté 7,000 fr.; mais les taureaux de race produits par eux sont vendus par le propriétaire 1,500 fr., en sorte qu'il est bientôt couvert de ses frais. Dans la cour est suspendu un lazo, je demande à le voir manœuvrer; il a environ 25 mètres de long: un grand berger des Alpes lombardes le prend, le fait tournoyer et le lance contre un jeune bœuf qui cherche à fuir: il est pris aux cornes et ramené en un instant. À la guerre contre les Espagnols, et dernièrement à la guerre du Paraguay, on a vu les Gauchos manœuvrer habilement cette arme et désarçonner les cavaliers; mais ceux-ci savaient en dernier lieu couper le lazo avec leur couteau effilé. Les bollas avaient aussi été employées dans cette guerre. Cet instrument dangereux consiste en trois balles de plomb, de la grosseur d'un œuf, attachées à trois lanières de 70 centimètres réunies par le bout: le gaucho prend en main la plus petite boule, et, faisant tournoyer les deux (p. 154) autres, les lance contre les jambes du cheval à une grande distance; les boules tournent autour des jambes, les enlacent avec les lanières et rendent la marche impossible; le cavalier à son tour s'était habitué à se retourner lestement et à couper, de la lame effilée de son sabre, d'un seul coup, les dangereuses lanières. Je demande à ce Lombard s'il est ici depuis longtemps et s'il y a sa famille.—Je suis ici depuis cinq ans, mais ma femme est restée en Italie.—Fais-la donc venir, lui dit Ruffino, elle te gagnera comme nourrice 200 fr. par mois. Ce bonhomme venait de déposer deux gros seaux de lait; je le goûte, il est délicieux; le vendez-vous?—Non, dit Ruffino, nous avons essayé, et voici encore les bidons qui le portaient à la ville et les machines à faire le beurre et le fromage, mais nous avons trouvé que, pour notre but, qui est l'amélioration de la race, il est préférable de laisser le lait aux veaux.
Au compartiment des chevaux, je remarque de superbes étalons anglais, allemands, andalous. Le même hangar abrite les moutons; les plus beaux sont ceux de Rambouillet; je vois aussi de très beaux mérinos d'Angleterre et d'Allemagne; on les nourrit avec du foin, du maïs cuit et du son.
Le jardinier est Français et son aide est Belge; je suis venu ici, dit-il, il y a vingt ans, avec mon père; on nous avait placés dans une colonie à l'intérieur, mais nous y étions tracassés par les Indiens; je vins donc travailler à Buenos-Ayres, d'où je suis passé ici; nous étions douze (p. 155) enfants, je n'ai plus qu'un frère vivant; la mort nous dévore tous.
Mais le jour baisse et je rentre écrire ces lignes. Après un dîner assaisonné de vin de Mendoza et de Xérès, je trouve doux le repos de la nuit. M. Pereyra est président de la Société d'agriculture, il commence par pratiquer ce qu'il veut enseigner à son pays. L'enseignement par l'exemple est de tous le meilleur! Qu'il reçoive ici mes félicitations et ma reconnaissance pour la bonté avec laquelle il a mis à ma disposition ses serviteurs et sa maison.[Table des matières]
Retour à Buenos-Ayres. — La nouvelle capitale de la Plata. — Les banques. — Le Musée. — Départ pour Rosario. — Navigation intérieure. — San-Nicolas. — Le pingoin. — La guerre du Paraguay. — Rosario. — San-Juan. — Mendoza et la viticulture. — Inondation dans l'est, sécheresse dans l'ouest. — Un elevator. — Un Allemand colonisateur.
Le soir j'avais dit au domestique: Tu m'éveilleras demain matin à cinq heures, car j'ai à écrire.—Bueno, Señor. Or, à six heures, le silence n'était encore interrompu que par le chant des coqs et la pluie diluvienne. Après une heure de travail je vois que le moment de s'acheminer à la gare est arrivé, car elle est assez éloignée, et le train part à huit heures; mais, à mon grand étonnement, je constate que la porte est fermée à clef, et que, seul habitant de la maison, j'y suis prisonnier. J'ouvre des fenêtres aux quatre points cardinaux et j'appelle de toute la force de mes poumons: silence complet. Je passe sur une terrasse, mais les briques glissantes me font faire la culbute, et, pour me débourber, je frappe fortement des mains; ce fut mon salut. Deux chiens ont entendu le bruit et aboyent si fort que le domestique paraît. Viens (p. 158) donc m'ouvrir et mets-moi vite en voiture, car j'ai affaire à Buenos-Ayres et je ne puis manquer le train. Ce brave homme, un peu confus, fait des prodiges d'activité, et en quelques minutes il m'a brossé, servi le café et mis en voiture. Une demi-heure après, j'étais à la station, où le chef de gare me sert gentiment une tasse de café qu'apporte sa fillette. Est-ce le changement de pays ou de climat qui donne ici tant d'amabilité à la froide nature anglaise? Il ne s'arrête pas là, mais il répond à mes questions et me fournit des détails sur la nouvelle ville de la Plata qu'on est en train de construire pour servir de capitale à la province de Buenos-Ayres. Jusqu'à ces derniers temps Buenos-Ayres était capitale de la province et de la fédération, et s'en prévalait pour imposer sa volonté aux autres États; mais, en 1880, lors de la dernière élection présidentielle, les autres États conspirèrent, cernèrent la ville et l'assiégèrent durant un mois. Après avoir perdu environ 3,000 hommes de part et d'autre en divers faits d'armes, la ville se rendit, et il fut stipulé qu'elle serait désormais la capitale de la Confédération, qu'à cet effet tout pouvoir de police et autre dans la ville appartiendrait au pouvoir fédéral, et que la Province aurait à se construire une nouvelle ville et à y transporter ses autorités. Tuer 3,000 hommes pour obtenir ce résultat dans un pays qui a tant besoin de bras, c'est peu sage! Mais cette ardeur à guerroyer s'explique par le grand nombre d'individus qui, fuyant le travail, préfèrent vivre de la politique, en attendant la récompense (p. 159) du parti vainqueur. Soumettre ces gens-là au travail serait délivrer le pays de sa plus grande plaie.
La nouvelle ville de la Plata sera assez éloignée de la mer et du fleuve, le terrain étant trop bas à la côte; mais on projette un canal depuis Encenada, située à 12 milles à l'entrée du fleuve. La ville est tracée, les rues sont larges de 20 à 40 mètres, et le terrain s'y vend de 1 à 3 fr. le mètre carré, selon qu'il est plus ou moins central. Beaucoup de spéculateurs l'accaparent et feront probablement de belles fortunes.
Enfin le train arrive avec une demi-heure de retard: c'est assez habituel, ici. Les plaisants traduisent le terme espagnol ferro-carril par le mot ferro-charrette; la vitesse en effet n'est pas grande (20 kilomètres à l'heure). J'ai encore une fois, le long de la route, le triste spectacle d'animaux morts et mourants; on dit que la perte s'élève déjà à plusieurs millions de têtes, et tous les jeunes agneaux sont perdus. Le dernier recensement donnait les chiffres suivants pour le bétail vivant sur les terres de la République: 2,000,000 de chevaux, 6,000,000 de bœufs et 80,000,000 de moutons.
À dix heures je descends à Buenos-Ayres, où ma première visite est à London and River Plate Bank, pour regarnir ma bourse. N'est-il pas regrettable que, dans une ville qui renferme 40,000 Français, faute de banque française, il faille avoir recours à une banque anglaise[3]? (p. 160) Et pourtant il y a au moins 15,000,000 de francs de dépôts d'argent français dans les diverses banques de la ville, et les Italiens, qui ont établi ici une banque avec un capital ne dépassant pas 5,000,000 de francs, font d'excellentes affaires. Quelques établissements financiers français ont bien envoyé des éclaireurs étudier la situation, mais c'étaient des hommes de bourse, et voyant que les transactions de bourse avaient ici peu d'importance, ils ont jugé que la place ne méritait pas une succursale. Or, les opérations de bourse ne sont pas le seul aliment aux banques, ni le meilleur: le commerce et l'industrie devraient mieux attirer leur attention. Les banques nationale et provinciale ici attirent des dépôts considérables, pour lesquels elles donnent un intérêt de 2 à 3%, et elles prêtent ce même argent à 7% l'an, réalisant ainsi des millions de bénéfices. Le terme du prêt est d'un an, amortissable par quart, chaque trois mois. Contrairement aux usages financiers, ces banques ont un privilège sur l'hypothèque, mais elles sont obligées de fournir tout renseignement sur le montant des prêts, aux personnes qui en font la demande.
De la banque je passe au musée; il est fermé les jours de pluie, mais on veut bien faire exception pour l'étranger. Les collections ne sont pas grandes; toutefois les amateurs peuvent voir ici un grand nombre de squelettes fossiles d'animaux antédiluviens et spécialement de cryptodons avec leur énorme carapace. Une d'elles, celle du panocthus, a 2m20 de longueur, avec une queue (p. 161) de 1m20. Les quatre espèces de cet animal, l'asper, l'élongatus, le lœvis, le clavipes, sont représentées encore par les os fossiles de leur bassin. Dans les fossiles on voit aussi un tigre indigène, un scelidotherium leptocephalum à longue tête et herbivore, un mœgatherium, un panochtus tuberculatus et plusieurs tatous. Dans la collection des animaux indigènes, je remarque une espèce d'écureuil volant, la biscacia, espèce de lapin; le petit lièvre de Patagonie, la lionne, les quatre espèces d'onzas ou chats tigres; l'aguarra agnossou du Paraguay, qui tient du loup et du renard; diverses espèces de singes, et le tapir du grand chaco, dit ici la grand bestia, qui tient du sanglier et du cerf. Parmi les oiseaux je distingue diverses espèces de perroquets, le condor et quelques beaux vautours des Cordillières. Les minéraux consistent surtout en spécimens de cuivre de la province de Salta, mais trop pauvres pour mériter l'exploitation. On peut remarquer encore de beaux tableaux en nacre représentant la prise de Mexico par les Espagnols, et la défense héroïque des Indiens ses habitants; et enfin las bollas ou le boleador, qui a tué le général Pax. J'ai déjà dit en quoi consiste cet instrument dangereux.
À trois heures j'étais à la station du chemin de fer, en route pour Rosario. Je trouve M. Wagner, notre consul, qui, ne m'ayant pas rencontré à l'hôtel, était venu me rejoindre au départ pour me remettre quelques notes et adresses.
En attendant le départ, nous causons sur la singulière (p. 162) situation faite aux enfants de Français nés ici. D'une part la loi argentine les déclare enfants du pays, et d'autre part la loi française les considère comme Français et les astreint au service militaire; le résultat est que, pour ne pas servir deux pays, ils restent Argentins. Dans la campagne il arrive même souvent qu'ils aiment à se dire Argentins pour éviter le nom de gringo, épithète de mépris qu'on donne ici à l'étranger. Mais si la loi argentine déclare Argentin tout fils d'étranger né dans le pays, il n'en est pas de même de l'étranger arrivé ici; il conserve sa nationalité, et à 21 ans il devra tout quitter pour retourner en France faire son service militaire; pendant ce temps sa place, parfois péniblement gagnée, sera prise par un autre et le plus souvent par un Anglais ou un Allemand, et à son retour il aura à se refaire une situation. La fondation de maisons solides à l'étranger est impossible dans ces conditions.
On objecte qu'exonérer du service militaire le Français vivant à l'étranger serait une prime à l'émigration: soit, mais où serait le mal? Est-ce que le Français qui s'astreint à vivre loin de son pays ne lui rend pas d'assez grands services par les débouchés qu'il ouvre au travail national?
Les quelques centaines de jeunes gens que, par un amour insensé de l'égalité, vous rappelez tous les ans des quatre coins du globe, ne grossiront pas beaucoup votre armée; mais, par contre, leur travail interrompu, leur situation compromise font perdre d'incalculables richesses au commerce et à l'industrie nationale. Les Allemands (p. 163) mêmes, si intraitables en fait de service militaire, exonèrent de cette charge leurs sujets chefs de maisons établis à l'étranger.
Mais déjà le sifflet a annoncé le départ et nous voici en route.
Le train remonte la rive droite de la Plata, passe devant le parc de la Recolleta, longe la vaste et récente construction des prisons, et, trois heures après, il atteint la station de Campana, au bord du Parana, un des affluents de la Plata. Là, nous montons sur le Parana, navire à hélice de 600 tonneaux; il appartient à la Compagnie des Chargeurs Réunis du Havre, et est destiné aux voyages entre Buenos-Ayres et Bahia Blanca sur la côte du sud. Il sort tout neuf des chantiers de Glascow et vient d'arriver du Havre. N'est-il pas regrettable que nous en soyons encore à faire construire nos navires en Angleterre, même après la prime à l'armement! Nos armateurs ne feraient-ils pas mieux, par un sentiment patriotique, de s'entendre pour créer un chantier modèle, qui aurait assez de travail pour atteindre les prix des constructeurs anglais? D'autres nations demanderaient à leur tour des navires à ces chantiers, et l'on ne serait pas tributaires de l'étranger dans cette importante industrie.
Après la manœuvre du départ, le capitaine laisse la direction du navire à deux pilotes, toujours habiles à éviter les bancs de sable, et durant le dîner il nous raconte son heureux voyage du Havre ici, exécuté directement en vingt-cinq jours.
(p. 164) La Compagnie Navarello, de Gênes, vient d'acquérir le Sterling Castle, qu'elle a baptisé le Sud-America. Ce navire, sorti des chantiers de Glascow, jauge 6,500 tonnes; il a 135 mètres de long et une force de 8,599 chevaux effectifs; il file 18 nœuds et franchit en quinze jours la distance de Buenos-Ayres à Gênes. Les Chargeurs Réunis ont maintenant 5 navires en construction, qui pourront filer 21 nœuds; ils sont destinés à la navigation dans le Parana et l'Uruguay; le fret en vaut encore la peine: il se paye 35 et 40 fr. la tonne entre Corrientes et Buenos-Ayres, et même entre Santa-Fé, Rosario et Buenos-Ayres, pour une distance de 40 à 80 lieues, pendant que pour les voyages d'outre-mer la concurrence a fait baisser le fret à 12 et 15 fr. la tonne pour un parcours de 2,000 lieues. Sur ce prix, il faut souvent encore envoyer les marchandises à Lille ou à Tourcoing, ou ailleurs. M. Matthey, agent de la Compagnie des Transports maritimes, vient de me dire que, pour ne pas avilir davantage le fret, il vient d'envoyer sur lest, à Marseille, le grand navire la France.
Les Chargeurs Réunis ne sont pas les seuls à voir les bénéfices qu'ils peuvent recueillir de la navigation fluviale en ces contrées: on dit que les Allemands construisent à leur tour 3 bateaux dans le même but, et que déjà le planteur et l'éleveur de ces provinces se réjouissent en pensant que bientôt la concurrence leur permettra de faire porter à bas prix leur blé, leur maïs, leur sucre et leurs bestiaux.
(p. 165) Pendant que nous causons navigation, à côté de nous quelques jeunes Argentins font grand vacarme à propos de questions religieuses; il me semble comprendre qu'il s'agit des couvents: ils sont aux prises avec un jeune Génois qui se passionne et sort souvent des limites de la discussion courtoise; à la fin, au désespoir de ne pouvoir convaincre ses adversaires, il se démonte et part en protestant qu'il voudrait étrangler le dernier des papes avec les boyaux du dernier des moines! Pauvre insensé! combien comme lui sont dupes de doctrines habilement présentées pour séduire la jeunesse sans expérience? Je préfère m'entretenir avec un Alsacien, qui s'occupe en ce moment, à Corrientes, de la plantation de la canne à sucre. Il est sans capital, mais associé au gouverneur du pays, qui fournit l'argent nécessaire avec partage des bénéfices. Il emploie environ 200 Indiens, auxquels il donne un salaire de 40 fr. par mois. De plus, le gouverneur y fait quelquefois travailler les 50 soldats à sa disposition 23 hectares sont déjà plantés, et bientôt on en aura 100. L'usine est en construction. Il compte que chaque hectare lui donnera 30 à 40 tonnes de cannes, au rendement de 6%. Sur ce, dix heures sonnent et je grimpe dans ma couchette pour le repos de la nuit.
Le lendemain, à sept heures, le soleil se lève radieux. Avec quel plaisir on le salue lorsqu'on le revoit après une longue absence! À huit heures et demie, nous arrivons à San-Nicolas. Cette jeune ville, perchée sur une petite élévation de la rive droite du Parana, compte (p. 166) environ 10,000 habitants. Plusieurs navires sont en chargement, entre autres le Frigorifique et un navire anglais chargent des viandes pour l'Europe. Le premier la conserve par le froid, produit au moyen de l'évaporation par l'éther; le second, par le froid produit par l'irradiation de l'air comprimé, système australien plus économique.
Pendant que le Parana décharge les marchandises à destination de San-Nicolas, je parcours la ville. Les maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée couvert en terrasse; les rues se coupent à angle droit, mais elles sont étroites; la place, plantée d'arbres, a son plus bel ornement dans la vaste église de style roman avec superbe coupole. J'aurais voulu visiter le collège que les Pères de dom Bosco dirigent dans cette ville; mais, d'une part, la boue rend la circulation impossible, et, d'autre part, le sifflet de la machine me rappelle à bord. À dix heures, l'hélice recommence à tourner, et tout en remontant la rivière, je me promène à bord avec un Argentin complaisant qui veut bien me parler de son pays. À propos des qualités de terre, il me développe une longue théorie sur le pasto fuerte, herbe dure qui convient aux chevaux, aux bœufs, et sur les pâturages tendres appropriés aux brebis; il me répète le mot du pays: el pato de la vaca hace el terren: «le pied de la vache forme le terrain.» Il m'apprend que le blé, à Santa-Fé, donne de 12 à 15 pour un, mais il donne le 20 à Rosario, et, à propos de mesure et de prix, il me nomme tant de mesures et de monnaies argentines et (p. 167) boliviennes que c'est à s'y perdre. Comme je déplore devant, lui l'absence d'un système métrique adopté par le monde entier, il me dit que ce système a été introduit par la République, mais qu'il faudra encore longtemps avant qu'on ait quitté la routine des anciennes mesures. Il s'en va à l'Assomption, capitale, du Paraguay, qu'il atteindra d'ici en cinq jours de navigation.
Ce malheureux pays, après avoir essuyé la tyrannie de Francia et de Lopez, fut lancé par ce dernier dans la guerre insensée avec le Brésil. Cette guerre, qui a presque ruiné le vainqueur, a détruit le vaincu: 100,000 Paraguiens ont péri, et, après la conclusion de la paix, le pays ne contenait plus que 10,000 hommes, un homme pour 16 femmes. Il se repeuple maintenant sous l'administration réparatrice du président Cavaliero, qui a un Français pour ministre des affaires étrangères. Le capitaine, qui se repose de nouveau sur ses pilotes, me parle de la chasse du pingouin, qui se fait sur les côtes de la Patagonie. Cet oiseau, assez stupide pour se laisser tuer à coups de bâton, donne beaucoup d'huile, et on le chasse durant six mois; mais il faut attendre sur place les autres six mois pour compléter la cargaison. Quelques-uns de ses amis y ont fait naufrage dernièrement. Jetés sur une île, ils ont réussi à gagner la côte, mais pour y servir de pâture aux indigènes.
À deux heures, le navire stoppe à Rosario. C'est la deuxième ville de la République; elle a 40,000 habitants. Ses rues ont environ 10 mètres de large; les maisons (p. 168) n'ont qu'un rez-de-chaussée couvert en terrasse; les patio ou cours intérieures sont garnies d'arbres et de plantes. Dans celle de l'Hôtel Universel, où je descends, je remarque un superbe araucaria et un beau magnolia. L'église est en reconstruction; on l'agrandit et on lui donne une coupole. Elle est la seule paroisse pour 40,000 âmes. Les protestants ont leur chapelle. Sur la place, on vient de poser un beau monument en marbre blanc de Carrare; sur une colonne corinthienne se tient debout la statue de la République argentine, et aux quatre angles, au bas de la colonne, on voit les deux généraux et les deux juristes fondateurs de l'indépendance.
Le téléphone enlace la ville comme dans une toile d'araignée, pendant que beaucoup de nos cités de France ne le connaissent encore que par les journaux.
Notre consul, dans la capitale, m'avait remis une carte pour M. Bernard, notre vice-consul ici, et M. Benausse, à Montevideo, m'avait donné une lettre pour son correspondant, M. Couziers. Ces messieurs n'étaient pas chez eux, mais le soir, ils ont l'obligeance de venir passer la soirée chez moi, à l'hôtel. J'avais l'intention de poursuivre mon chemin dans l'intérieur et de gagner le Chili à travers la Cordillera de los Andes. Les correspondances de la Plata insérées dans l'Économiste français m'avaient fait croire que le chemin de fer était ouvert jusqu'à Mendoza, au pied des Andes; le renseignement était faux. Le chemin de fer andin s'arrête à San-Luiz, (p. 169) et il faudra encore plusieurs mois pour qu'il soit achevé jusqu'à Mendoza. D'autre part, il y a un horaire différent pour chaque jour de la semaine, et les trains s'arrêtent le soir pour repartir le lendemain. Sur plusieurs lignes, pas de train le mardi.
Les Argentins disent: El martes y el viernes no te casar, no t'embarcar. «Ne te marie pas et ne te mets pas en voyage le vendredi ni le mardi.» Le préjugé contre le mardi est encore plus fort que contre le vendredi! Double preuve de la sottise humaine!
M. Couziers, qui a habité longtemps San-Luiz, m'affirme que le courrier du Chili passe les Andes, même en hiver, et, quoique de temps en temps quelque piéton y reste sous la neige, il croit que je peux m'aventurer. Mais M. Bernard a fait lui-même ce voyage: parti d'ici pour atteindre Lima du Pérou à travers la Bolivie, il est revenu du Chili par la Cordillera dans un voyage qui lui a pris près de deux ans. Or, c'était la fin de l'hiver lorsqu'il repassa la Cordillera, et il dut faire la route à pied, conduisant sa mule par la bride, sur la neige glissante. De plus, comme la neige se ramollissait pendant le jour, menaçant de l'engloutir, il ne pouvait voyager que la nuit. Il m'assure que ces montagnes, dépourvues de toute végétation, sont loin de présenter l'aspect pittoresque de nos Alpes. Je ne suis pas si amateur d'aventures pour risquer ma vie sans nécessité, et des deux interlocuteurs je me rends plus volontiers à celui qui ne rapporte pas des dit-on, mais parle d'expérience. Je (p. 170) renonce donc à passer la Cordillera, et, rebroussant chemin, j'irai prendre à Montevideo le navire de la Pacific Steam Cie, la seule qui a un service périodique pour le Chili à travers le détroit de Magellan.
M. Bernard m'apprend qu'il y a 1,000 Français à Rosario et 3,000 dans la province qui a pour capitale Santa-Fé. Ils sont presque tous Basques ou Béarnais. La ressource principale est toujours l'élevage du bétail, la terre vaut environ 100,000 fr. la lieue carrée, soit les 2,500 hectares, dans les environs de Rosario, ce qui fait 40 fr. l'hectare; plus loin, on l'obtient à 15,000 fr. la lieue carrée. Plusieurs, au lieu de l'acheter, la louent: le prix de location représente le 6 à 7% du capital.
On a installé de nombreuses colonies dans cette province: ce sont ordinairement des Italiens, des Allemands, des Suisses, voir même des Russes. On donne au colon le passage gratuit, une certaine quantité de terre, les animaux et les instruments aratoires; mais il doit construire sa maison de terre, s'il ne veut vivre au bel air, et prendre a crédit chez l'almacen (magasin). Or, il se plaint que l'almacen, par son usure, lui prend tout le bénéfice, et celui-ci, à son tour, dit qu'il se ruine, parce que plusieurs colons ne peuvent le payer. Toutefois, si le colon est énergique et persévérant, après les dures épreuves des premières années, si la terre qu'il a reçue est bonne, elle le dédommage de ses fatigues par d'abondantes récoltes.

République Argentine.—jeune Indienne.
Les plus hardis s'en vont au loin sur les confins des (p. 171) Indiens ou tentent des entreprises nouvelles. Ils luttent contre l'indigène, contre la nature, couchent en plein air, le revolver au poing, mangent quand et comme ils peuvent; mais ils sont souvent amplement récompensés. M. Bernard me cite un Français qui, venu ici comme maçon, après avoir gagné une centaine de mille francs en travaux et spéculations diverses, a osé, avec cette petite somme et le crédit qu'il a trouvé, entreprendre une plantation de cannes et la construction d'une usine à sucre. Le bénéfice s'est élevé à 150%. Il aura cette année un produit de 7 à 800,000 fr. Un autre Français, garçon boulanger, a réussi également à implanter à Santiago del Estero un établissement sucrier qui vaut maintenant environ 10,000,000 de francs.
On commence à cultiver l'arachide dans la province de Santa-Fé, et la vigne à San-Juan et à Mendoza. Certains propriétaires récoltent déjà 7 à 800 barriques par an d'un vin fort et noir qui, fortement baptisé, se vend ici sous le nom de vin français; un jeune Français est même venu installer à Rosario une fabrique de vin fait avec le raisin sec. On boit dans ces pays du vin blanc de San-Juan qu'on pourrait facilement faire passer pour du Porto, du Xérès ou du Madère.
Si les provinces de Buenos-Ayres et de Santa-Fé souffrent des inondations, celles de l'ouest, par contre, se plaignent de la sécheresse. La pluie est fort rare à San-Luiz et à Mendoza, et on n'obtient les produits que par l'arrosage. Dans l'Arioja, depuis deux ans, on n'a pas vu (p. 172) une goutte de pluie; la famine menace les habitants, et on quête pour eux dans les autres provinces.
Rosario vient d'inaugurer une nouveauté dans ce pays: un elevator dans le genre de ceux de l'Amérique du Nord; M. Schlieper, à qui M. Tornquist m'avait recommandé, veut bien m'y conduire. Il contient 70 caisses de fer de forme hexagone et disposées comme les briques des pavés de Marseille. Chaque caisse contient mille hectolitres. Le blé, porté au pied de l'elevator par les bateaux du Parana ou par le railway de Cordoba, est nettoyé au moyen d'une machine à vanner, s'il en a besoin; puis porté à la hauteur de 25 mètres par des godets qui se meuvent dans des tuyaux en planches. De cette hauteur on le dirige dans une des caisses après avoir été pesé et mesuré, toujours au moyen de la même machine. Pour cela le blé passe dans d'énormes cubes d'une capacité connue; le fond du cube étant une bascule, on a en même temps la capacité et le poids. La compagnie donne à l'entreposant un certificat constatant la quantité et la qualité du blé déposé. Ce certificat peut être nominatif ou au porteur. L'établissement a été fait par des Américains du Nord, et a coûté 400,000 fr. Il ne fonctionne que depuis un an, et déjà la compagnie a pu baisser les prix de moitié. On paie maintenant, pour vanner un hectolitre de blé, dix centimes; pour la réception et le pesage, cinq centimes; pour l'entrepôt, cinq centimes durant le premier mois, un peu moins pour le second. Pour remplir un navire il suffirait d'ouvrir la soupape d'une ou de plusieurs (p. 173) caisses, mais les navires ne sont pas encore ici organisés pour cela, et la soupape ne remplit que des sacs qui glissent par des planches jusqu'à fond de cale. Du haut de l'elevator nous dominons la ville, que baigne le Parana coulant autour d'îles gracieuses. Son cours est capricieux et change assez souvent. L'œil se perd à l'ouest dans la pampa, plaine qui s'étend comme une mer sans fin; pas un seul arbre à l'horizon; il me semblait voir la grande prairie du Far-West dans l'Amérique du Nord. C'est là que le Gaucho, mi-Indien mi-Espagnol, joue de sa guitare en gardant les troupeaux.

République Argentine.—Gaucho jouant de la guitare dans la pampa.
Près de l'elevator se trouve, d'un côté, un moulin à vapeur, en sorte que ce pays qui, il y a cinq ans, tirait encore de la farine des États-Unis, pourra bientôt en exporter. Le prix du blé varie de 10 à 20 fr. l'hectolitre.
De l'autre côté de l'elevator est placée la gare du chemin de fer de Cordoba; elle est encombrée de machines et de wagons, et sur les colis je lis presque constamment Liverpool; j'aurais préféré voir plus souvent le nom de nos manufactures de France. Ces chemins de fer prennent tous les jours plus d'importance, surtout depuis le développement de l'industrie sucrière et vinicole; mais, si le chemin de fer projeté entre Bahia Blanca et les Andes, par un passage plus accessible, à 150 lieues au sud de Mendoza, se réalise, le trafic vers le Chili sera en partie perdu de ce côté-ci. Néanmoins, Rosario, située sur le Parana, au point extrême qu'atteignent les navires (p. 174) d'outre-mer, et tête de ligne du chemin de fer de Cordoba et de Tucuman, centralisera le commerce de l'immense plaine de la Pampa et aura certainement un grand avenir. Déjà les terrains à bâtir se vendent 10 francs le mètre carré, et le vice-consul, pour sa petite maison, paie un loyer de 2,600 fr.
Le navire qui doit me ramener à Buenos-Ayres devait arriver ce matin à neuf heures. À trois heures il n'a pas encore paru, et le télégraphe fait savoir qu'un déraillement du train, à Campana, a produit sept heures de retard. Rien d'étonnant en cela; les pluies continuelles ont tellement détrempé le terrain, et la plaine à droite et à gauche de la chaussée du chemin de fer est depuis si longtemps inondée, qu'il faut s'étonner de l'absence de plus grands malheurs.
Le déraillement n'a été qu'une perte de temps; les voyageurs n'ont pas souffert.
À quatre heures le Diana arrive. Je salue notre vice-consul, qui s'inscrit à la Société de géographie commerciale de Paris, et j'arrive au navire, qui lève l'ancre à cinq heures.
Cette fois la compagnie est meilleure: j'ai en face de moi un grand Allemand à l'air distingué; il parle à droite avec un autre Allemand, à gauche avec un Anglais. Je lie à mon tour conversation avec lui: j'apprends que, parti pour Mendoza, il s'est aperçu à Rosario de la disparition de ses malles, et retourne à Campana pour les chercher; mais on suppose qu'on les aura embarquées (p. 175) dans un autre navire qui, par erreur, les aura transportées dans le Haut-Parana.
Les malles sont une des plaies du voyageur; il faut qu'il les surveille d'un œil attentif. Pour moi, il y a longtemps que j'y ai renoncé: je n'ai jamais qu'une valise. Mon interlocuteur me dit qu'il vient examiner le pays pour y fonder une colonie, mais il rencontre quelques difficultés. Les personnes peu sérieuses qui, jusqu'à ce jour, se sont mêlées de ces entreprises, ont laissé des préventions contre tout individu qui demande des terrains dans le but de coloniser. Pour lui, il appartient à une vieille famille de Poméranie, et, tout en se créant une belle situation, il veut, par l'accomplissement des devoirs de paternité sociale, faire le bonheur de ses compatriotes qu'il amènera dans le pays. Il regrette pour l'Allemagne l'absence d'une politique coloniale, mais il espère qu'après la mort de Guillaume, le futur empereur l'inaugurera. Le gouvernement lui offre gratuitement plusieurs lieues carrées de terrain, dans les environs de Bahia Blanca; mais il lui impose l'obligation d'y introduire des immigrants dans le délai de deux ans, à raison de vingt familles par lieue carrée, ce qui donnerait à chacune un peu plus de 100 hectares. Il s'en va à Mendoza pour visiter des terres au pied des Andes et se décider, après comparaison. Il a été frappé de l'incrédulité qui règne ici parmi les gens venus d'Europe.
Il compte que chaque famille, pour l'entretien, jusqu'à la première récolte de pommes de terre, construction (p. 176) de maison, fourniture des animaux et instruments aratoires, lui coûtera à peu près 1,000 fr., qui seront remboursés par annuités.
On m'a dit que ce jeune Allemand est un parent de Bismark; j'applaudis à ses efforts et lui souhaite bon succès.
Il était près de minuit, que nous causions encore sur les questions sociales, recherchant les causes du communisme en France et du socialisme en Allemagne. Nous gagnons nos cabines, et le matin à cinq heures, le sifflet de la machine nous apprend l'arrivée à Campana, mais il faut attendre le jour; le déraillement de la veille dit combien la route est dangereuse.
À sept heures, la locomotive se met en marche, nous traînant avec précaution à travers la plaine inondée. Sans les barrières de fil de fer qui sillonnent par ci par-là le terrain, on croirait traverser un lac; partout le même spectacle attristant de bêtes mortes ou mourantes. Enfin le soleil se montre à l'horizon, et semble porter sur ses rayons l'espérance.[Table des matières]
Une séance à la Chambre des députés. — Le collège San-Salvador. — L'hôpital. — La charité privée. — Le collège San-José. — Pensées d'un voyageur. — Plantation de la canne à sucre dans les diverses provinces.
À Buenos-Ayres, je commence mes visites d'adieux, mes préparatifs de départ. J'achète des spécimens des curiosités du pays, la conquilia et le maté, le lazo et le boleador, et des peaux de huanaco. À l'Officina national de tierras y colonias, je me munis des documents nécessaires, et M. Latsima, à la douane, me donne ses importants travaux de statistique et une carte pour les études géographiques. À trois heures, je me rends à la Chambre des députés. Il y avait foule, car on discute la grave question de l'enseignement. Les gardes éloignaient les curieux, mais, grâce au député-avocat Zeballos, président de l'Institut géographique, je suis admis et placé dans la première tribune. La salle n'est pas vaste et ressemble à un théâtre de province, dont le parterre est occupé par les sièges des députés et les galeries par le public. Elle sert alternativement aux sénateurs et aux députés; ils siègent trois jours par semaine; c'est de l'économie. Les députés, élus directement par le peuple, à raison de un par 20,000 habitants, sont au nombre de 86; les sénateurs (p. 178) sont 30 et élus au nombre de deux par chaque Chambre des députés de province.
Au moment où j'entre, un député ecclésiastique a la parole: il soutient le projet de loi présenté par la commission et prouve la nécessité de donner l'enseignement religieux dans les écoles; il est souvent interrompu par un ministre, et à chaque interruption les tribunes manifestent leur adhésion à l'interrupteur: il y a évidemment un vent réel ou artificiel de libéralisme dans le public. Les députés ne gardent pas le chapeau sur la tête comme en Angleterre et dans ses colonies; ils s'adressent au speaker, qu'ils appellent ici Président. Les libéraux soutiennent que l'enseignement religieux doit être banni de l'école et qu'il incombe uniquement aux parents et aux ministres des différents cultes; ils reproduisent tous les arguments qui ont été entendus dans les Chambres françaises sur la matière. Ils semblent vouloir prendre toutes les précautions pour réussir et demandent que la Chambre se déclare en permanence jusqu'à la solution de la question. La proposition mise aux voix est rejetée par 31 votes contre 30; les applaudissements d'une partie du public prouvent que plusieurs voudraient voir aboutir le projet de la Commission qui repousse la loi.
Je passe ma soirée chez la famille Carranza, où frères et sœurs jouent sur violon et piano les sonates de Beethoven. Le lendemain je visite l'établissement des Sœurs de la Charité, rue Moreno. Elles ont là 160 internes payantes, (p. 179) 150 gratuites et 20 orphelines internes gratuites. Partout où il y a des Sœurs de Charité on retrouve l'orpheline; elles aiment à se faire les mères des pauvres enfants qui n'en ont plus. La bourgeoisie leur confie volontiers ses enfants. J'ai vu des demoiselles élevées par elles qui parlent parfaitement le français et l'anglais. À la fin de leur éducation, elles les groupent en congrégations d'Enfants de Marie, pour la persévérance dans le bien. Ces jeunes filles ont établi à leurs frais une pharmacie où elles distribuent gratuitement les remèdes aux pauvres. Les mamans vont acheter une maison attenante à l'établissement pour que les bonnes Sœurs puissent y fonder une école professionnelle. Les filles du peuple y apprendront un métier adapté à leur sexe, qui les aidera à gagner le pain quotidien. Cette institution ne semblait guère nécessaire jusqu'à ce jour; la femme ne s'occupait que du ménage, et le travail du mari suffisait à tout; l'abondance était grande, la misère inconnue. Mais la fièvre jaune qui, en 1871, a enlevé 25,000 personnes, a laissé beaucoup d'orphelins, et les révolutions périodiques en ont augmenté le nombre. D'autre part, l'affluence des étrangers pauvres a aussi contribué à apporter la misère, et il faut maintenant que la fille et la femme apprennent à mieux utiliser leurs doigts.
M. Lodola veut bien me prendre à l'hôtel pour me conduire à une conférence de charité, au collège de San-Salvador. Je profite de l'occasion pour visiter le collège. Il a un internat avec 415 élèves qui suivent les (p. 180) divers cours de l'enseignement secondaire. Cet établissement est dirigé par les Pères jésuites espagnols. Au dortoir je remarque que les élèves sont enfermés, la nuit, dans de petites cellules ayant au plafond une toile métallique; le Père prétend que dans ce pays toutes ces précautions sont nécessaires pour préserver la décence et la moralité.
Parlant à un Espagnol, je veux savoir son avis sur les horribles combats de taureaux. À mon grand étonnement, il trouve des raisons pour les justifier comme un exercice et un art. Les préjugés de nation sont si forts qu'ils aveuglent même ceux de qui on attend la lumière: tout art ou tout exercice qui aura pour résultat de torturer les animaux pour le plaisir de l'homme sera toujours contre nature.
Or ce n'est jamais impunément qu'on enfreint les lois de la nature; et si, en guerre, le peuple espagnol est le plus cruel des peuples, c'est que, dès l'enfance, on l'habitue aux spectacles du sang. Heureusement, la République argentine a aboli ces jeux qu'on voit encore à Montevideo.
M. Lodola veut bien me conduire à la visite de quelques familles pauvres; elles habitent les quartiers éloignés de la ville. Dans ces parages, les rues ne sont pas pavées, et sans les trottoirs on ne pourrait circuler; elles ont 0m40 de boue. Dans un endroit nous trouvons même un cheval mort probablement, à la peine pour tirer la charrette ou la voiture embourbée. Après bien des tours et (p. 181) détours nous voyons une jeune fille gracieuse et élégante, sur une porte, et nous nous renseignons auprès d'elle sur l'adresse que nous cherchons; elle nous fait entrer dans un salon: bientôt les frères et sœurs arrivent au nombre de neuf, puis la mère, veuve depuis quelques années. Le mobilier est propre, tous ont des vêtements en parfait état. Je croyais que nous avions fait erreur, mais c'était bien la famille que nous cherchions. En sortant, je témoigne à mon confrère mon étonnement, mais il me dit; C'est une famille de pauvres, honteux; c'est l'exception, et nous avons bien des familles dans la vraie misère. Je tenais à les voir; mais n'ayant pu réussir à trouver les adresses, après avoir interpellé tous les caballeros que nous trouvions, et prononcé bien des caramba, lorsque nous étions embourbés dans un dédale de rues non encore nommées ni numérotées, fatigués par les difficultés de la circulation, nous entrons à l'hôpital qui se trouve sur nos pas. Nous y trouvons les Sœurs de Charité françaises, qui soignent 250 malades hommes. Les femmes sont dans un autre hôpital et confiées à des Sœurs italiennes.
L'établissement est nouvellement construit, le terrain est vaste et planté d'arbres et de fleurs; on a évité ces malheureuses cours qui enferment l'air vicié; les salles sont presque toutes au rez-de-chaussée, mais elles renferment un très grand nombre de lits. Le système allemand, qui ne place que quatre à cinq lits par chambre, fait mieux éviter la pourriture d'hôpital. La cuisine fonctionne (p. 182) par la vapeur, qui, introduite entre les doubles parois des chaudières, chauffe l'eau en quelques minutes. La même vapeur chauffe aussi les bains. Le système d'hydrothérapie est complet.
En parcourant les salles, j'interroge quelques malades: un bon vieillard m'apprend que, déserteur de Gênes, en 1848, il est arrivé ici comme cuisinier. Après avoir amassé un bon pécule, il avait cru l'augmenter en fondant un almacen (nom qu'on donne ici aux magasins de comestibles); il aurait réussi, mais il faisait facilement des crédits à des familles pauvres qui ne l'ont pas payé, et il ne lui reste plus que l'hôpital. Un banquier n'en aurait pas fait autant! Un autre a deux côtes brisées: c'est l'effet d'une rencontre de deux trains qui, il y a trois semaines, a tué plusieurs ouvriers et blessé un plus grand nombre. Le pauvre homme se préoccupe de savoir si la compagnie l'indemnisera. Un jeune homme lit un plus ou moins mauvais journal.—Je m'ennuie, dit-il, j'aimerais bien avoir des livres pour tuer le temps. Je faisais le gaucho à la campagne; l'humidité m'a donné un rhumatisme aux jambes et je ne puis me lever. J'engage M. Lodola à établir à l'hôpital une petite bibliothèque et à faire visiter les malades par ses confrères, qui pourront souvent rendre à plusieurs de précieux services: un grand nombre en effet ont leur famille à l'étranger. Je quitte l'hôpital et m'en vais au loin visiter le collège de San-José, tenu par les Pères baionnais; c'est le nom qu'on donne ici à la congrégation qui tient le collège de (p. 183) Bétharam dans les Pyrénées. Un bon Père me fait parcourir l'établissement. On y donne l'enseignement secondaire à 300 internes. Les casernes d'enfants précèdent celles des soldats. Le jour où les familles sauront élever elles-mêmes leurs enfants, les gouvernements auront moins besoin de soldats pour garder les citoyens.
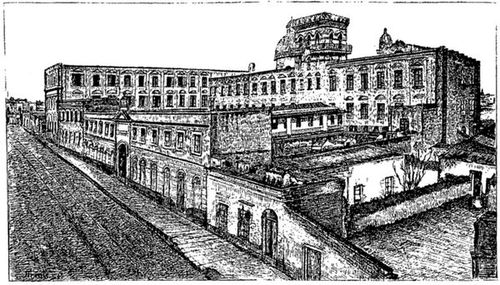
Buenos-Ayres.—collège San-josé.
Au dortoir, je ne vois pas les petites cellules et leur toile métallique: le professeur pense qu'il est plus utile d'habituer le jeune homme à avoir assez de force morale pour se garder lui-même. Nous montons au sommet d'une tour qui semble faite pour un observatoire. Les Pères en effet en projettent la création. Observer le cours des astres, se rendre compte des vents, de la pluie, de l'électricité sont choses utiles que des moines peuvent faire et enseigner, d'autant plus qu'elles sont de mode; il est toujours bon d'être de son temps. Du haut de la tour on jouit d'un magnifique panorama; la ville est à nos pieds. Avec ses maisons basses couvertes en terrasse et laissant percer partout les plantes des patio, elle offre l'aspect d'une ville d'Orient. Les Espagnols ont imité les constructions arabes et en ont porté le goût ici. Le Père me montre au loin la Penitencieria, immense construction où les prisonniers, installés d'après le système cellulaire, sont contraints au travail, et en sont privés lorsque leur conduite laisse à désirer. Il paraît que l'ennui et l'inaction leur est une plus dure pénitence.
Le 15 juillet, dans une librairie où je vais pour chercher la carte géographique et la Constitution de la République (p. 184) argentine, on me présente un album sur lequel des prélats et autres personnes distinguées écrivent quelques pages ou quelques lignes. Il doit se vendre au profit d'une œuvre charitable. On me prie d'inscrire quelques pensées. Les pensées d'un voyageur ne peuvent être que courtes et rapides; les voici telles que je les consigne à la hâte:
I.—L'homme n'est qu'un voyageur sur la terre; il importe qu'à sa mort on puisse dire de lui: il a passé en faisant le bien.
II.—En punition du premier péché, l'homme a été condamné au travail; mais le juge s'est montré père en faisant que l'homme trouve dans le travail accompli sa plus douce satisfaction.
III.—Le but du travail n'est pas la richesse, mais la vertu.
IV.—Il serait facile à Dieu de rendre tous les hommes riches, puisque la terre et ce qu'elle renferme lui appartient; mais comme l'homme résiste difficilement aux dangers de la richesse, c'est par un effet de sa bonté paternelle qu'il tient le plus grand nombre dans la nécessité de demander le pain de tous les jours.
V.—Celui qui s'applique à remplir le but de la richesse en économe fidèle et distribue dûment le superflu, celui-là est sûr de voir affluer vers lui les biens de la terre.
VI.—J'ai visité presque tous les peuples du monde. Je n'en ai trouvé aucun sans religion. La plupart pratiquent (p. 185) la loi de nature, mais tous ont conservé les principales vérités révélées.
VII.—Les catholiques qui ont reçu la vérité tout entière sont obligés à plus de vertu. Lorsqu'ils se contentent d'énumérer leurs privilèges sans correspondre par une exacte fidélité, ils ressemblent aux Juifs qui allaient disant: Nous sommes les enfants d'Abraham! nous sommes les enfants d'Abraham! Or, il s'attirèrent ce reproche: Si vous êtes les enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham!
VIII.—Ceux qui s'appliquent à arracher la religion du cœur des peuples sont les pires ennemis de l'humanité; ils préparent à leur génération des maux sans fin, et ils en seront maudits; mais après l'épreuve et la souffrance, l'humanité revient avec bonheur à la religion comme le pilote balloté par l'ouragan rentre volontiers dans le port.
IX.—Ceux qui prennent le culte pour la religion prennent la partie pour le tout. Ils sont coupables s'ils s'arrêtent au culte qui est le moyen, et ne vont pas au décalogue qui est le but.
X.—Celui qui aime son pays s'applique à lui former une jeunesse vertueuse. Le jeune âge a besoin d'agir: si on ne lui donne le bien à faire, il fera certainement le mal; mais il ne faut pas présenter au jeune homme le travail comme à l'homme mûr, il faut savoir se faire tout à tous.
XI.—J'ai vu souvent des riches se croire les plus malheureux (p. 186) des hommes, et personne n'est exempt de souffrances; mais j'ai vu ces mêmes riches changer d'opinion au sortir de la mansarde du pauvre ou de la salle d'hôpital. En voyant la misère vraie, et la souffrance réelle, ils trouvaient leur lot léger et en bénissaient la Providence.
XII.—Le véritable bonheur pour un cœur bien fait, c'est de faire le bonheur des autres.
M. A. Wagner, fils, dont le frère s'occupe au grand Chaco de la plantation de la canne à sucre, veut bien, sur ma demande, rédiger une note détaillée que je crois bon d'insérer ici.
«Le grand centre de production a été jusqu'à présent la province de Tucuman.
Il n'existe que quelques fabriques de sucre dans les autres provinces du nord, Salta et Jujuy. Cependant, dernièrement, il s'est fondé trois établissements importants dans Santiago de l'Estero. Ce sont les établissements de San-Yermes, Hileret, et Jaymes Vuira.
Dans toute cette partie de la République, la canne à sucre a besoin d'irrigation.
On cultive également la canne à sucre sur les rives du Parana, dans la province de Corrientes, dans les Misiones, et enfin au grand Chaco. Partout la canne vient admirablement.
À Corrientes, les sucreries n'ont pas donné de bons résultats à cause des révolutions incessantes qui ruinent toutes les entreprises agricoles et industrielles.
(p. 187) Les Misiones sont encore trop peu connues et trop peu peuplées pour que l'on puisse y établir une industrie quelconque.
Le Chaco se trouve dans de meilleures conditions que Consentes et les Misiones. Les moyens de communication sont faciles et économiques, tous les transports pouvant se faire par le fleuve. La canne n'a pas besoin d'irrigation, et les terrains sont meilleur marché qu'à Tucuman. On commence aussi à s'occuper sérieusement du Chaco; malheureusement les Indiens sont encore fort à craindre dans cette partie de la République.
Il ne s'est fondé qu'une grande sucrerie au Chaco jusqu'à présent. C'est la colonie d'Ocampo. On doit y travailler l'année prochaine 50 cuadras; j'ignore les dimensions de ces cuadras: celles de Tucuman ont 166 mètres de côté, soit 12,583 mètres carrés, un peu plus d'un hectare.
Toutefois beaucoup de colons de las Toscas, Ocampo, Resistencia et Formosa, s'occupent activement à planter la canne en prévision du rush qu'il y aura sur les terrains riverains du Parana, aussitôt que l'usine Ocampo aura commencé à travailler; et, comme le terrain utilisable sera entre les mains des planteurs, les capitalistes seront obligés de les associer.
Ici la fabrication du sucre rend pour le moment 100 pour cent.
En effet, la production locale étant inférieure à la consommation, les fabricants peuvent écouler leurs produits (p. 188) au même prix que les sucres venant d'Europe; ils profitent donc du montant du fret, douane et commission, qui chargent les sucres étrangers.
Terminons par quelques chiffres qui montreront l'essor qu'a pris l'industrie qui nous occupe, dans les dernières années.
| En 1874, il existait dans la République | 2,297 hectares de cannes. |
| En 1877, """" | 2,487 hectares de cannes. |
| En 1881, """" | 5,403 hectares de cannes. |
C'est-à-dire que, pendant les années qui se sont écoulées entre 1874 et 1877, l'on n'a planté que 63 hectares par an, tandis que de 1877 à 1881 on a planté 729 hectares par an.
Enfin, pour finir, voici le tableau des importations de sucres bruts de 1876 à 1882 (en tonnes de 1,000 kilos):
| 1876 | 8,699 | années de révolution. |
| 1877 | 11,857 | |
| 1878 | 8,900 | |
| 1879 | 7,899 | |
| 1880 | 9,080 | |
| 1881 | 8,726 | |
| 1882 | 7,662 |
La canne atteint une hauteur moyenne de 4 mètres. Elle se plante en juin, juillet, août et septembre, et se récolte l'année suivante pendant les mêmes mois.
(p. 189) La canne se plante couchée dans les sillons; quelquefois l'on place trois cannes côte à côte; d'autres fois l'on place les cannes l'une au bout de l'autre; les deux méthodes donnent le même rendement par unité de surface; la seconde méthode exige moins de cannes pour couvrir un espace donné.
La distance entre les sillons varie également selon les cultivateurs, mais ceux qui espacent bien les sillons en ont un bon résultat.
On récolte de 40 à 60 tonnes par hectare, qui donnent 5-1/2 à 6% du poids brut en sucre et 30 à 40 barils d'alcool.
Les grands établissements se sont presque tous outillés à la compagnie Fives-Lille.
Les procédés de fabrication ne diffèrent en rien de ceux des autres pays sucriers.»[Table des matières]
Retour à Montevideo. — Le bassin de radoub. — Les saladeros au Cerro. — Leur fonctionnement et leurs produits. — La forteresse. — La Société d'agriculture. — Un Parisien éleveur. — La famille Jackson-Buxareo et ses œuvres. — L'hôpital. — L'Hospicio de los Mendicos. — Le maté. — Le manicomio. — Une soirée chez le président du conseil des ministres. — L'embarquement sur l'Aconcagua. — La navigation le long des côtes de la Patagonie. — Le détroit de Magellan. — La Terre de feu. — Arrivée au Chili.
Le 16 juillet, après avoir salué les amis, à cinq heures je suis à bord du Jupiter, de la Compagnie Platense, qui me porte à Montevideo. Le P. Revellière, supérieur des lazaristes, m'avait annoncé qu'un de leur jeunes Pères chiliens se trouverait à bord, et qu'il ferait route avec moi jusqu'à Valparaiso; il me l'avait même présenté.
Je le cherche en vain des yeux, lorsque plus tard un monsieur grand et brun vient à moi et me présente sa carte: je reconnus bientôt mon lazariste en bourgeois. La rivière fut calme et la nuit courte; au lever du soleil, nous étions devant la capitale de l'Uruguay. Après avoir envoyé ma valise à la douane et à l'Hôtel de Paris, nous prenons, le lazariste et moi, un bateau à voile pour traverser la rade et atteindre la pointe du Cerro. Le vent est favorable, bientôt nous arrivons au bassin de radoub Cibils et Jackson. Voici les notes qu'on me donne sur ce (p. 192) magnifique travail, un des plus beaux du genre que j'aie jamais vu. «Ce travail se développe sous l'aspect d'une vaste cuvette aux parois en gradins. Commencé il y a quatre ans seulement, ce bassin, de 137 mètres de longueur, creusé en plein roc, est situé à l'extrémité sud-ouest de la baie qui forme le port de Montevideo. Il est défendu contre les lames venant du sud-ouest, d'abord par une chaîne de récifs, puis par un brise-lames qui forme jetée avec nuisoir pour protéger plus efficacement et par tous les temps l'entrée et la sortie des navires. Ce brise-lames, de 115 mètres de long sur 18 de large, est constitué par un amoncellement de blocs en béton aggloméré, de la forme d'énormes dés à jouer, pesant chacun 10,000 kilogrammes.
Bien que ses parois soient de nature rocheuse, tout le pourtour du bassin est revêtu d'une muraille d'un mètre d'épaisseur, construite en matériaux pris sur place et maintenue par de la chaux hydraulique et du ciment de Portland. Les piliers ou massifs de maçonnerie sur lesquels s'appuient les portes et les arcs renversés qui forment contre-forts pour équilibrer les poussées, sont à chaînes et à bordures de granit taillé. L'ensemble de toute la muraille est telle que l'on croirait le bassin taillé au ciseau dans un bloc énorme de rocher parfaitement homogène. Le plafond en quille est en ciment aggloméré et le berceau sur lequel doivent se poser les navires est construit en solives de fer d'un modèle nouveau et breveté. Le bassin est divisé en deux compartiments (p. 193) égaux, par des portes semblables à celles que l'on voit fonctionner dans tous les ports, c'est-à-dire constituées par des ailes ou battants en bois de teck et de chêne, assujettis et consolidés par des tirants de fer. Ces portes tournent sur gonds logés dans des piliers en granit. La division du bassin permet donc d'employer un compartiment comme radoub et l'autre comme bassin flottant pour le chargement ou le déchargement des navires.
La grande porte, celle qui donne accès de la mer dans le bassin, est un caisson ou bateau de tôle construit d'après le système d'un ingénieur anglais, du nom de Kinniple. Elle glisse avec tant de facilité sur un double rang de galets montés au fond de la passe d'entrée, qu'elle peut s'ouvrir en quelques minutes, et pour ne gêner en rien le passage des navires, elle se loge d'elle-même dans une réserve taillée à coups de dynamite au sein de la masse rocheuse. S'il devenait nécessaire, dans une circonstance donnée, par exemple la réception d'un grand transatlantique, de donner au bassin son maximum de longueur, le bateau-porte peut glisser jusqu'à un point distant de 10 mètres de sa position normale, et il est disposé pour maintenir au besoin l'eau de ce bassin à un niveau plus élevé que celui de la mer. Soumis à des essais répétés, le bateau-porte du dock de Montevideo s'est montré solide, parfaitement étanche et rapide dans ses manœuvres.
Les pompes du dock sont de système centrifuge de MM. Guynne et Cie. Elles sont fournies de vapeur par (p. 194) des chaudières de 40 chevaux et aspirant 27,000 litres d'eau par minute; elles peuvent, d'après les expériences faites, vider le bassin en moins de huit heures. Les dimensions principales de ce travail sont de 137 mètres dans son maximum de longueur, se subdivisant à 78 pour le plus grand des deux compartiments, celui du fond, et 59 pour l'autre; la largeur de la passe d'entrée est de 16 mètres 76 centimètres; la largeur au plafond ou à la quille est de 12 mètres.
À marée basse ordinaire, la hauteur d'eau dans la passe est de 5 mètres; elle est d'un peu plus de 6 mètres à marée haute; son entrée en droite ligne, sans courbe ni coudes, est d'un accès des plus aisés.
Par sa proximité du mouillage des vapeurs transatlantiques et la grande étendue de terrain qu'il possède, le dock Cibils et Jackson offre une grande économie pour la charge et décharge, pour toutes sortes de dépôts, soit de charbon, soit de bois, soit de fer, etc.
Il est aussi pourvu de puissantes grues à vapeur qui parcourent toute la longueur du môle et du dock, au moyen d'un chemin de fer.»
Près du bassin de radoub, se trouve le saladero Cibils, le plus grand parmi ceux qui sont au Cerro. On y tue et prépare de 50 à 70,000 bœufs par an, durant les quelques mois d'été où le bétail est en bon état. Voici comment on procède. À deux lieues environ du Cerro se tient le marché des bestiaux; on y mène les animaux de tous les points du territoire, au nombre de plusieurs milliers par (p. 195) jour. Chaque saladeriste vient s'y approvisionner tous les matins, et les bœufs achetés sont conduits au saladero. Poussés dans un enclos étroit, le lazo les prend un à un par les cornes. La corde du lazo est passée à une poulie et son bout attaché à un cheval qui, en marchant, force le bœuf à avancer jusqu'à ce qu'il serre sa tête contre une barre de bois: là se tient l'exécuteur; il plante un stylet entre les cornes de l'animal, qui tombe foudroyé. Immédiatement il est traîné plus loin, dépouillé de sa peau et dépecé; la chair est séparée des os et passée à ceux qui l'aplatissent et la couvrent d'une couche de sel. On forme ainsi de grandes piles sur lesquelles on pose des planches et des pierres; le lendemain on retourne ces couches de viande pour les saler du côté opposé, et, après vingt-quatre heures sous la même presse primitive, elles sont posées sur des séchoirs de bois, analogues à ceux de nos lessiveuses, pour être séchées au soleil. Le séchage requiert de 30 à 40 jours en hiver; il se fait plus rapidement l'été; mais alors, pour éviter l'action trop rapide du soleil, on retire la viande pour la remettre en pile, et cela pendant trois à quatre fois, à intervalle de quatre à cinq jours. À l'approche de l'hiver, on entasse la viande fraîchement salée dans une immense pile cylindrique où elle se conserve sans se gâter durant trois ou quatre mois. On la sèche à l'approche de l'été. La pile qu'on me montre au saladero Cibils a un diamètre de 8 à 10 mètres et 3 mètres de haut; elle contient 13,000 quintaux de viande.
(p. 196) C'est un triste spectacle de voir ces troupeaux d'animaux poussés à la mort qu'ils voudraient fuir. Le temps aussi pousse impitoyablement les masses humaines vers le point où l'inexorable mort les fauche sans pitié!
La peau de l'animal est mise à sécher: les os, les entrailles, la graisse sont jetés dans de grandes chaudières de fer chauffées à la vapeur. La graisse surnage et s'en va dans des caisses de fer où elle est travaillée, puis elle tombe dans des tonneaux ou pipes de 900 livres, pour l'exportation. Elle sert en Europe à faire les bougies. La moelle des os forme une graisse raffinée qui est mise en boîtes de fer blanc pour l'usage culinaire. Les os retirés des cuves servent de combustible pour produire la vapeur.
On les retire calcinés et on les exporte pour le noir animal. Les cornes sont vendues aussi pour les divers travaux de boutons, peignes, etc. Le sang coule dans un ruisseau et s'en va à la mer, qui en est rougie. On sèche également au soleil une quantité de viande douce, c'est-à-dire non salée, qu'on appelle tajado: elle se conserve quelques mois et on l'expédie surtout au Chili.
Nous passons, un peu plus loin, au saladero Salmiguel, où on opère à peu près de la même manière. Le terrain qui l'entoure est couvert de lambeaux d'entrailles et de fœtus de vache que les cochons dévorent; mais il en reste encore assez pour empester l'air et développer des miasmes dangereux. La municipalité est bien imprudente de laisser subsister de tels foyers d'infection.
(p. 197) Pour distraire la vue et la pensée d'un spectacle si triste, nous montons à la forteresse qui couronne, le Cerro. L'officier de garde nous y laisse pénétrer, et de la plate-forme nous jouissons d'un panorama merveilleux. Au pied de la colline, la rade et ses nombreux navires; de l'autre côté, la ville de Montevideo avec ses clochers, ses coupoles, ses faubourgs; au loin, las Pedras, l'île de Florès, et à l'horizon le Cerro du pain de sucre, chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'au Brésil.
Après avoir fait le tour de la citadelle, remarqué son phare à pétroleuses canons vieux et jeunes de tout calibre, et salué son peloton de soldats, nous redescendons la colline et nous arrêtons au saladero de Barraca Blanca, où son propriétaire, M. Charles Clausole, veut bien me donner de nombreux détails sur l'industrie des saladeristes. Les bœufs sont achetés au prix moyen de 20 à 22 patacons (de 100 à 120 fr.) et donnent environ 155 livres de viande chaque. La viande grasse, dite taxaco, ou carne gorda, est mise en sacs et expédiée par paquebots au Brésil, où elle sert à la nourriture des esclaves. La viande maigre, dite havanera, se conserve plus longtemps; elle est mise sur bateaux à voiles et expédiée à Cuba, où elle sert également à nourrir les esclaves.
Le prix varie entre 20 et 30 fr. le quintal de 56 kilog; pour la carne gorda, qu'on vend 1 fr. 25 le kilogramme au Brésil, et de 20 à 23 fr. le quintal pour la carne havanera. La peau de bœuf (noviglio) pèse de 68 à 70 livres, celle des vaches pèse de 52 à 54 livres; leur prix est de (p. 198) 34 fr. les 75 livres. Le bœuf donne en outre de 37 à 40 livres de graisse, et la vache de 40 à 45; on la vend au saladero 10 fr. les 25 livres; la graisse raffinée pour cuisine vaut 28 raux, soit 14 fr. l'aroba de 12 kilos. Les os calcinés se vendent 110 fr. la tonne de 1,000 kilos. Les cornes de première qualité valent 500 fr. le mille ou 10 sous pièce; celles de vache et celles dont les bouts sont coupés se vendent moitié prix.
Le prix de la main-d'œuvre varie selon l'emploi: en général, les travailleurs sont payés à la pièce et le salaire moyen est d'environ 5 fr. par jour. M. Clausole emploie 60 hommes, qui arrivent à tuer et à préparer environ 60 bœufs par heure, un à la minute: il lui en faut 30 autres pour le séchage de la viande et la préparation des graisses. Le sel est apporté sur lest de Cadix et lui coûte 3 fr. la fanega de 3 quintaux, soit environ 1 fr. les 100 livres; le même sel passe deux fois sur les chairs, et une sur le cuir. Il calcule que chaque animal lui coûte en moyenne 5 fr. pour l'abattage, préparation et séchage, et que le bénéfice net se réduit de 3 ou 4 fr. par tête d'animal; mais la concurrence entre les saladeristes a poussé les prix si loin que souvent on est en perte.
Les saladeristes préparent aussi les chevaux; ils les achètent au prix modique de 10 à 20 fr.; le cuir vaut de 6 à 10 fr., et chaque cheval produit de 1 à 2 arobas d'huile, du prix de 7 à 8 fr. l'aroba de 12 kilos. Cette huile, mise en pipe, ne se congèle pas; elle sert à la savonnerie et à oindre les machines. Le crin est mis à part et vendu (p. 199) pour rembourrer les meubles. La chair maigre sert à engraisser les cochons. M. Clausole prépare ainsi dans son saladero environ 10,000 chevaux par an.
Pendant qu'on nous explique tous ces détails, notre embarcation à voile arrive du bassin Cibils, où nous l'avons laissée, et, par un vent favorable, nous ramène, rapide comme l'éclair, vers Montevideo. En route, j'aperçois le drapeau national à l'arrière d'un navire: c'est l'aviso de guerre le Second. Ce n'est jamais sans émotion qu'on voit flotter au loin le drapeau de son pays. Un enseigne passe à côté de nous avec son canot. Nous descendons ensemble à terre, et je suis heureux de reconnaître en lui le jeune Fouet, marin distingué, et qui porte un nom béni dans ces contrées. Il y a vingt ans, son père, lui aussi officier de marine, y a fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul, qui se sont développées et font beaucoup de bien dans les deux républiques argentine et orientale.
L'après-midi se passe à prendre des renseignements, à me ravitailler à la banque anglaise faute d'une banque française, et à diverses visites. En passant sur la place de la Matriz (c'est le nom que l'on donne ici à la cathédrale), j'entre au palais de la législature locale. Là se réunissent dans de belles salles et occupent de riches fauteuils de damas les députés et les sénateurs du département de Montevideo.
M. Aurelio Berro, ancien ministre de la République de l'Uruguay, m'avait donné des lettres pour M. Enrique (p. 200) Maciel, sous-secrétaire des finances, et pour Carlo de Castro, ministre de l'intérieur.
Je me rends au palais du pouvoir exécutif et aussitôt je suis reçu sans faire antichambre. M. Maciel m'engage à visiter la estancia de M. Lenguas, située à six lieues, mais qu'on atteint en chemin de fer: je pourrais ainsi comparer la estancia que j'avais vue dans la République argentine avec une autre de la République orientale. M. de Castro quitte les nombreux personnages réunis en son cabinet pour me recevoir au salon: il pousse la complaisance jusqu'à me faire remettre à l'instant un billet de libre parcours sur le chemin de fer, pour la estancia. Il m'invite à dîner chez lui le lendemain, 18 juillet, jour de fête nationale pour la République.
Il m'envoie aussi à l'Hôtel de Paris de nombreux documents historiques et législatifs, ainsi que les diverses et dernières statistiques de son pays. Je me propose de les examiner dans les longues journées de navigation.
Le soir, M. Buxareo fils vient me chercher à l'Hôtel de Paris, et me donne divers renseignements sur le prix des terrains, et sur l'élevage des animaux. Quoique bien jeune, il dirige déjà une des nombreuses estancias de sa famille et paraît fort entendu dans les affaires. Il vient d'acheter une quantité de vaches maigres qu'il paye à raison de 9 piastres, environ 45 fr., et les revend ordinairement le double après les avoir laissé paître dans ses champs environ quatre mois. Pour les terrains, le prix varie selon la qualité et la proximité des centres. À (p. 201) Payssandu, sur le fleuve Uruguay, vers le haut de la République, ou vient de vendre pour 1,300 piastres, soit 6,500 fr., une surface de 2,700 cuadras. La cuadra de l'Uruguay ayant 87 mètres de côté; forme une surface de 7,569 mètres carrés, ce qui porte le terrain à environ 40 fr. l'hectare.
Elle vaut à peu près 60 fr. l'hectare aux environs de Montevideo. Le prix des terrains à bâtir en ville varie de 20 à 100 fr. le mètre carré, selon la position; les loyers sont encore très chers, quoiqu'ils aient baissé presque de moitié. L'Hôtel de Paris paye pour sa modeste maison 1,500 fr. par mois. L'Hôtel espagnol paie à M. Buxareo, son propriétaire, 72,000 fr. l'an. Il y a peu d'années, le pays, ayant fait de bonnes affaires, ne sut point être sage; la plupart des familles riches gaspillèrent beaucoup d'argent en maisons, villas et objets de luxe, et elles sont maintenant dans la gêne.
M. Buxareo me conduit à la salle de la Société d'agriculture, où je trouve 126 journaux et revues de tous les pays. On a réuni aussi une collection de livres de tous les points du globe, des échantillons de belle soie indigène et des échantillons de minerais et de marbres de la République; la collection des insectes et des serpents du pays, parmi lesquels je remarque le serpent à sonnette et autres variétés venimeuses. On me montre aussi la photographie d'une peau de bœuf qui porte douze marques abîmant complètement le cuir.
Chaque propriétaire doit marquer ses bêtes au fer rouge, (p. 202) et lorsqu'il les vend, le nouveau propriétaire pose aussi deux fois sa marque: il en résultait une grande dépréciation pour les cuirs, et une loi vient de défendre la marque au fer rouge ailleurs qu'aux jambes et au cou de l'animal.
On me présente un jeune Parisien de vingt-un ans qui vient dans ces pays pour faire de l'élevage: il a déjà parcouru la République orientale, et trouvant les terrains trop chers, il s'en va à l'argentine. Je ne puis lui cacher mon étonnement: «Comment, lui dis-je, avez-vous pu vous résoudre à quitter vos boulevards pour venir ici chercher par un travail pénible à multiplier vos capitaux?—J'ai vécu, répond-il, en Angleterre, et j'ai vu comment font les Anglais.» Alors tout s'explique.
M. Buxareo me fait connaître à M. Lenguas, dont je dois visiter la estancia: il me remet aussitôt une lettre pour son majordome, lui indiquant de me fournir le meilleur cheval pour me faire assister à un rodeo. Je pourrai voir ainsi les bœufs réunis de toute part par les gardiens à cheval, poussés vers certaines barrières et chassés au lazo légendaire ou arrêtés par le terrible bolleador.
Quelques-uns de ces messieurs veulent bien s'inscrire à l'Union de la paix sociale et à la Société de géographie commerciale de Paris.
Le lendemain, j'allais partir pour la estancia, lorsque M. Buxareo père vient me chercher à l'hôtel. Il me fait abandonner ce projet d'excursion, et me propose de me (p. 203) faire visiter lui-même les principaux établissements charitables et scolaires de la ville et des environs. La proposition est tentante, d'autant plus qu'il se charge lui-même de présenter mes excuses à M. Lenguas. Voir les hommes, les soins qu'on met à soulager leurs souffrances ou à les instruire, est plus intéressant, sinon plus amusant, qu'une cavalcade à courir les bœufs. Je cède donc au désir de M. Buxareo, et nous partons pour l'hôpital général. Il est construit pour 600 malades et confié aux soins de vingt-quatre Sœurs italiennes, de la congrégation de N.-D. dell'Orto. Je remarque qu'elles sont presque toutes des deux Rivières de Gênes. La construction est magnifique, mais dans l'ancien style. Les nombreuses cours laissent pénétrer la lumière dans les vastes salles, mais arrêtent l'air qui se corrompt et produit la pourriture d'hôpital. Je m'aperçois bientôt que M. Buxareo est là comme chez lui; il connaît toutes les Sœurs et presque tous les malades; quelques-uns y sont pensionnaires à ses frais.
Nous allons à l'autre extrémité de la ville, et chemin faisant, je vois la musique militaire jouant devant une maison; c'est la maison de Sanctos, président de la République, me dit mon guide. Ce sont les militaires qui le fêtent à l'occasion de la solennité nationale: tout le monde sait ici qu'il y a quinze ans il était encore charretier.
Je parcours la campagne garnie de villas à rez-de-chaussée, couvertes en terrasses; partout des orangers, (p. 204) des mûriers, des pommiers et des poiriers. Après une demi-heure de tramway, je fais comme les Brésiliens et les indigènes, je prononce un tcu, son analogue à celui qu'on fait chez nous lorsqu'on veut chasser un chat ou une poule; et le tramway s'arrête au faubourg de Colonia, où je trouve l'Hospicio de los Mendigos. C'est un hospice de vieillards, à peu près dans le genre de ceux de nos Petites Sœurs des Pauvres. Il est confié aux Sœurs de Charité françaises, qui y soignent 180 vieillards et 120 femmes. La supérieure, qui est Nîmoise, me dit que les Sœurs qui dirigent les femmes ont plus de peine que les autres: si à une infirme on donne quelque chose de plus, les autres vieilles sont jalouses et grognent. Les hommes encore valides sont appliqués à divers métiers de ferblantier, charpentier et autres: la plupart sont étrangers et sans famille. Quelques Français me prennent pour le consul et me demandent à être rapatriés.
Les Sœurs s'occupent aussi d'instruction et font la classe gratuite à 300 petites filles du faubourg: je remarque dans leur école de belles cartes de géographie et beaucoup de dessins de plantes, de fleurs et d'animaux; c'est le meilleur moyen d'apprendre aux enfants la géographie et l'histoire naturelle. À midi, on donne aux plus petites la soupe aux frais de l'administration; la famille Jackson-Buxareo paie aux plus pauvres les livres scolaires. La bonne Sœur a remarqué dans le caractère de la femme de l'Uruguay plus d'énergie que chez l'Argentine: elle ne se contente pas d'être le plus beau meuble et le meilleur (p. 205) joujou de la maison; elle sait s'y faire sa place; mais elle n'arrive pas encore à l'activité des Européennes. Les Sœurs dell'Orto ont remarqué à leur noviciat qu'il faut deux Sœurs indigènes pour le travail d'une Sœur italienne. Les maladies d'anémie sont fréquentes dans le pays: elles sont souvent le résultat du maté, qu'on prend continuellement, surtout à la campagne. Voici comment on le prépare: on achète à l'almacen (droguiste) l'herbe récoltée dans le Paraguay, pilée et réduite en poudre; on en remplit une petite courge appelée maté, dans laquelle on place la conquilia, petit tuyau d'argent terminé en boule percée de petits trous. On ajoute du sucre, on remplit d'eau, et on suce par le tuyau deux ou trois fois, puis on passe au voisin. Lorsque la courge est épuisée, on remet l'eau chaude.
On m'a souvent offert le maté dans diverses maisons; c'est une boisson amère, mais agréable, à laquelle on s'habitue facilement; elle agit sur l'estomac, et on dit qu'elle nourrit, mais la vérité est qu'elle éteint l'appétit et cause l'anémie, faute d'aliments.
Les maladies de poitrine sont aussi très fréquentes. Les Sœurs de Charité, à côté des vieillards et des élèves, ont encore 40 orphelines gratuites et internes. Là où l'on voit la cornette, on est sûr de retrouver l'orpheline: elle a aussi besoin d'être mère.
Au milieu du vaste établissement s'élève une haute tour, construite jadis pour les besoins de la guerre civile. Je grimpe au sommet et je jouis d'une vue magnifique (p. 206) sur la campagne; le terrain est ondulé, ce qui le préserve des inondations, et chaque petite élévation est couronnée d'un moulin à vent qui manœuvre ses grandes ailes. Au loin, on voit, d'une part, la ville de Montevideo, et d'autre part, à l'horizon, les montagnes du Cerro; mais non loin de la tour je distingue un vaste amphithéâtre que je reconnais bientôt pour être un cirque de taureaux. Tout peuple qui ne rougit pas de pratiquer ce jeu barbare n'est pas encore sorti de l'état sauvage. En rentrant en ville, je rencontre une troupe de voyageurs récemment débarqués d'Europe. Voyant les magasins fermés, ils en demandent la raison; on leur apprend que c'est la fête nationale. Alors un d'eux dit en langue française: «Puisque c'est la fête nationale, il doit y avoir jeux, foire, saltimbanques; qu'on nous y mène.»
Pendant que je déjeune, M. Buxareo assiste à la bénédiction de la cloche que donne l'évêque à l'église des dominicaines. Ces Sœurs ont été établies ici par la famille Jackson: elles appartiennent au tiers ordre de Saint-Dominique et s'occupent d'instruction. Après le déjeuner, il vient me prendre avec sa voiture et il me conduit à sa propriété de l'Aragnaga, aux environs de la ville. Chemin faisant, il me montre un joli parc de 18 hectares orné de palmiers, de bambous et d'orangers, qu'il possède dans ces quartiers.
À l'Aragnaga une magnifique église gothique a été construite pour servir de tombeau à un des membres de la famille Jackson. Elle est ornée de beaux vitraux et de superbes (p. 207) tableaux, parmi lesquels je remarque la Vierge des Douleurs. Près de là 5 Sœurs dell'Orto prennent soin de 40 orphelines internes, et instruisent gratuitement 60 externes. L'établissement et son entretien sont l'œuvre de M. Buxareo. Nous parcourons un autre superbe parc de 3 hectares, et à la maison nous trouvons les professeurs du grand Séminaire et leurs élèves qui y sont venus dîner. Les nombreuses villas de la famille Jackson-Buxareo servent ainsi à la récréation du personnel des divers établissements qu'ils ont créés ou aidés. Ils viennent de temps en temps à tour de rôle y prendre leurs ébats. La voiture nous conduit au Manicomio. C'est un vaste bâtiment, ou plutôt un grand palais avec portiques, cours, jardins, le tout tenu aussi proprement que possible par les Sœurs dell'Orto. À la lingerie elles ont fait des merveilles de dessin avec le linge. Mon guide semble partout chez lui. À la cuisine, la Sœur cuisinière lui demande des nouvelles de sa femme malade: «Priez pour elle,» dit-il, «elle est un peu mieux; Dieu voit tout, et entend tout.»
Le Manicomio renferme 500 fous et folles de toutes les nations. Je remarque plusieurs Italiens, et je dis à la Sœur qu'elle a bien des compatriotes à soigner. Elle riposte: «Ve ne sono anche molti fuori che starebbero meglio qui». Allons, ma Sœur, ne faites pas de politique, cela vous est défendu, même à l'étranger.
Dans plusieurs salles, les plus tranquilles travaillent ou prient. Le jardin comprend 18 hectares; de nombreux (p. 208) malades y sont occupés; ils trouvent au travail soulagement et distraction.
Nous allons à l'autre bout de la ville, à la visite d'une magnifique église à coupole qu'on vient d'achever. Le riche autel de marbre du xvie siècle qui se trouvait à Gênes dans l'église de Saint-Sébastien, après la démolition a été transporté ici. La famille Jackson-Buxareo a construit l'église et le couvent pour y installer les Pères capucins italiens chassés d'Italie et les y occuper à l'enseignement. Ils ont 200 élèves. «Je voudrais voir partout vos communautés en faire autant.» dis-je au Père gardien: «la société s'en trouverait mieux.» Il me répond: «Nous n'avons pas été créés pour l'enseignement; mais ici on ne nous a acceptés qu'à cette condition.» La nécessité est souvent bonne conseillère! Mon cicérone aurait encore voulu me conduire plus loin à la campagne, chez les Sœurs du Bon-Pasteur d'Angers: il les a installées dans une propriété de 5 hectares, et pourvoit à leur entretien. Elles prennent soin de 40 jeunes filles retirées du danger, et ont une école avec 60 externes. Nous aurions aussi voulu visiter d'autres fondations de la même famille, confiées aux Sœurs dell'Orto, c'est-à-dire trois écoles maternelles ou salles d'asile dans lesquelles garçons et filles reçoivent les soins et la soupe; mais le temps manque et nous nous arrêtons au cimetière voisin. Il est garni de superbes monuments en marbre de Carrare et le dessous de la chapelle sert de panthéon aux hommes illustres du pays.
Nous passons devant le grand Séminaire, vaste palais, (p. 209) en partie construit par la famille de mon guide, et nous venons à une autre de ses fondations: celle des visitandines italiennes, qui, au nombre de 40, se dévouent à l'éducation et à l'instruction des filles riches.
Nous arrivons enfin à la maison mère des Sœurs dell'Orto, appelées et établies par les soins de la même famille: 40 religieuses et 7 novices instruisent 30 internes et 60 externes. Déjà, à mon premier passage, j'avais visité l'école des Sœurs de Charité appelées par la famille Jackson-Buxareo, qui leur fournit maison et nourriture; elles ont 300 élèves; on reconstruit la maison pour en recevoir 1,000. La famille Jackson prépare aussi à ses frais une colonie agricole pour les orphelins pauvres, et déjà le terrain et la maison sont prêts à recevoir les cisterciens qui vont venir de France pour la diriger. Enfin elle construit à ses frais une maison et église destinée aux Pères lazaristes. Les enfants de dom Bosco, qui dirigent ici un collège à la Villa Colon, savent aussi qu'ils trouvent chez Buxareo et Jackson la bourse ouverte lorsqu'ils sont obérés de dettes; et toutes les œuvres y trouvent leur plus sûre ressource.
Qu'est-ce donc que cette famille Buxareo-Jackson, qui pourvoit ici si amplement aux besoins de l'instruction pour les deux sexes et élève des asiles pour toutes les misères?
M. Jackson était Anglais et protestant. Comme beaucoup de ses compatriotes, il s'était expatrié et était venu dans ce pays, où il avait fait d'excellentes affaires. Sa femme et (p. 210) ses enfants se sont convertis au catholicisme: son fils unique est marié et sans enfants. Des trois filles, une est morte après avoir renoncé au mariage pour consacrer ses biens et sa personne au soulagement des pauvres. Une autre a épousé M. Buxareo, dont elle a un fils unique; la troisième est mariée aussi et a de la famille. Ensemble ils possèdent 9 établissements à la campagne, comprenant plus de 100 lieues carrées, soit 250,000 hectares, et un grand nombre de maisons en ville. Tous les ans ils font donner pour leurs gens une mission dans toutes leurs terres, et les personnes qui, de près ou de loin, veulent venir profiter des exercices, sont logées et nourries à leurs irais durant 13 jours. Il serait facile à cette famille de vivre de ses rentes, et de croire que l'administration de sa fortune suffit à son activité; mais tous travaillent. Nous avons vu le fils Buxareo acheter et vendre les vaches; le père est tous les jours à sa Baracca (c'est le nom qu'on donne ici à l'entrepôt des marchandises), constamment occupé à recevoir et expédier les cuirs et la laine. M. Cibils, son beau-frère, possède le plus important saladero du Cerro, et a construit à côté le bassin de radoub pour lequel les navires en réparation lui paient un loyer souvent de plusieurs milliers de francs par jour. De toutes ces rentes et de tout ce gain, ils prennent le nécessaire pour une vie aisée, et le reste va à l'instruction et au soulagement des pauvres. Elle est donc l'économe fidèle auquel Dieu se plaît à confier toujours des biens plus nombreux. À son égard se vérifie cette parole: (p. 211) «On se servira pour vous de la même mesure que vous aurez employée pour les autres, et on vous la donnera pleine jusqu'à ce qu'elle déverse.» Tous ceux qui auront assez de foi pour faire des biens de la terre et de leur propre activité le même usage que la famille Jackson, verront se vérifier pour eux les mêmes promesses, car elles sont pour tout le monde. Malheureusement, cette manière de bien jouir de ses rentes est peu pratiquée. En me quittant, M. Buxareo me laisse sa voiture pour aller faire ma toilette à l'hôtel et me conduire chez le ministre.
M. de Castro, avec beaucoup d'amabilité, me présente à sa femme et à sa nombreuse famille: il y a 9 enfants. Il avait réuni quelques amis, parmi lesquels un jeune journaliste fort gai: celui-ci m'apprend que Montevideo possède 15 journaux quotidiens écrits en langue espagnole et 5 en langues étrangères.. Parmi les convives, je distingue aussi deux jeunes filles napolitaines, dont une fort jolie; leur père avait commandé dans ces mers la station navale, et après sa retraite il est venu y faire du commerce.
Le dîner fut gai et la conversation variée. Mme de Castro faisait avec grâce les honneurs de la table. On but à la santé de la France et à la prospérité de la République orientale. Viennent ensuite la musique et les chants; et plusieurs invités arrivent pour la soirée. Un d'eux me parle de son système de colonisation. Il prépare des terrains avec chemins, clôtures, maisons, chapelle, police, écoles, juges de paix, et vend les lots aux colons à raison (p. 212) de 50 fr. l'hectare, payables en cinq ans: il a ainsi réuni des Suisses, des Allemands, des Italiens, qui ont facilement prospéré.
Le lendemain à dix heures j'étais au môle de la douane, conformément aux instructions reçues au Bureau de la Pacific Steam Cy; mais à dix heures et demie le vapeur qui doit nous porter à bord n'a pas encore paru; le vent est favorable, et avec divers autres passagers je monte sur une barque à voiles pour rejoindre l'Aconcagua, ancrée à 3 milles au large. Cette impatience risque de me faire manquer le départ. Notre nacelle était près de toucher le navire, et déjà un de nos marins napolitains demandait à lancer un câble pour nous amarrer; les matelots de l'Aconcagua refusent de le recevoir. À ce moment le vent change, et, aidé de la marée, nous emporte au loin. En vain on cherche à lutter avec les rames. Nous perdons toujours plus de terrain, et à la fin nous jetons l'ancre, dans l'espoir que le petit vapeur pourra voir nos signes de détresse et viendra nous remorquer. Heureusement, peu après, le vent devient favorable, et nous pouvons aborder le navire. Quoi de plus changeant que le vent? Les Grecs avaient dit le temps, et les Romains la femme; mais ne calomnions pas, et remercions Dieu d'être arrivés à temps.
On nous fait attendre longtemps avant de nous donner les cabines. Les passagers de première sont à peine une quinzaine, parmi lesquels quelques Chiliens et plusieurs jeunes Allemands, voyageurs de commerce. Je remarque (p. 213) aussi 4 Sœurs de Charité qui s'en vont aux écoles et hôpitaux du Chili, et 4 Sœurs de la Merced, Espagnoles à même destination. La mer est calme, le soleil radieux, le ciel pur. À une heure on lève l'ancre et on marche vers le sud. À table je retrouve la peu agréable cuisine anglaise avec ses soupes au poivre, ses légumes sans sel, ses viandes dures, ses puddings sans sucre. À mon côté, un jeune Anglais imberbe remplit la charge de sous-commissaire; il est délicat de la poitrine, et pour se fortifier il a pris la mer; mais en gens pratiques, sa famille lui a procuré une place qui lui permet de voyager en mer tout en gagnant son pain et en faisant son instruction. Je le vois souvent se promener avec d'autres jeunes gens, et demander à celui-ci une parole espagnole, à celui-là un mot de français, les noter et se les répéter, en sorte qu'il commence à se faire comprendre dans ces deux langues.
20 juillet.—La mer est houleuse, le vent glacé, le tangage oblige à mettre sur la table les planchettes pour retenir la vaisselle: elles remplacent les ficelles que les marins français appellent le violon. Tout le monde est malade: les pauvres Sœurs espagnoles ont surtout l'air bien contrit.
21 juillet.—Même mer, même froid, mais le soleil paraît, et ses rayons nous réchauffent médiocrement. Dans l'après-midi, trois baleines lancent des colonnes d'eau en l'air, puis viennent se montrer à portée de fusil, sortant à demi leur dos noirâtre. Le soir on chante, on joue, on fait de la musique; les plus bouillants sont deux époux (p. 214) français; le mari est Toulousain et la femme de Marseille. Ils vont s'établir au Chili comme commerçants. Qui sait si Madame ne sera pas étonnée de ne pas y voir la Cannebière! Un officier du bord se montre aussi fort gai: il est Irlandais.
22 juillet.—La mer, toujours mauvaise, roule des vagues comme des montagnes, qui soulèvent le navire et les estomacs.
23 juillet.—À sept heures, le steward (domestique) m'appelle: your bath is ready, sir; mais c'est parfaitement nuit, le jour ne paraît qu'à huit heures. Le froid pampero se calme, la mer devient plus douce; les religieuses de la Merced sortent de leur coma (lit), mais elles ont encore l'air penaud. Je les aborde en disant: «Vous avez fait une longue et facile méditation, mes Sœurs.» Mais elles ne comprennent pas le français, et une d'elles, la plus jolie, me dit en espagnol: Wousted no se marea; traduction libre, je croyais qu'elle me demandait si je ne me mariais pas, et j'allais répondre: Je ne puis vous épouser, lorsqu'un voisin, s'apercevant de la méprise, me dit: «Cette expression en espagnol signifie: Est-ce que vous ne souffrez pas du mal de mer?»—Par contre, les 4 Sœurs cornettes sont vaillantes et se promènent en rang comme un peloton de soldats.
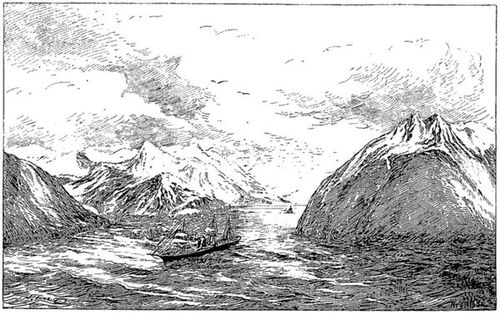
Détroit de Magellan.
24 juillet.—À cinq heures du matin le navire stoppe à l'entrée du détroit de Magellan: il attend le jour pour voir sa route. Au lever du soleil, scène magnifique. Nous avons à droite la côte de la Patagonie, sur laquelle se dessinent (p. 215) quelques montagnes, et à gauche la Terre de feu, plus plate; l'une et l'autre sont couvertes de neige et de glace. Sur le pont le thermomètre est à zéro. Le jeune couple marseillais continue à nous donner son vaudeville. À table, il est fort embarrassé pour demander les plats; il ne connaît pas l'anglais. Souvent, à la suite des méprises, il témoigne son étonnement à la marseillaise par des phrases provençales. Une jeune Chilienne nous fait de la bonne musique et accompagne son frère à voix de ténor.
Vers cinq heures du soir, nous arrivons à Punta-Arena; deux fusées sont lancées pour annoncer l'arrivée, et appeler les agents et les autorités. Plusieurs Patagons montent à bord et étalent leurs peaux de huanacos, de loutre et d'autruche. Les prix qu'ils demandent sont supérieurs à ceux de Buenos-Ayres.
La petite ville de Punta-Arena étale au bord de la mer ses maisonnettes de bois occupées par 3,000 habitants. Les environs sont des forêts blanchies par la neige. Bientôt le phare allume son feu, et à sept heures le navire lève l'ancre, marchant lentement et avec précaution dans le détroit, par une nuit obscure.
25 juillet.—Le jour n'arrive qu'à huit heures et éclaire une magnifique scène d'hiver. Le détroit n'a en cette partie qu'environ 2 kilomètres de large; à droite et à gauche des collines et des montagnes couvertes de neige, les vallées sont occupées par des glaciers. Par-ci par-là, des phoques au teint roux ou noir lèvent leur tête et regardent (p. 216) avec curiosité. La neige tombe, il fait froid: la navigation continue à être calme, même après la sortie du détroit.
26 juillet.—La mer a été en tempête toute la nuit et continue à faire danser le navire: le soleil paraît par intervalles; nous marchons droit au nord, longeant les côtes montagneuses du Chili, que nous apercevons dans la brume. Plus tard nous passons devant 4 rochers noirs qu'on a baptisés les 4 évangélistes.
Vendredi 27.—Vent favorable, nous filons 14 nœuds; le roulis est fort, on a peine à se tenir debout. Une dame anglaise, pour mieux jouir du balancement, se fait hisser au moyen d'une poulie au haut du grand mât; on la regarde avec des jumelles.
28.—Le capitaine tire à balle sur les goélands et les mouettes; elles ont ici un plumage de couleur blanche et noire. Exercice cruel! d'autres s'essayent, mais le commandant seul est assez bon tireur pour les saisir au vol, malgré le roulis. Nous sommes en face de l'île de Mocha, couverte d'un tapis vert et de forêts. Cette nuit, nous arriverons à Coronel, où je descendrai pour visiter Lota et atteindre Santiago par voie de terre.[Table des matières]
Le Chili.
Situation. — Configuration. — Surface. — Population. — Revenu. — Dépense. — Importation. — Exportation. — Armée. — Marine. — Instruction publique. — Chemins de fer. — Guano. — Minerai. — Histoire. — Constitution. — La guerre avec le Pérou et la Bolivie. — Débarquement à Coronel. — Les Basques. — De Coronel à Lota. — Les ranchos. — Types. — Lutte à cheval. — Lota. — Les mines de charbon. — La fonderie de cuivre. — La verrerie. — Le parc Cuscino. — La population ouvrière. — Retour à Coronel. — La fonderie Schwaga. — Les mines de charbon au Maule. — Un fou. — Départ pour Concepcion.
Le Chili, situé entre le 25° et le 54° latitude sud, comprend le territoire long et étroit, entre la Cordillera de los Andes et le Pacifique, y compris la plus grande partie du détroit de Magellan, de la Terre de feu et de l'archipel de Chiloë. Sa longueur dépasse donc les 1,500 lieues, mais sa largeur atteint à peine 50 lieues. Sa surface est de 535,000 kilomètres carrés, soit 5,000 kilomètres carrés plus grande que la France; mais sa population n'est que de 2,250,000 habitants.
Des statistiques qu'a eu la bonté de m'envoyer M. Cuadra, ministre des finances, je relève que le budget, en 1882, a eu une entrée de 42,017,033 pesos ou piastres (le peso vaut 5 fr.; mais, par suite du cours forcé du (p. 218) papier monnaie, il ne vaut actuellement que 3 fr. 70), qui se décomposent ainsi:
| Douanes | 29,080,210 |
| Trésorerie | 5,681.749 |
| Poste | 378,478 |
| Chemins de fer | 5,026,771 |
| Entrées extraordinaires | 1,849,825 |
avec augmentation de 3,672,488 sur 1881.
Les dépenses ordinaires et extraordinaires pour 1882 se sont élevées à 41,620,137 pesos, laissant un excédant de recette de 396,896 pesos. Dans les dépenses, je remarque l'affectation de 1,000,000 de piastres, pour retirer le papier monnaie, et 248,000 pour intérêt de la dette. M. le ministre a aussi eu la bonté de me donner la statistique de la douane, où je relève que le mouvement commercial, en 1882, a atteint le chiffre de 124,873,340 piastres, avec une augmentation de 15,995,177 piastres sur 1881, qui avait déjà dépassé de 21,682,245 le mouvement commercial de 1880, et celui-ci avait dépassé de 21,779,734, celui de 1879. Ces augmentations se sont révélées depuis la guerre avec le Pérou et la Bolivie, puisque l'augmentation de l'année 1879 sur 1880 n'est que de 1,487,109.
Ce mouvement se décompose ainsi:
Pour l'importation, l'Angleterre vient en tête avec 17,076,031. Puis l'Allemagne, avec 7,610,556, et en troisième lieu la France, avec 6,911,479 pesos.
Pour l'exportation, l'Angleterre, qui exporte presque tous les métaux, reçoit pour 93,293,718 piastres, puis vient la France avec 3,793,707, puis le Pérou avec 3,702,900, les États-Unis avec 3,182,979, et l'Allemagne avec 2,940,636.
Dans l'exportation, le salpêtre figure pour 489,346,345 kilogrammes, de la valeur de 28,698,364 piastres.
L'iode figure pour 263,981 kilogrammes, de la valeur de 3,963,240; le borax de chaux pour 4,311,893 kilogrammes, de la valeur de 862,379 piastres. Les navires employés à ce commerce comprennent ensemble 89,625 tonnes. Parmi les nombreuses compagnies navales, une seule, la Compagnie maritime du Pacifique, est française. En 1882, sont entrés dans les 14 ports du Chili, 7,762 navires, ayant ensemble 6,415,185 tonnes, avec 45,274 passagers, et en (p. 220) sont sortis 7,894 navires avec 6,335,773 tonnes et 41,052 passagers. La marine de guerre compte 15 navires, soit 2 blindés, 1 monitor, 2 corvettes, 2 canonnières, 2 croiseurs, 2 vapeurs, 1 transport et 3 pontons, jaugeant ensemble 15,581 tonnes et portant 2,065 hommes d'équipage. L'armée, qui en temps de paix ne compte que quelques mille hommes, a été portée à 50,000 à l'occasion de la guerre avec le Pérou. Elle se recrute par engagements volontaires; la conscription n'existe pas.
L'instruction publique comprend, pour l'enseignement primaire gratuit, 671 écoles de garçons, 434 de filles, et 87 mixtes fréquentées par 82,257 élèves. L'instruction secondaire gratuite comprend 5 écoles et 15 lycées, fréquentés par 3,460 élèves.
Les chemins de fer atteignent environ 2,000 kilomètres. Presque tous les ports sont reliés avec l'intérieur par un petit embranchement; et une ligne parallèle aux Andes suit la plaine centrale depuis Santiago jusqu'à Angol, et doit se prolonger jusqu'à Valdivia, vers le sud.
La Société d'agriculture, installée depuis 6 ans à Santiago, a beaucoup contribué à faire sortir le pays de sa routine, à abandonner la charrue de bois, et à répandre partout les machines et les méthodes perfectionnées.
Le gouvernement vient de nommer une commission pour étudier et développer l'industrie minière, et a réuni les documents pour former à Valparaiso une Chambre de commerce.
Les dépôts de guano qui restent à exploiter étant trop (p. 221) pauvres pour donner des bénéfices, on propose de les enrichir avec les préparations de salpêtre, qui abonde dans le désert d'Atacama.
On sait que le Chili a été découvert par l'Espagnol Almagro, vers 1535, et que celui-ci, avec son compagnon Pizarro, étaient venus au Pérou, qu'on leur avait peint comme le pays de l'or. Ils y trouvèrent Atahualpa, roi des Incas, qui les reçut sans défiance, mais Almagro et Pizarro le saisirent dans une embuscade et le firent prisonnier. Celui-ci offrit pour son rachat autant d'or que pourrait en contenir sa prison, jusqu'au point où atteindrait le bout de sa main levée; l'offre fut acceptée, et l'or apporté; mais, néanmoins, le malheureux Atahualpa fut immolé. Inutile d'ajouter que Pizarro, Almagro et plusieurs autres chefs d'aventuriers finirent tragiquement en se tuant entre eux.
Le Chili, comme le Pérou et la plupart des colonies sud-américaines, avait été pris au nom des rois d'Espagne, qui le gardèrent environ 300 ans; mais au commencement de ce siècle, les patriotes se soulevèrent de toutes parts, et en 1824 le Chili cessa d'appartenir à l'Espagne, et s'érigea en république indépendante. D'après la Constitution aujourd'hui en vigueur, le gouvernement se compose d'un Président électif, qui choisit ses ministres, et de deux Chambres élues: le Sénat et la Chambre des députés. Sont électeurs les citoyens de 25 ans, ou de 21 ans s'ils sont mariés, et sachant lire et écrire; mais les domestiques sont exclus de la faculté de voter. La liberté (p. 222) d'enseigner, les droits de réunion, d'association et de pétition, sont assurés. Les députés sont élus pour 3 ans, à raison de un pour 20,000 habitants; ils doivent justifier d'un revenu de 500 piastres. Les sénateurs sont élus pour 6 ans directement par les provinces, à raison d'un sénateur par 3 députés. Chaque province élit en outre un sénateur suppléant. Le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Les provinces sont au nombre de 17. Pour être nommé sénateur, il faut être citoyen, avoir 30 ans révolus, n'avoir jamais été condamné pour délit, et justifier d'une rente de 10,000 fr. La réunion des deux Chambres forme le Congrès. Celui-ci approuve ou rejette les déclarations de guerre proposées par le Président, et dicte les lois qui, en cas de nécessité, restreignent la liberté de la presse et de réunion: ces lois ne peuvent durer plus d'un an.
Les lois sur les finances et les contributions sont réservées à l'initiative de la Chambre des députés; celles sur la réforme de la Constitution sont réservées à l'initiative du Sénat.
Le Sénat approuve ou rejette les candidats à l'épiscopat présentés par le Président.
Chaque année, avant de se séparer, le Congrès nomme une commission Conservadora qui le représente jusqu'à l'ouverture du Congrès suivant.
Le Président doit être né au Chili, et avoir les qualités requises pour être député. Il est élu pour 5 ans par des électeurs nommés directement par le peuple. Ces électeurs (p. 223) sont en nombre triple des députés. Après 5 ans, le Président ne peut être réélu; mais il le peut après une autre période de 5 ans. En prenant possession de sa charge, il prononce le serment ci-après:
«Yo N. N. juro por Dios nuestro Senôr y estos santos Evanjelios, que desempenare fielmente el cargo de Présidente de la Republica, que observaré i protejéré la religion Católica, Apostolica, Romana, que conservaré la integridad e indipendencia de la Republica; i que guardarè i harè guardar la Constitucion, i las lèjes. Asi Dios me ayude, i sea in mi defensa, è si no, me lo demande.»
«Je N. N. jure par Dieu Notre-Seigneur et ses saints évangiles, que je remplirai fidèlement la charge de Président de la République, que j'observerai et protégerai la religion catholique, apostolique et romaine, que je conserverai l'intégrité et l'indépendance de la République, et que je garderai et ferai garder la Constitution et les lois. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et soit ma défense, et sinon, qu'il m'en demande compte.»
Tout citoyen en état de porter les armes est de droit inscrit dans la garde nationale. L'inviolabilité du domicile et de la correspondance épistolaire est garantie, et l'article 132 déclare qu'au Chili il n'y a pas d'esclaves, et que l'esclave qui y arrive devient libre. Il défend aux Chiliens le trafic des esclaves, et rend incapable d'acquérir le droit de citoyen l'étranger qui s'y est livré.
Il est temps maintenant d'ajouter deux mots sur la guerre encore en vigueur entre les États du Pacifique.
(p. 224) En 1878, la Bolivie et le Chili étaient en désaccord, à propos de la propriété d'une partie des terrains du désert d'Atacama. On sait que cet immense, désert s'étend depuis Caldera, sous le 27° latitude sud, jusqu'au 22°. La question prit fin au moyen d'une transaction. Le Chili renonçait à la propriété des terrains contestés, mais comme les minerais nombreux et le guano qui s'y trouvent étaient généralement exploités par des Compagnies chiliennes, la Bolivie s'interdisait la faculté de les imposer à la sortie. En 1879, à la suite d'une importante concession, la Bolivie mit un droit de 50 centimes sur chaque quintal de salpêtre exporté. Le Chili réclama et envoya un navire de guerre sur les lieux. La Bolivie avait, avec le Pérou, un traité d'alliance offensive et défensive, et le Pérou se mit en campagne avec son alliée. La fortune des armes fut favorable aux Chiliens; ils vainquirent par mer et par terre, et réclamèrent, comme rançon de guerre, la propriété de la province de Tarapacà, qui comprend les terrains auparavant contestés, et la plus grande partie du désert d'Atacama. Les alliés refusèrent; mais plusieurs présidents ou prétendants s'élevèrent au Pérou: Calderon, Montero, Caceres, Iglesias, etc., et l'anarchie s'ajoutant à la déroute, ils finirent par mettre le pays dans un triste état. Une dernière bataille sur les hauteurs de Huamachuco, gagnée par les Chiliens sur les troupes de Caceres, a réduit les alliés à discrétion; et on peut croire la paix prochaine. D'après les renseignements donnés par les journaux, à la suite des conventions (p. 225) débattues et acceptées, il semblerait que le Chili deviendrait absolu propriétaire du département de Tarapacà; et, quant au territoire d'Arica et de Tacna, qui sont la porte de la Bolivie, le Chili se réserve le droit de l'administrer pendant dix ans, après quoi aura lieu un plébiscite, et le pays appartiendra définitivement au Chili ou au Pérou, suivant le choix des populations. Celui auquel il appartiendra donnera à l'autre 10,000,000 de piastres. Restent en vigueur plusieurs règlements déjà convenus, pour partager les revenus des dépôts de guano en exploitation. Ainsi, la Bolivie, restant sans issue sur le Pacifique, est forcée de s'ouvrir des voies vers l'Atlantique; et la République argentine, aussi bien que le Brésil, sont heureux de lui tendre les bras. Mais je reviens à mon journal de voyage, et à l'emploi de mon temps.
C'est le dimanche matin, 29 juillet, que l'Aconcagua jette l'ancre dans la baie de Coronel. Immédiatement, je descends à terre, et dépose mes effets à l'hôtel, tenu par un Danois; mais M. Darmandrail, ami de M. Castaing, me retient chez lui à déjeuner. Nous parcourons la petite ville de Coronel; elle contient 6 à 7,000 habitants. Ses rues, larges de 10 mètres, sont bien alignées et coupées à angle droit; les maisons sont en adobe (brique de terre et fumier de cheval), ou en bois, et à un seul rez-de-chaussée. Tout est nouveau pour moi dans ce pays. Les collines qui limitent la ville à l'est, avec leurs ranchos rappellent la Suisse; la végétation est d'un vert tendre, (p. 226) mais presque morte: nous sommes en plein hiver. Nous suivons la musique municipale, qui fait le tour de la ville. Un peu plus loin, quelques centaines d'hommes alignés sont passés en revue: c'est la garde nationale; enfin nous arrivons à l'église. Elle est en bois, à trois nefs. C'est dimanche et dix heures; la messe va commencer et j'en profite. Les femmes du pays arrivent enveloppées dans leurs mantas noires, espèce de châle qui les couvre depuis la tête. Elles ont toutes un petit tapis carré à la main, elles le placent sur le pavé de briques, et s'agenouillent ou s'accroupissent dessus, à la manière japonaise; il n'y a pas d'autres chaises dans l'église, et pour ne point rester debout, je grimpe à la tribune où je partage le banc de l'organiste. Une femme arrive, se met à genoux à la porte; elle allume deux cierges et les porte à l'autel, en marchant à genoux. Les hommes sont peu nombreux, mais les bébés et les chiens ont droit d'entrée et partagent le tapis de la maman ou de la maîtresse; moins patients et moins dévots, ils parcourent souvent l'église, pour revenir à leur place. À l'Évangile, le curé en fait la lecture, la traduction et l'explication; puis il lit une longue suite de publications de mariage. Après la messe, on entonne quelques chants liturgiques, et tout le monde se retire.
Au déjeuner sont réunis plusieurs Basques français; lorsqu'ils parlent leur langue, je ne puis rien y comprendre. Elle n'a aucune analogie avec les langues occidentales, et par sa construction et la signification des (p. 227) mots, empruntés à la nature, semble se rapprocher des langues orientales. À ce propos, j'ai entendu un Basque me raconter que Béelzebub (le diable) envoya un jour de nombreux compagnons au pays basque pour tenter les bons montagnards; après plusieurs mois de séjour, ils retournèrent à leur maître sans avoir pu tromper personne; ils n'avaient jamais pu comprendre leur langue.

Chili.—Type de Femme Indienne.
Après le déjeuner, je monte en selle, et me dirige vers Lota, à trois lieues vers le sud, sans autre guide que mon cheval. Vous suivrez la mer ou le télégraphe, me dit-on, et vous arriverez. Mon cheval court droit à la plage, il sait que le sable mouillé est plus résistant et plus commode que le sable sec. La vue de la baie, que borne au loin l'île Santa-Maria, le bruit des vagues qui viennent mourir aux pieds du cheval, cette nature, nouvelle pour moi, et la solitude, parlent à mon âme et l'invitent à rêver. Va, vague mobile, de couche en couche, jusqu'à la côte de l'ancien monde, et dépose sur la plage qui m'a vu naître, mes souvenirs et mes affections pour les miens que j'y ai laissés! Tout à coup, mon cheval quitte le (p. 228) bord de la mer, et comme j'ai confiance en lui, je le laisse faire: il savait qu'une lagune nous barrait le passage, il se dirigeait vers un pont. Puis nous gravissons des collines, par un chemin impossible; il n'est pas empierré, et les dernières pluies ont laissé 40 centimètres de boue. Par-ci, par-là, quelques pauvres ranchos (nom qu'on donne aux habitations des champs) de boue ou simplement de feuillages, sont habités par de nombreuses familles. Les femmes ont souvent les cheveux noirs et là chair rougeâtre des Indiennes; et, comme elles, portent leur bébé ficelé sur le dos. Je redescends sur une plage rocailleuse, où des paysannes ramassent certains objets, dont elles remplissent des paniers. Je m'approche de deux jeunes filles, pour voir ce qu'elles cueillent; elles s'enfuient, et mettant pied à terre, j'ai de la peine à les rassurer: elles récoltent des moules. Plus loin, nous retrouvons le sable, et là, des jeunes gens à cheval se livrent à un singulier combat: ils lancent leurs bêtes au grand galop, et se rencontrent, cherchant, hommes et chevaux, à se renverser. Ils sautent les fossés, escaladent les talus, et sont à leur aise sur leur bête, comme un bon patineur sur ses patins. Enfin, après avoir gravi une dernière colline, et après deux heures de marche, j'arrive à Lota. C'est le pays du charbon. De nombreuses mines occupent 2,000 ouvriers, qui extraient environ 25,000 tonnes par mois. Ces mines appartiennent à la famille Cuscino, qui a su les utiliser de plusieurs manières: d'abord elle vend sur place de 20 à 25 fr. la tonne, le charbon (p. 229) qui lui revient à moitié de ce prix mis abord; puis elle en fait une grande consommation sur place, pour une verrerie et une fonderie de cuivre. Celle-ci occupe environ 300 ouvriers. M. Dubart m'avait fait accompagner par un de ses jeunes gens, qui me présente à un employé de l'usine. Celui-ci m'explique en anglais la série des opérations. Quatre steamers et quatre voiliers, appartenant à la compagnie, vont sur les côtes du Pérou, de la Bolivie et du Chili, spécialement dans la province de Tarapacà; y portent le charbon nécessaire aux usines de salpêtre, de borax et autres, et en rapportent le minerai de cuivre. Il y en a de plusieurs espèces, donnant de 15 à 35% de minerai, et 50% après une première cuisson. Ce minerai est placé dans des fours, où après cinq à six heures, il est fondu et coulé sur la terre. La scorie est mise de côté et le métal, après avoir été roulé dans d'autres fours, pour séparer le soufre et l'antimoine, est broyé et pulvérisé, puis mélangé à des agents chimiques, et fondu une seconde fois en lingots de trois quintaux espagnols (138 kilos), contenant 90% de métal pur. Dans cet état, ils sont exportés en Angleterre, et une petite partie au Havre. Les côtes du Pacifique de l'Amérique du Sud produisent les trois quarts du cuivre consommé dans le monde entier. On fait aussi ici du cuivre rouge en petits lingots de 10 kilos, et qu'on raffine alors par une troisième fonte. Les directeurs et les contre-maîtres sont Anglais, les autres ouvriers sont Chiliens. Ils gagnent de 3 à 5 fr. par jour, mais la viande, la farine, le vin, ont (p. 230) presque le même prix qu'en Europe, et leur nourriture se réduit aux haricots et à la pomme de terre. Leurs maisons sont en terre, rarement crépies, toujours sans pavés; la propreté y est impossible, la moralité difficile. Ce lamentable état du logement des familles ouvrières est général au Chili et cause la mortalité des deux tiers des enfants.
La ville contient 5 à 6,000 habitants: c'est dimanche, et la foule suit un charlatan à cheval, qui renouvelle les scènes des bouffons du moyen âge. Je monte au parc Cuscino, qui s'étend sur un promontoire, d'où la vue embrasse la baie, la ville et la mer. Là, à grands frais, on a réuni des statues de marbre et de bronze, venues de Paris; on a composé des grottes féeriques, des lacs artificiels, une serre avec toutes les plantes tropicales, des jets d'eau; on a réuni des animaux du pays: llamas, huanacos, vigognes, etc., au milieu des roses, des violettes, des camélias, acacias, et autres plantes recherchées. Le visiteur est étonné, charmé, ravi: il se rappelle les belles descriptions que l'Arioste fait des jardins enchantés.

Chili.—Lota.—Fonderies de Cuivre.—Parc Cuscino.
Mais le temps presse, la route est longue. Le soleil embrase au loin, de sa lumière rougeâtre, l'île de Santa-Maria, lorsque je quitte Lota. Je pique mon cheval, qui escalade les collines et galope dans la boue. Mais lorsque le crépuscule a fait place aux ténèbres, il faut marcher à tâtons, sans autre point de repaire que les faibles lumières de quelques ranchos, espacés sur la route. Dans la plupart, j'entends des chants au son de la guitare, et quelques-uns (p. 231) sont assez harmonieux; mais je me garde bien de m'arrêter ou d'adresser la parole. Que sais-je si ce sont là tous de bonnes gens, et si en s'apercevant à l'accent, qu'un étranger est perdu dans ces solitudes, ils ne voudraient pas en profiter. Enfin, ma vaillante bête sort de la boue et de tous les mauvais pas, et sur le sable elle reprend le galop. À huit heures nous sommes rentrés, et je m'aperçois alors, mais un peu tard, que j'ai été imprudent!
Durant la nuit, des veilleurs sifflent à toutes les heures, et me rappellent les veilleurs de Chine et du Japon, qui battent la crécelle. De grand matin, je demande un bain; il vous faut aller à la mer, me dit-on. Par une température de 6 degrés, c'est peu agréable. Un jeune employé de M. Darmandrail me conduit à la visite d'une fonderie de cuivre de M. Schwaga, à côté de la ville, puis nous passons au Maule pour les mines de charbon. Après une heure et demie de marche, nous arrivons au bord de la mer, au puits d'extraction; il s'avance sous la mer, par un plan incliné d'un demi-kilomètre de long, et de là partent les galeries dans toutes les directions. Cinq wagons viennent de se détacher de la chaîne et sont partis en bas avec une vitesse vertigineuse. Il est impossible de descendre, avant qu'on ait réparé le mal; je me contente donc des renseignements que me donne le contre-maître. La mine emploie 500 ouvriers, produisant 400 tonnes de charbon par jour. Ils sont payés de 3 à 4 fr. par tonne; la couche a actuellement moins d'un mètre d'épaisseur. (p. 232) On creuse deux autres puits, dans l'espoir d'atteindre une autre veine. Non loin de là, se trouvent deux galeries qui s'avançaient au loin dans la mer: il y a deux ans, la mer les a inondées, et il est impossible de les vider. Heureusement, la rupture a eu lieu le jour de la fête nationale; les mille ouvriers et les nombreux chevaux étaient tous dehors.
Dans la chambre du contre-maître, je vois une quantité d'objets pendus à une planche: des boutons, des chiffons, des clous, des figurines, etc., et j'en demande l'explication. Ce sont, dit-il, les contre-marques des ouvriers. Ils ne savent ni lire ni écrire, mais ils ont tous leur marque spéciale, connue d'eux et de moi. Ils la mettent chacun dans leur wagon, et je la prends pour la poser ici à leur place, et marquer ainsi la quantité de charbon fait par chacun. Singulière, mais ingénieuse méthode de suppléer l'écriture!
Je me décide à partir pour Concepcion, mais je n'ai qu'une heure pour atteindre la voiture qui passe à Coronel. M. Ducasseau, qui habite le Maule, a la bonté d'envoyer son homme avec un lazo, et bientôt il ramène un cheval sellé à la mode du pays, avec grands étriers de bois. Je pars au galop sur la chaussée du chemin de fer; mais à un certain point, un homme s'avance, un grand bâton à la main, contrefaisant le galop du cheval. Celui-ci s'effraie, tourne bord, et j'ai peine à le ramener. J'ai encore plus de peine à éloigner le malencontreux. Un peu plus loin, je demande à des passants ce que me voulait (p. 233) l'homme au bâton: es un loco, me dit-on, c'est un fou.
Après avoir de nouveau traversé les lagunes, où l'on prend les sangsues et où l'on pêche les grenouilles, j'arrive à temps pour le déjeuner, et à dix heures et demie je suis en voiture.[Table des matières]
De Coronel à Conception. — La diligence. — Le paysage. — Arrêt à la Posada. — Le Bio-Bio. — La ville de Concepcion. — Encore le maté. — Le testament de Mgr Salas. — Le sortéo. — L'organisation judiciaire. — Les œuvres charitables. — Les magasins. — Appellations chiliennes des étrangers. — L'hôpital. — La fille singe. — La supérieure de Talca. — Excursion en Araucanie. — La ville d'Angol. — Les Basques, leur commerce, leur organisation, leur hospitalité. — Croyances religieuses. — Offrande des prémices. — Une invitation. — La Chambre arsenal. — Exploits des Araucans. — Conquête et colonisation.
La diligence qui fait le service entre Lota et Concepcion est une grossière voiture à 6 places entourée de rideaux de cuir, et suspendue sur des lames de bois comme en Sibérie. Aucun ressort ne saurait résister aux chocs d'une route qui n'en est pas une: nous nous en apercevons bientôt aux sauts et soubresauts. Un plaisant remarque qu'il serait prudent de numéroter nos os. Pour voir la campagne, je m'étais placé sur le siège: un bâton qui sert à la mécanique menace à tout instant de me casser la jambe. C'est du nouveau: il en faut aussi en voyage.

Chili.—Types d'Araucaniens.
Nous traversons une plaine sablonneuse, où ne croissent que quelques buissons et le coïbo, espèce de chêne aux feuilles odoriférantes. Nos 7 chevaux galopent dans la boue, dans les cours d'eau, et boivent l'eau froide tout (p. 236) baignés de sueur. Pour éviter les mauvais pas, le cocher les lance hors la route, à travers champs. Par-ci par-là, quelques bœufs, brebis ou cheval sur lequel se tient un penco; espèce de corbeau gris qui se nourrit de vers. Après trois heures de ce galop, nous arrivons au bord d'un lac, à la Posada, hôtel primitif tenu par un Allemand.
C'est là qu'on se restaure, pendant qu'on change de chevaux. L'hôtel est garni de plusieurs tableaux parmi lesquels je remarque le portrait de l'empereur Guillaume et l'Exposition de Paris. Il y a même un vieux piano, le premier peut-être qui ait été fait. Le jardin renferme tous les légumes et toutes les fleurs que nous avons en Europe et le verger, les fruits des zones tempérées. Sur le lac, nous voyons plusieurs canots rustiques, creusés dans un tronc d'arbre, et par-ci par-là, les (p. 237) gens ont un vrai type araucan. Pauvres gens! il faut bien qu'ils se mêlent au monde policé. On vient d'envahir leur territoire, et le gouvernement le vend par parcelles aux enchères. Il n'y a pas longtemps, ces Indiens pouvaient disposer eux-mêmes de leurs terres. Lorsqu'ils prouvaient par témoins qu'ils étaient possesseurs depuis plus de trente ans, ils vendaient, pour quelques milliers de piastres, d'immenses terrains, à des spéculateurs qui les payaient en nature et cotaient à 1,000 piastres un baril d'eau-de-vie.
Aujourd'hui, le gouvernement ne reconnaît plus de semblables contrats, et se déclare lui-même propriétaire. Nous remontons en voiture, et après deux heures encore de cahotement, nous arrivons au bord du Bio-Bio, la plus grande des nombreuses rivières du Chili. Elle a environ 2 kilomètres de large en face Concepcion. Là, on nous offre des tapis en peau de huanacos; mais le prix en est plus élevé que de l'autre côté des Andes. Nous passons la rivière en bac; une autre voiture nous reçoit sur le bord opposé, et peu après nous dépose à Concepcion, à l'Hôtel Coddon.
Concepcion, troisième ville du Chili, compte 25,000 habitants. Au centre, une place de 140 mètres de côté, plantée d'arbres, a la cathédrale, la banque, la mairie, pour principaux édifices. Plusieurs statues de marbre et de bronze y ont été récemment installées. On me dit qu'elles ont été prises au Pérou, comme trophée de guerre. Les rues sont larges et pavées, les maisons (p. 238) basses, mais bien décorées. Elles ont au centre une cour ou patio orné d'orangers. Fatigué par l'horrible route, je demande à prendre un bain. Le maître d'hôtel me fait accompagner chez un docteur qui me renvoie à un autre, et celui-ci à un troisième. Je demande pourquoi, à propos d'un bain, on me fait ainsi courir les docteurs de la ville. On me répond qu'ici on ne prend des bains que lorsqu'on est malade, et les docteurs seuls ont le nécessaire. Je dus faire mon deuil du bain jusqu'à mon arrivée à Santiago. À l'hôtel, on m'installe dans une bonne chambre, qu'un curé à mine joyeuse allait quitter. Je le trouve suçant le maté, et aussitôt il m'offre la bombilla pour sucer à mon tour; puis il m'explique, qu'ayant été curé pendant 23 ans en divers endroits, il en a assez, que la responsabilité des âmes est dure, et que maintenant il se repose dans le ministère libre.
Monseigneur Salas, l'évêque de Concepcion, venait de mourir. La cathédrale était drapée de noir, la ville en deuil. Tous les partis rendaient hommage aux qualités éminentes du saint et savant prélat. Il recevait environ 80,000 fr. par an, et il n'a rien laissé après sa mort. Il vivait modestement, et distribuait tout aux pauvres; il est mort en offrant sa vie pour l'Église et pour son pays. Lutteur infatigable, il n'a cessé de combattre le mal par l'exemple, par la plume, par la parole. Il connaissait son temps, et dans son testament, que publient les journaux, je lis ces paroles:
«La grande herejia de los tiempos actuales es la negacion (p. 239) del reino social de Jésus, a quien se quiere alejar i desterrar de las instituciones sociales.
«El mundo, o sea las sociedades humanas, marchan por esto a espantoso cataclismo, i para salvarlas es menester que los hombres de buena voluntad trabajen sin descanso en el sostenimiento i en la propagacion del reino social de Jesu Cristo. Para esto he consegrado esta Diócesis a su sacratissimo Corazon, i pido con toda mi alma al clero i fieles de mi Diócesis que cultiven i defiendan esta devocion fecundissima en bienes de todo jénero.»
«La grande hérésie du temps présent est la négation du règne social de Jésus-Christ, qu'on voudrait arracher aux institutions sociales. Le monde, soit les sociétés humaines, marchent ainsi à un cataclysme épouvantable, et pour les sauver, il faut que les hommes de bonne volonté travaillent sans relâche au soutien et à la propagation du règne social de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai consacré ce diocèse à son sacré Cœur, et je demande avec toute mon âme, aux prêtres et aux fidèles de mon diocèse, de cultiver et de défendre cette dévotion, très féconde en biens de toute sorte.»
Dans la rue, je rencontre des chevaux attendant aux portes des magasins que leur maître ait terminé ses affaires: les uns sont libres, les autres ont des entraves aux pieds. J'en vois même qui ont la tête enveloppée d'un linge, pour les forcer à garder leur poste. De nombreuses voitures conduisent les voyageurs sur tous les points de la ville, moyennant 50 centimes la course. (p. 240) Quelques-unes portent cette inscription: Sorteo; renseignements pris, c'est un maître voiturier qui, pour s'assurer plus de travail et supplanter ses confrères, donne une contre-marque numérotée à tous ceux qui font une course dans ses voitures. À la fin du mois, il tire au sort, et le numéro sorti donne à la pratique la somme de 15 pesos (60 fr. environ). Méthode à signaler!
Je passe la soirée chez M. Risopatron, président de la Cour d'appel. Ce digne magistrat préside aussi une conférence de Saint-Vincent de Paul, qui visite de nombreuses familles pauvres; il y en a une seconde parmi les élèves du Collège. Il me renseigne sur l'organisation judiciaire au Chili. Le tribunal de première instance compte un seul juge, la Cour d'appel cinq. On peut avoir encore recours à la Cour suprême, siégeant à Santiago, qui connaît du droit et du fait.
Je déjeune chez MM. Eschecopar, qui tiennent un des plus beaux magasins d'articles de Paris. Comme dans tous les pays nouveaux, les articles sont nombreux et variés, depuis la malle et le parapluie jusqu'à l'orfèvrerie et la vaisselle. Dans les petites villes et les villages, les magasins tiennent ensemble tous les objets imaginables et inimaginables. Nous causons sur les usages du pays. Les Chiliens regardent parfois l'étranger qui se fixe ici comme un intrus, et appellent en termes de mépris gringo les Anglais et les Allemands, Bacicia les Italiens, godos les Espagnols, gavachos les Français. On peut voir par leur nom que plusieurs des principales (p. 241) familles du pays descendent d'étrangers, et surtout d'Anglais. Ceux-ci arrivent, comme partout, avec un capital et accaparent bientôt les bonnes affaires, puis se marient dans le pays, et leurs enfants sont Chiliens.
Selon mon habitude, je fais une visite à l'hôpital: on apprend toujours beaucoup en voyant et en interrogeant les malades. À Concepcion, 15 Sœurs de Charité soignent là 240 malades, et dans un autre établissement de l'autre côté de la rue, elles ont 124 malheureux de toute sorte: vieillards, imbéciles, idiots et enfants trouvés, et une petite fille de huit ans, grande de 40 à 50 centimètres, ayant la figure humaine, mais, pour le reste, en parfaite ressemblance avec le singe. Elle ne parle pas, et tous ses mouvements sont ceux du singe. Elle a été apportée de la campagne, où elle a un frère présentant le même phénomène. Tous les médecins sont venus la voir et cherchent la cause de ce fait.
Les bonnes Sœurs me parlent de la supérieure de l'hôpital de Talca, qui est revenue de France dans le navire l'Aconcagua. Fille unique d'une riche famille, elle est allée recueillir l'héritage paternel, et après l'avoir distribué aux pauvres, elle retourne soigner les malades aux antipodes de sa patrie. Pour les enfants de Dieu, les sentiments de la nature ne sont pas détruits, mais fortifiés; un horizon plus large les étend à l'humanité et au-delà du temps; la vie pour eux n'est qu'un voyage, les biens un embarras; la famille va avec les pauvres, et avec la patrie, le ciel!
(p. 242) De Concepcion, en remontant le Bio-Bio, on est bientôt en Araucanie. Je ne veux pas manquer une si belle occasion de voir chez eux les Indiens, d'autant plus que le chemin de fer va jusqu'à Angol. Je me rends donc à la gare, où, à une heure après midi, la locomotive siffle et nous emporte. Les wagons sont ceux de l'Amérique du Nord; la gare est luxueuse, la voie a 1 mètre 40; elle remonte le Bio-Bio sur la rive droite. La nature présente le tableau de notre mois de décembre; les arbres sont sans feuilles et le blé commence à peine à sortir de terre; la végétation est pauvre.
Je trouve dans mon wagon M. Risopatron fils, qui s'en va surveiller ses terres à Robléria, près Angol. Il m'aborde et me dit: «Ma mère m'a annoncé que nous ferions route ensemble.—Je me réjouis, lui dis-je, mais j'aurais dû vous voir hier chez vous.—Il répond: Je passe mes soirées chez ma fiancée, je dois me marier dans un mois.» Je montre à mon interlocuteur le bac qui, avant-hier, m'a ramené de l'autre rive du fleuve, et il me dit: «Vous n'êtes au Chili que depuis trois jours, et vous avez déjà passé le Bio-Bio; moi qui ai vingt ans et qui suis né à Concepcion, je ne l'ai pas encore passé.—Cela m'étonne, peu: l'étranger, sachant qu'il sera peu de temps dans un pays, se hâte de le parcourir et de l'étudier sous toutes ses faces; l'habitant du pays se dit toujours qu'il aura le temps.»

Pont de lianes dans le sud du Chili.
Pendant que nous causons, la locomotive parcourt ses 30 kilomètres à l'heure. Nous passons en face d'une grande (p. 243) carrière où de nombreux ouvriers sont occupés à extraire les pierres qui servent à paver les rues de Concepcion, et bientôt nous arrivons au Lecha, affluent du Bio-Bio, que le train passe sur un pont en poutrelles de fer. Là, on s'arrête dix minutes pour prendre le thé, puis la route entre dans une région plus productive et mieux cultivée. Les ranchos, néanmoins, sont toujours de misérables cabanes de chaume ou de branchages. Nous voyons quelques plantations de vignes, mais maigres et sans force. Les troupeaux se montrent plus nombreux. Nous parlons agriculture, et M. Risopatron m'engage à aller passer, le lendemain, la moitié de la journée avec lui, pour voir son genre d'exploitation. «Il n'y a qu'un train par jour sur la ligne, me dit-il, mais adressez-moi un télégramme, et je vous enverrai un cheval qui, dans deux heures, vous amènera chez moi. Vous y dormirez et prendrez le train du lendemain.—Bueno, j'accepte, mais si vous ne recevez pas de télégramme, ce sera une preuve que ma visite aux Indiens aura pris tout mon temps.»
À quatre heures et demie, le train entre en gare à Angol, et une voiture m'amène à travers la ville chez M. Ducasseau, pour lequel M. Darmendrail m'avait remis une lettre. «Soyez le bienvenu,» me dit-il, «les Français chez nous sont toujours chez eux.» Je lui explique le but de ma visite et lui demande à parcourir la ville avant qu'il fasse nuit.
Angol, sur les bords du Pilcomen, affluent du Bio-Bio, compte 6 à 7,000 habitants. Ses rues sont larges, sa (p. 244) place vaste et plantée d'arbres, avec une fontaine au centre. Les maisons, comme dans tous les pays nouveaux, sont en bois, en briques, en adobe, et couvertes en tuiles rondes. Elles n'ont qu'un rez-de-chaussée. Chemin faisant, nous entendons les sons de la guitare accompagnant des voix féminines. Nous nous arrêtons pour écouter. Devant une fenêtre on tire le rideau, et nous voyons deux fillettes, une de treize ans, l'autre de sept ans, chantant sur la guitare une espèce de cantilène, fort semblable aux chansons genre arabe qu'on entend en Espagne et en Corse. Elles conservent la mesure en se regardant mutuellement de leurs grands yeux noirs. Nous rencontrons des officiers et des soldats costumés à la française. Nous visitons quelques maisons et rentrons pour le souper.
M. Ducasseau est à la tête de la plus importante maison de commerce d'Angol; son magasin contient ce qu'il faut aux populations des campagnes, qui ne cessent d'affluer. Il a quatre jeunes gens pour l'aider, et ils peuvent à peine suffire à la besogne. Il va s'en aller à Temuco, à 45 lieues plus au sud, pour y fonder une maison analogue, qui prendra un grand développement aussitôt que le chemin de fer aura atteint cette région.
Tout en dînant, M. Ducasseau me met au courant des usages commerciaux et sociaux des Basques dans ce pays. Comme dans le reste de l'Amérique du Sud, ils ont ici la majorité dans la colonie française; ils s'aiment et se soutiennent. Ils ont plusieurs Sociétés indépendantes, (p. 245) mais elles s'unissent pour l'achat. Un d'eux est chargé de fournir à toutes, les marchandises, et en achetant ainsi par 100,000 piastres à la fois, ils obtiennent des faveurs qui leur permettent de vendre meilleur marché que les autres. Les jeunes gens qui arrivent des Pyrénées viennent parfois pour éviter le rude métier du soldat. Ils sont reçus ici et installés dans les maisons à titre d'apprenti. Ils n'ont d'autre paye que le logement, le vêtement, la table et un peu d'argent de poche: mais après quelques années, s'ils sont intelligents et appliqués, ils sont associés et reçoivent tant pour cent sur les bénéfices. Ils se marient peu dans le pays; le Français est habitué aux femmes travailleuses et ménagères et va généralement se marier en France.
Après le dîner, nous allons à la recherche d'un cacique indien, salarié par le gouvernement, afin que, le lendemain, il puisse de bonne heure nous conduire chez ses compatriotes. La nuit est profonde: quelques rares lampions au pétrole nous servent de points de repaire. À chaque coin de rue, un soldat équipé monte la garde. Il y a peu de temps, la vie était peu en sûreté, soit à cause des Indiens en révolte, soit à cause de Belamino Mendoza, audacieux et célèbre brigand, qu'on vient de tuer il y a un mois. Enfin, nous arrivons à la maison du cacique. Il n'y est pas; sa femme nous donne un enfant, qui vient nous montrer la maison où nous devons le rencontrer.
Il vient avec nous, et nous l'installons devant une (p. 246) bouteille de cognac, dont la vue le fait sourire de bonheur. Il est vêtu à l'européenne: pantalon et macferlan, chapeau calabrais, grand, fort, figure large, brune et aplatie: on le prendrait pour un brigand des Calabres.
«Je désire visiter les gens de ta nation; demain matin tu vas me conduire chez eux. Je désire les voir dans leurs foyers, pour en parler à mes compatriotes.—Bueno, tes compatriotes les verront, car il vient d'en partir plusieurs, avec leurs costumes et leurs lances, qu'un Français est venu chercher pour les conduire à Paris.—Paris n'est pas leur pays; pour moi, je désire les voir chez eux, avec leurs vieillards, leurs femmes et leurs enfants; connaître leur travail, leur cuisine, leur couche; en un mot, les surprendre dans tout leur naturel.—Bueno, demain matin, nous irons à leurs ranchos, au bord de la rivière.—Comment t'appelles-tu?—Juan Colipi Ancamilla est mon nom: Colipi me vient de mon père et signifie: Aqua colorada; Ancamilla me vient de ma mère. Colipi est un grand nom dans ma nation. Mon père était fort respecté. Nous étions vingt frères et je suis le cadet; un de mes frères était lieutenant, en 1839, dans une insurrection au Pérou.»
«Quelles sont les croyances religieuses de ta nation?—Nous croyons au Dieu créateur de toutes choses, et à la vie future; nous honorons Dieu, non dans les images, mais en esprit, nous le figurant vivant sur une montagne, ou dans certains endroits. Nous l'honorons, et nous lui offrons les prémices de ce qu'il nous envoie.—Peux-tu (p. 247) me montrer comment vous faites pour l'honorer?—Là-dessus, Colipi se lève, prend son verre, et dans une attitude grave et solennelle, prononce ces mots, que j'écris d'après le son qui en vient à mon oreille: «Enema-pu ía peomain enimy vlà vatemu tuvacì—Enema-pou putuamaï guè mi mi vlà ustralè imoguen.» Puis il lève les yeux au ciel, et vide son verre sur le sol.—Peux-tu m'expliquer en espagnol ce que tu viens de dire en indien?—Ce que je viens de dire signifie à peu près ceci: Grand Dieu, père de toutes les créatures, tu es bon en me donnant aujourd'hui cette excellente boisson, et je t'en offre les prémices. Puis il ajoute: Pour ce soir, laissez-moi rentrer chez moi; ma femme doit m'attendre pour le souper. Je viendrai demain vous chercher à sept heures.» Après le départ du cacique, M. Ducasseau et moi faisons une visite à l'hôtel d'Angol, où nous trouvons de nombreux officiers, et M. Thomas Mackay, Anglais né au Chili, qui s'en va au fort de Chiguaïhué, sur ses terres. En apprenant le but de mon excursion, il me dit: «Venez chez moi, à cinq lieues d'ici, j'ai une vaste propriété, où j'emploie environ 200 Indiens; nous irons chez eux et vous pourrez les voir à votre aise.—Bueno, j'accepte, nous partirons demain vers dix heures, au retour de l'excursion avec le cacique.»
À onze heures, M. Ducasseau m'introduit dans la chambre qu'il m'a fait préparer, et se retire. Une rapide inspection à mon nouveau domicile me fait bientôt découvrir des fusils, des revolvers, des poignards, des (p. 248) coutelas; évidemment nous sommes en pays d'Indiens. Déjà M. Ducasseau m'avait dit que deux de ses jeunes gens, à tour de rôle, dormaient dans le magasin, où ils, avaient à leur disposition un petit chien pour aboyer, et un énorme bull-dog, pour tuer sans aboyer, l'audacieux qui voudrait pénétrer dans la maison. On lui a coupé la queue et les oreilles, pour que, dans les luttes avec d'autres chiens, il ne soit pas pris à ces parties sensibles.
Le matin, je témoigne un peu ma surprise de me trouver dans un arsenal, mais on me dit que les Araucans ne sont soumis que depuis un an; que l'an dernier ils avaient encore formé une réunion de mille cavaliers, et qu'ils avaient brûlé trois villages chiliens, volant le bétail et tuant les habitants; qu'à la suite de ces faits, le gouvernement a envoyé des troupes, qui ont envahi le pays jusqu'au fleuve Cautin et établi partout des forts pour tenir en respect les guerriers; que, par suite, on a pu reconstruire dans l'intérieur la ville de Villarica, à trois journées de cheval au pied du volcan de Villarica, ville qui, fondée il y a trois siècles, à l'époque de la conquête, avait été détruite ensuite par les Indiens.
À la suite de cette prise de possession, le gouvernement se propose de coloniser le nouveau territoire, et commence par y appeler 2,000 familles d'Europe. On leur paie le voyage, on leur fournit le bétail, les instruments aratoires, et les vivres pendant un an. Elles remboursent les avances en cinq annuités, et sont propriétaires après dix ans.[Table des matières]
Les prisonniers. — Les ranchos indiens. — Vêtement. — Mobilier. — Nourriture. — Les femmes. — Les enfants. — Les bijoux. — Les armes. — L'industrie. — Les funérailles. — Le calendrier ficelle. — L'excursion au fort de Chiguaïhué. — Un fort abandonné. — Apostrophe à deux cavaliers. — Les frères Mackay. — La chasse. — Un camp indien. — La chasse au mauvais esprit. — Musique. — Danse indienne. — Détails sur la ferme. — Le blé. — Le bétail. — Le tabac. — Les forêts. — La main-d'œuvre. — Les machines. — Le gibier. — La petite araignée. — Son ennemie, la mouche. — La Samo-cueca. — Les bâtiments. — Les ateliers de réparations. — Le petit Indien. — Le Cacique et sa famille. — Un jugement plus facile que celui de Salomon. — Le mariage chez les Araucans. — La naissance. — La médecine. — La sorcellerie. — Une grande partie de Chuenca. — Retour à Angol. — Les franciscains. — Le pater Araucan.
Vers sept heures et demie, Colipi arrive et nous le suivons. Dans la rue, les prisonniers arrangent la chaussée, et sont gardés par quelques soldats. Angol, chef-lieu du territoire, possède la prison centrale. C'est là que réside le gouverneur avec pouvoir civil et militaire; il a un bataillon de 300 soldats.
Au sortir de la ville, nous marchons vers l'est. Après avoir traversé quelques champs de blé et des terrains incultes, nous arrivons bientôt au pied de gracieux monticules, baignés par la rivière. Là sont plusieurs pauvres ranchos de roseaux et de paille. J'ai de la peine à croire que des gens y demeurent; mais, à ma grande surprise, (p. 250) en entrant dans le premier, j'y vois une vingtaine de personnes, toutes accroupies à terre. Les hommes fument la pipe, les femmes préparent la nourriture. Les unes brûlent le blé ou l'orge dans un chaudron, les autres le broyent sur une pierre, comme nos peintres le font pour les couleurs. Une vieille passe la farine au tamis, et une troisième la délaie dans une grande marmite posée sur le feu.

Chili.—Types d'Araucaniens en voyage.
L'attitude de tout ce monde est peu rassurante: ils regardent d'un air moitié étonné, moitié fâché. Je remarque que notre cacique, après avoir prononcé le salut habituel: «Mari mari Compagnero», se tenait au dehors. Serait-il considéré par les siens comme un transfuge, et sa présence serait-elle cause que nous sommes moins bien reçus? Toutes ces questions se pressaient dans ma pensée, et je trouvai prudent de ne perdre de l'œil aucun des guerriers. Leur chevelure est d'un noir d'ébène et coupée à la hauteur du cou; les pieds et les bras sont nus. Une étoffe de laine bleue entoure leur corps, de la taille aux jambes. Ils portent sur leurs épaules un puncho rayé de rouge, de bleu et de blanc. Leurs yeux sont noirs, leur regard est fier: ils s'entourent la tête d'un cerceau formé par un mouchoir, à la manière des ouvriers espagnols, et arrachent les poils de leur barbe, n'en laissant qu'une ligne au bord de la lèvre supérieure. Les femmes jeunes sont fraîches et roses: leurs bras sont nus, et jetant en arrière le manteau de laine bleue lié au cou, elles laissent voir une partie des épaules. La même (p. 251) laine bleue entoure leur corps, et pend en jupon serré, jusqu'aux pieds toujours nus. Les oreilles portent de gros pendants en argent, minces et larges de 10 centimètres, longs de 7. Le cou est orné d'un collier dur de 4 centimètres de haut et couvert de perles ou jets d'argent. Sur la poitrine elles portent d'autres ornements d'argent.
Les enfants sont entourés de linge, et emmaillottés dans une litière de bois, qu'on présente souvent devant le feu pour les chauffer. Je cherche les lits: on me montre des peaux de bœuf, de cheval et de mouton, qu'on étend à terre. Je vois aussi dans un coin un petit plancher élevé de 20 centimètres, et qui doit certainement servir de lit à un des nombreux couples.
Les objets de ménage sont variés: des marmites en terre cuite, des plats et des cuillères en bois, des verres en corne, des vases en peau d'animaux. Je prie un des guerriers de me montrer ses armes; il détache du plafond une lance longue de 7 mètres. Le fer, en forme de baïonnette, est attaché au moyen de lanières de cuir ou tendons d'animal, à une longue perche dure et légère de la famille des cannes à sucre. Il me montre aussi un coutelas.
Pour ne pas abuser de ces bonnes gens, sur le point de prendre leur nourriture, nous leur disons: «Mari mari compagnero» et nous allons plus loin à un autre rancho. Il est aussi petit et aussi peuplé; la fumée empêche la vue et fait pleurer les yeux.—«Mari mari compagnero», que Dieu vous garde, compagnons; puis le cacique (p. 252) leur explique que je viens les voir pour parler à mes compatriotes des bons Araucans. Là aussi on prépare la nourriture; mais à côté de la soupe de farine brûlée, je vois une femme qui met dans une marmite des moitiés de pêches séchées au soleil. Près de là, dans une casserole, cuit de la viande; mon compagnon demande au cacique: «Es caballo?» Il lui répond: «No, es vaca.»
À un troisième rancho, un Indien, avec un bout de fer attaché à un bois, prépare des cuillères avec une grande habileté. Une vieille femme, dans un coin, tousse et semble près de sa fin. Dans le quatrième rancho, je remarque un métier vertical et mobile, sur lequel on a étendu les fils de la trame. Je prie l'Indienne de travailler devant moi; elle le fait avec beaucoup de grâce. Ne se servant que des mains, l'opération est longue et difficile. Elle passe une règle de bois entre les fils, et la dresse sur le côté pour former le vide; elle y passe les fils avec la main, et frappe dessus avec une autre règle pour serrer la toile.
Je demande à voir filer la laine: on m'en montre de parfaitement propre et bien cardée. Un long et grand fuseau qu'on tourne à la main reçoit le fil, puis on le double pour la toile; celle-ci est ensuite teinte en bleu foncé dans l'eau bouillante et colorée avec une certaine pierre bleue. Dans un autre rancho, nous voyons une grande caisse, et je demande ce qu'elle contient: «C'est mon père,» dit un guerrier; «il vient de mourir il y a quinze jours; nous ferons les funérailles dans une semaine.» (p. 253) Plus le décédé est placé en dignité, plus on l'honore en retardant la sépulture. S'il s'agit d'un cacique, on l'expose sur les branches d'un arbre, et les caciques voisins viennent lui rendre honneur. Colipi demande à boire, il parle depuis longtemps; on lui présente une corne de bœuf pleine d'eau, dans laquelle on a délayé de la farine; puis je lui dis: «Conduis-moi au cimetière des Indiens.» Dans un coin peu éloigné, au bord de la rivière, on a choisi un petit monticule, sur lequel diverses surélévations indiquent plusieurs enterrements. «C'est ici,» me dit-il, «que mes compatriotes enterrent leurs morts. Dans la caisse, on place des vêtements, de l'argent, des comestibles, de l'eau, du sel pour le grand voyage. Si c'est un cacique, on tue un cheval et on l'enterre avec le mort, afin qu'il puisse arriver dans l'autre monde à cheval.»
Nous visitons un sixième rancho, où je vois deux petits emmaillottés; un de deux mois, un de deux ans. Le premier a tous ses beaux cheveux noirs et touffus comme une grande personne. Les petits qui peuvent réchapper de cette fumée et de ce manque de soins ne peuvent être que solidement constitués. Je vois aussi dans ce rancho de la graine de millet et de lin. Celle-ci, probablement, leur sert pour faire de l'huile. J'ai trouvé le lazo dans tous les ranchos. On y voit aussi une ficelle à nœuds; elle sert à compter les jours. Lorsqu'une réunion de caciques décide un soulèvement ou une expédition, on donne à chacun une ficelle, avec le même nombre de nœuds. Rentrés chez eux, les chefs réunissent les guerriers; et (p. 254) chaque jour ils dénouent un des nœuds. Lorsqu'ils sont au bout, on part pour l'endroit fixé au rendez-vous; et ainsi tous y arrivent ensemble.
Nous disons aux Indiens un dernier mari mari, et revenons chez M. Ducasseau, où nous attendait M. Mackay avec ses chevaux sellés. Nous faisons un rapide déjeuner et l'on prépare la toilette: longues bottes, éperons d'argent massif forme moyen âge, ceinture d'où pend à droite le revolver, à gauche le coutelas; chapeau mou, puncho sur les épaules et lazo suspendu à la selle. Nous avons l'air de trois brigands calabrais. Un domestique nous suit, et nous voilà trottant, galopant dans l'eau, dans la boue comme dans le bon chemin. Mon cheval est solide, son trot est doux, mais il ne veut pas être au-dessous des autres, et saute après eux les fossés, manœuvre un peu nouvelle pour moi.
Le temps est sombre, la température à quelques degrés sur le zéro. La nature est magnifique: c'est bien l'hiver avec les arbres sans feuilles et la terre sans moissons, mais un tapis vert la recouvre, et les collines qui nous entourent portent par-ci par-là des bouquets d'arbres et des forêts. Sur un joli plateau, nous trouvons un fort abandonné. Sa construction est bien simple: un fossé, de quatre mètres de large et autant de profondeur, entoure un terrain d'environ deux mille mètres carrés, sur lequel se trouve un canon et une baraque pour cinquante hommes. Un peu plus loin, deux hommes à cheval s'avancent vers nous, et M. Mackay les arrête et les interpelle: (p. 255) «À qui sont ces chevaux?—Ils sont à moi, répond l'un d'eux.—Qui es-tu et d'où viens-tu?—Je suis un tel et demeure en tel endroit, d'où je suis parti pour aller à Angol.—Bueno, fais ton chemin.»—Un peu surpris de cette manière de haranguer les passants, j'en demande la raison. «Il y a ici bien des voleurs d'animaux, me dit-il, «il est bon de les surveiller; si cet homme m'avait volé ces bêtes, j'aurais pu le reconnaître à l'embarras de ses réponses.»
Nous arrivons à un deuxième fort aussi abandonné, puis la route devient tellement mauvaise, qu'il faut la quitter pour patauger dans les prairies voisines. Enfin, après une heure trois quarts de trot et de galop, les cinq lieues sont franchies: nous sommes au fort de Chiguaïhué. Des chiens de toute race viennent fêter leur maître; puis nous entrons dans la maison, où M. Mackay nous présente à son frère Brownlow, ingénieur. Celui-ci nous a préparé une bonne chambre et un excellent déjeuner. «Comment avez-vous pu savoir que nous venions trois au lieu d'un, lui dis-je?—Le télégraphe m'a tout dit. Mon frère, qui remplit ici les fonctions de subdelegado, ou représentant du gouvernement, l'a à sa disposition.» Durant le déjeuner, on essaie d'établir la conversation en une langue commune, mais c'est difficile, et on parle un mélange de français, d'anglais et d'espagnol, qui excite au plus haut point notre gaieté, déjà stimulée par les meilleurs vins du pays. Après le repas, on monte à cheval et l'on prend le fusil, car le gibier abonde. Pour ma (p. 256) part, j'ai un autre excellent cheval, selle anglaise, étriers de bois enfermant tout le pied, et éperons dont la roue a 6 centimètres de diamètre. Un excellent chien d'arrêt nous précède. Au bord d'une lagune, on tire plusieurs fois les canards. Plus loin, le chien s'arrête; on tire une perdrix, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'après deux heures de trot, nous arrivons au bord d'un ruisseau vers le pied d'une colline, au campement des indiens. Nous visitons d'abord le rancho du cacique. «Mari mari, patron. Que Dieu te garde, patron.—Mari mari, senores. Que Dieu vous garde, Messieurs.—Nous venons voir tes terres et tes Indiens, permets-tu que nous entrions dans les ranchos?—Allez et voyez Caballeros.»—Nous entrons dans plusieurs cabanes: mêmes types, mêmes ustensiles, même manière de vivre et de se tenir, que j'avais vus le matin. Les jeunes gens des deux sexes sont parfaitement constitués. Les jeunes mères soignent leurs bébés avec amour, et tout en fumant la pipe, elles portent sur leur dos leur bébé ficelé à son berceau. Quelques-unes font de fort jolis paniers d'osier. Les hommes, en général, regardent travailler les femmes. Les petits enfants qui commencent à marcher s'enfuient à notre approche; mais, rassurés par les parents, ils reviennent jusqu'à nous prendre des pièces de monnaie. M. Ducasseau s'adresse à une femme:—«Quelle est ta religion?—Celui qui a créé le ciel et la terre est mon Dieu, et je l'appelle mon Père; il y a un autre monde où nous allons tous après la mort.» Comme je montre mon étonnement de (p. 257) la longueur des lances, ce qui doit en rendre le maniement difficile à cheval, M. Mackay donne sa monture à un jeune indien, qui la monte armé de sa lance: sans étriers, il la pousse au grand galop dans la plaine, à la colline, faisant tournoyer le bâton de la lance au-dessus de sa tête, poussant des pointes en avant, de côté, en arrière, parant les coups avec une agilité extrême, toujours en poussant des cris qui effrayent l'adversaire et animent le cheval. C'est ainsi qu'opèrent les guerriers, lorsqu'un membre de la famille est malade. Ils guerroyent autour de leur rancho avec l'esprit mauvais pour l'en chasser. Ces guerriers se sont tous battus avec les soldats du Chili, et plusieurs en portent les traces. M. Mackay m'en montre un qui a eu la mâchoire traversée par une balle.
Nous aurions voulu faire danser ces bons Indiens. Leurs instruments sont la fanfornia, petite aiguille qu'ils agitent entre les dents; une sorte de trompette, et le tambourin. Leur danse est grave, et on la dit gracieuse; mais la pluie arrive, et nous remontons en selle pour galoper vers la maison. Le vent était froid et nous jetait dans la face une eau glacée. Je bénis le puncho qui me garantit comme une cuirasse. À la nuit nous sommes au logis, et M. Mackay veut bien me donner quelques détails sur sa ferme. Il la possède depuis quatre ans, et elle lui coûte environ 60,000 piastres (300,000 fr.). Elle contient 8,000 hectares achetés au gouvernement. On paie à l'État le tiers comptant, et les deux autres tiers en dix annuités sans intérêts. Il sème en blé 550 hectares, et (p. 258) laisse ensuite le terrain reposer plusieurs années. Il met deux hectolitres de semence à l'hectare, et en récolte en moyenne 40. Il emploie 60 charrues américaines. L'Indien les conduit mieux que le Chilien. Il loue 40 Indiens par jour l'hiver, et 140 l'été, pour la récolte. Il emploie toute l'année 60 Chiliens, pour les clôtures en bois, ateliers de réparations, surveillance des animaux et autres travaux. Le salaire est de 1 fr. 25 l'hiver, de 2 fr. 50 l'été; et pour les femmes, de 1 fr. 50, plus la nourriture, consistant en soupe de farine et haricots, dont le coût est de 8 sous par homme et par jour. La main-d'œuvre lui revient à environ 6 fr. par hectolitre de blé, et il le vend à Talcahuano environ 20 fr. Le transport de la ferme au port de Talcahuano lui coûte 1 fr. 50 l'hectolitre. Pour éviter la maladie du charbon, il lave le blé dans de l'eau au sulfate de cuivre. Il laboure trois fois la terre, puis la sème à raison de 28 hectolitres par jour. Pour la récolte, 6 Indiens coupent un hectare de blé dans un jour; mais avec la machine Wood, traînée par des bœufs, un seul homme coupe 6 hectares par jour. Pour le nettoyage, il se sert de la machine américaine, avec un moteur mobile à vapeur, de la force de 8 chevaux. Il peut ainsi séparer de l'épi et de la paille 300 hectolitres par jour. Le district a donné 35,000 hectolitres, il y a deux ans; 80,000 l'an dernier et ce chiffre sera doublé cette année. M. Mackay a essayé aussi avec succès la culture du tabac; il s'occupera plus tard de la vigne et de l'exploitation de ses belles forêts. Pour le moment; il soigne l'élevage du (p. 259) bétail; il a déjà 1,000 bœufs et en aura bientôt 5,000. Il a acheté les vaches maigres à 30 piastres (150 fr.), et les bœufs maigres à 50 piastres (250 fr.); et après les avoir engraissés durant quatre mois dans ses beaux pâturages, il les revend avec 30% de bénéfice. Les bœufs pour la boucherie sont vendus à l'âge de 4 à 5 ans.

Chili.—La Samo-Cueca: Danse nationale.
L'Indien est maintenant soumis, il n'y a plus que cinq soldats au fort. Mais, il y a deux ans, il était encore en lutte. M. Mackay avait vu tuer un soldat dans sa propriété, par un coup de lance; il avait lui-même tué deux Indiens et avait manqué d'en être tué, lorsqu'il en poursuivait une vingtaine qui lui avaient volé du bétail. Maintenant ils travaillent volontiers, et seraient d'excellents ouvriers, s'ils n'avaient l'habitude incorrigible de mettre tout ce qu'ils gagnent en eau-de-vie, et leur plaisir à se soûler.
En fait de chasse, le renard abonde; puis on tue le canard, la perdrix, la grive et la bécasse. On a aussi un petit lion, mais pas de loups, pas de serpents, ni autre fauve ou reptile malfaisant; toutefois, une petite araignée est très dangereuse; elle a le derrière rouge, et c'est là qu'elle tient son venin: elle y passe rapidement ses pattes, les porte à la bouche; s'élance et mord. Si l'on ne cicatrise immédiatement avec l'alcali volatil, la personne mordue se tord dans d'affreuses douleurs, et reste comme folle pendant huit jours; puis elle revient à elle, et quelquefois elle en meurt. Durant la récolte, plusieurs hommes sont piqués tous les jours. Heureusement, cette araignée (p. 260) a trouvé son ennemie dans une petite mouche qui, elle aussi, a le derrière rouge. Elle saute sur l'araignée, la pique et s'envole; elle revient à la charge plusieurs fois, jusqu'à ce que l'ennemie vaincue tombe et meurt.
Pendant que nous causons, l'heure du dîner arrive; puis on organise la danse nationale ou la samo-cueca. Don Manoel, le majordome, est introduit avec sa femme et ses deux demoiselles, gracieuses enfants de 15 à 18 ans. La samo-cueca commence: M. Brownlow, avec la plus jeune des demoiselles, chacun un mouchoir à la main, s'avancent, pirouettent, s'éloignent et reviennent, pendant que la guitare joue un pas de valse, que l'exécutante accentue encore par le chant, et que d'autres battent des mains en cadence. Le symbole de la danse semble être l'attention que le cavalier veut attirer sur lui; la danseuse se défend et finit par laisser tomber le mouchoir au cavalier qui se met à ses genoux. M. Brownlow exécute ses mouvements avec vivacité et brio; la jeune fille, avec grâce et modestie. Puis vient le tour de M. Thomas, qui, plus grave et avec des regards pénétrants, ressemble un peu à un magnétiseur. M. Ducasseau vient s'essayer aussi avec l'imposante matrone, mère des deux jeunes filles, et montre que, dans les montagnes basques, on est aussi gracieux danseur. La danse se retrouve chez tous les peuples; la samo-cueca m'a paru bien plus convenable et moins dangereuse que les genres de danse où la danseuse est dans le bras du danseur.
À onze heures, je quitte le bal et me réfugie dans (p. 261) mon lit, où, sous une bonne peau de huanaco, je peux braver le vent qui souffle comme le Pampero, et amène une pluie torrentielle, qui dure jusqu'au matin. Je me lève de bonne heure, pour rédiger à la hâte mon journal de voyage. Vers neuf heures, tout le monde est levé, et après le thé, pendant que M. Ducassau s'en va tuer grives et perdrix, je visite, avec M. Mackay, les bâtiments de la ferme. Le vieux fort ne sert plus qu'à recevoir les animaux; il pouvait contenir 1,000 combattants; et un mamelon, vers le Malieco, rivière qui coule au bas dans la vallée, était réservé à l'artillerie. Maintenant nous y trouvons le bureau du télégraphe, tenu par une gentille Chilienne, qui le fait manœuvrer devant nous. Nous inspectons les charrues, les machines, les ateliers de réparation. M. Mackay va construire lui-même ses chars, avec le bois d'un arbre indigène appelé litre, sorte de bois de fer. Ses feuilles, ou seulement la rosée qui y séjourne, fait pousser des boutons à celui qui les touche, comme l'arbre de croton. Le bois est blanc, très lourd et très dur. En rentrant, nous rencontrons un petit Indien de 12 ans, trottant gaiement sur son cheval. Il a pour étriers de petits anneaux de fer, où il pose deux doigts du pied. Il tient d'une main un paquet de cigarettes, où la feuille de maïs remplace le papier; dans l'autre, il porte une bouteille d'eau-de-vie. Il pense à la noce que va faire son rancho. Un cavalier nous rejoint et nous dit: «J'étais à votre recherche, le cacique est chez vous et désire vous parler.» En effet, à peine rentrés, (p. 262) nous trouvons sous la vérandah le cacique avec toute sa famille, en habits de fête. Le vieillard a la figure respectable, laisse tomber au vent ses longs cheveux blancs; ses habits sont propres et à vives couleurs. Il est accompagné de ses deux fils, grands garçons de vingt ans, pleins de force et de vigueur. Ses deux filles ont mis leurs plus beaux ornements, les longs cheveux noirs tombent par derrière, en deux longues tresses entourées et recouvertes de perles, ne laissant voir que le bout sur une longueur de 0m10. Pour l'une d'elles, ce bout est un mélange de cheveux noirs et de cheveux rouges. Les pendants d'oreille sont en argent et de 0m10 de large; le collier, d'argent et de perles, est aussi large que celui d'un bull-dog. Sur la poitrine brillent, au centre, de larges plaques d'argent, et sur les côtés pendent des ornements du même métal, portant au bout de nombreux petits cônes de 0m04, faisant clochette. Mais le plus bel ornement est, sans contredit, la beauté du type, la fraîcheur de la jeunesse. L'aînée des filles a l'air triste, et semble faire des efforts pour retenir ses larmes. Sur un signe, tout ce monde s'avance, et le vieillard fait le salut d'usage: «Mari mari, señor subdelegado. Que Dieu te garde, Monsieur le subdelegado: tu es ici pour rendre la justice; je viens à toi pour que tu protèges ma fille.» Il parle l'indien; les paroles sont monosyllabiques, la prononciation a des pauses et des gutturales, exactement comme en offre la prononciation des langues japonaise et chinoise. Le type de ces gens ressemble, en effet, beaucoup (p. 263) au type japonais, croisement de la race blanche et de la race jaune. L'interprète traduit les phrases du cacique, et lui transmet en indien les réponses du subdelegado.—«Mari mari cacique, explique-moi ta pensée—Tu vois cette pauvre fille, et il montre son aînée; elle est jolie comme les étoiles et douce comme un agneau; je l'avais mariée à un guerrier de la tribu, mais c'était un méchant homme: il la battait tous les jours avec le bois, avec la pierre, et a failli plusieurs fois la tuer. Sa patience a enduré longtemps les mauvais traitements, mais un jour elle s'est enfuie à la maison paternelle, et depuis je l'ai gardée chez moi. Or, deux enfants sont nés de cette malheureuse union; un garçon et une fille, qui sont chez le père; et je viens te demander que tu fasses rendre la fille à sa mère, parce qu'elle pourra mieux l'élever. Tu laisseras le garçon au père, parce que les hommes sont mieux élevés par les hommes. J'ai confiance que tu rendras justice à ma malheureuse fille.—Bueno, cacique, dis-moi le nom et la demeure du mari de ta fille, et je le ferai assigner pour qu'il ait à comparaître devant moi. Je ne puis juger qu'après avoir entendu les deux parties.»—Le cacique donne le nom et l'adresse, et il s'éloigne; mais je retiens l'interprète, et félicite le subdelegado de ce que, dans ce nouveau genre de jugement de Salomon, sa tâche sera plus facile. Ayant à partager non un seul, mais deux enfants entre père et mère, il pourra les contenter tous les deux. Je pose à l'interprète demi-indien, demi-chilien, (p. 264) diverses questions sur la famille indienne.—«Quelles sont les cérémonies du mariage?—Le mariage se fait de deux manières: lorsque le jeune homme et la jeune fille sympathisent et s'entendent, ils concertent la fuite. Une belle nuit l'époux arrive, enlève l'épouse et l'emporte à cheval dans la forêt, où ils font la noce durant plusieurs jours. Au retour, l'époux prie les parents d'accepter le fait accompli, et leur remet des cadeaux. La seconde manière a lieu, lorsque la jeune fille n'est pas décidée à se laisser enlever. Alors le jeune homme l'achète à ses parents, en leur faisant des cadeaux. Ces cadeaux consistent en vêtements, chevaux, bœufs, moutons et ornements. Chaque membre de la famille doit recevoir quelque chose, et souvent les jeunes gens donnent tout ce qu'ils ont, et s'appauvrissent à l'occasion du mariage. Si celui qui a enlevé l'épouse refusait les cadeaux, on ferait une expédition contre lui.»
Le riche et surtout le cacique prend plusieurs femmes, parce qu'il peut les nourrir avec leurs enfants; mais le pauvre n'en prend qu'une.
«Quelles sont les cérémonies à la naissance?—On réunit tous les parents pour donner le nom à l'enfant. Ce nom est ordinairement un nom toujours transmis dans la famille. Le parrain et le père se font mutuellement des cadeaux; on finit par un grand repas.—Quels remèdes emploie-t-on pour soigner les malades?—Des herbes diverses; on combat le mauvais esprit avec la lance, et on a recours à la vieille devineresse, (p. 265) qui découvre l'auteur de l'influence malfaisante sur le malade. Alors on le recherche, on le bat pour qu'il enlève cette influence, et s'il ne le fait pas, parfois on le tue. Pour les cérémonies, à la mort, il confirme ce que j'avais appris la veille.—La jeune mère qui est ici venue réclamer justice contre son mari peut-elle se remarier à un autre?—Elle peut se remarier.»
Pendant que nous causons ainsi, M. Brownlow passe à deux Indiens la petite boule de bois et les bâtons de la Chuenca. C'est le grand jeu des Indiens. Ils le jouent à pied et quelquefois à cheval. Nos joueurs s'animent, puis beaucoup d'autres arrivent; et, comme il y a deux chefs, bientôt on se défie entre les deux tribus. Dix guerriers d'une part, dix de l'autre, ils font de leur punchos un monticule que gardent les femmes, puis, à une distance de 100 mètres, ils posent une ligne de piquets à droite, et une à gauche, enserrant une bande large de 20 mètres, longue de 100. La petite boule, de 0m07 de diamètre, est posée au milieu, et on la tape avec des bâtons, sorte de bambous noués et recourbés vers le bout. Chaque parti doit s'efforcer de pousser la boule du côté de l'adversaire, et s'il réussit à lui faire passer la limite du bout, il gagne un point. Si la boule sort des limites latérales, on la replace au centre et on recommence. Il est beau de voir ces vingt jeunes gens, animés par leur chef, s'échelonner, arrêter la boule au passage, la repousser en l'air, la faire sauter avec force, parfois contre les bras et les jambes des adversaires. Dans ce (p. 266) cas, la blessure est soignée sur l'heure, en ouvrant la peau avec un couteau pour faire sortir le mauvais sang. M. Mackay avait promis une somme d'argent aux gagnants: la partie était en quatre points. Au bout d'une heure les vainqueurs arrivent les bâtons en l'air. Ils ont gagné la piastre; quel malheur qu'ils la mettent en eau-de-vie! Les caisses d'épargne sont à créer en Araucanie. Après le déjeuner nous passons encore un peu de temps à voir jouer les Indiens. J'achète la pipe du cacique, entièrement en bois, et un plat de bois que me vend une vieille Indienne. M. Mackay me donne la boule et deux des bâtons qui ont servi à la partie, et un domestique viendra à cheval porter tous ces objets. C'est la vie large, c'est la vie libre, celle de ces montagnes! Et c'est celle que j'aime. Je félicite MM. Mackay d'en jouir, et les remercie pour la bonne et généreuse hospitalité qu'ils ont donnée au voyageur; puis nous montons en selle. Les chemins, inondés par la pluie, sont convertis en lacs, mais M. Ducasseau ne s'effraie pas pour si peu, et y lance son cheval au galop. Le mien suit, et bientôt ils se couvrent de boue et nous en couvrent. M. Ducasseau décharge son fusil sur des perdrix, mais le mouvement du cheval rend difficile une telle chasse. Il tire aussi plusieurs coups de revolver sur une espèce de grive à collier rouge qui ne bouge pas et lui sert de cible. Mais la pluie arrive, et nous poussons nos vaillantes bêtes, qui nous font franchir les cinq lieues en moins de temps que la veille.
À Angol, je change de vêtement et m'en vais chez les (p. 267) Pères franciscains. Je les trouve occupés à faire l'école à une vingtaine d'Indiens. Un vieux Père de Porto-Maurizio (Rivière de Gênes), a perdu l'usage de sa langue natale. Il me parle moitié italien, moitié latin, moitié espagnol, et me confirme, à propos des Indiens, les renseignements que j'ai recueillis. Pour le langage, il me donne une grammaire indienne et castillane, d'où j'extrais la traduction du Pater ci-après:
Inchiñ taiñ chao, huenu meu ta mleymi: uvchigepe tami ghüy; eymi tami reyno inchiñ, meu cüpape. Chumgechi tami piel vemgequey ta huenu mapu meu vemgechi cay vemgepe ta tue mapu meu. Chay elumoiñ taiñ antü covque: perdonanmamoin taiñ huerilcam chumgechi inchiñ perdonaqueviñ taiñ huerilcaeteu, lelmoquiliñ, taiñ huerilcanoam: hueluquemay vill huera dugu, meu montulmoiñ. Amen.
Après le souper, un employé de M. Ducasseau me conduit au Mont-de-piété, où j'espère acheter des ornements indiens. J'en vois en effet plusieurs, mais leur prix est élevé, parce que les détenteurs les revendent à d'autres Indiens.[Table des matières]
D'Angol à Santiago. — La grande Cordillera de los Andes. — La cordillera côtière. — La ville de Talca. — L'hôpital. — Les maladies régnantes. — Les Sœurs du Sacré-Cœur. — Le théâtre. — Le clergé. — Le marché. — Les bains de Cauquènes. — Mésaventure à Gultro. — L'hospitalité du chef de gare. — Détails sur la viticulture. — Prix des terrains. — L'ouvrier. — La Chica. — Une scierie de marbre. — Le Maïpu. — Arrivée à Santiago. — Le garçon d'hôtel et le tarif. — La cathédrale. — Le cerro de Santa-Lucia. — La ville. — Le théâtre. L'Alameda. — L'hôpital. — Les quatre Sœurs de l'Aconcagua. — Les statues des grands hommes. — Les sifflets de nuit. — La plaça de arme. — Les jeunes filles et les tramways. — Les œuvres charitables. Les talleres de San-Vincente. — Le Sénat. — La Légation de France. — Les capucins. — Don Benjamin. — L'hospitalité chilienne. — L'élection présidentielle.
Le 3 août, je remercie M. Ducasseau pour sa large et bonne hospitalité, je dis adieu à ses jeunes gens, et à huit heures, je suis à la gare pour le départ. À la station de Robléria, M. Risopatron me surprend en venant me serrer la main dans le train. Il regrette que le défaut de temps ne m'ait pas permis de m'arrêter chez lui. Je descends le Bio-Bio jusqu'à la station de bifurcation, où j'attends une heure, pour prendre le train du nord qui arrive de Concepcion.
Je profite de l'intervalle pour déjeuner avec un Basque, Jean Etchegoyen, qui veut faire tous les frais. Vers le (p. 270) nord, la route suit une magnifique vallée, qui s'élargit et se restreint tour à tour, depuis trois lieues jusqu'à trente. Elle est bordée par deux chaînes de montagnes: une vers l'ouest, se baignant dans la mer, l'autre vers l'est, qui est la grande Cordillera de los Andes, aboutissant sur l'autre versant à la vaste plaine des Pampas. L'une et l'autre sont couvertes de neige. La plaine est tantôt cultivée, tantôt inculte. Par-ci, par-là, de misérables ranchos, en adobe ou en chaume. Quelques orangers sont chargés de fruits; mais les oranges ne sont pas plus douces que celles de Nice. Aux gares, les femmes vendent aux voyageurs la soupe, divers plats de viande, des pâtés et des conserves de fruits.
À Chillan, ville de 25,000 habitants, la gare est envahie par une foule nombreuse, portant des bouquets de camélias. C'est le curé qui conduit son peuple faire ovation aux quatre Sœurs espagnoles de la Merced, qui se trouvent dans le train. Elles occupent aux premières un compartiment réservé, et je suis étonné de reconnaître en elles les quatre Sœurs que j'avais eues pour compagnes de voyage dans l'Aconcagua. À cinq heures, nous arrivons à Talca, où je descends à l'Hôtel anglais. Après le dîner, je parcours la ville. Elle est chef-lieu de province et contient 25,000 habitants. Elle paraît moins riche que Conception. Dans les parties éloignées, les maisons en adobe ne sont ni pavées ni crépies. Au centre, elles sont en meilleur état. À l'hôpital, je trouve les Sœurs de Charité françaises. Elles me font parcourir les salles, où elles (p. 271) soignent 120 malades. À la salle de chirurgie des hommes je vois plusieurs blessés: le Chilien, lorsqu'il est ivre, joue du couteau comme le Piémontais, et se laisse aller souvent à la férocité. À la salle de chirurgie des femmes sont alignés de nombreux lits occupés par les femmes de mauvaise vie. La police des mœurs n'existe pas, et il en résulte de graves inconvénients. Les maladies régnantes sont: les rhumatismes, causés par l'humidité des ranchos et des maisons non pavées; les maladies de foie, causées par les grandes chaleurs de l'été; les maladies de poitrine, produit des courants d'air; et la petite vérole, appelée ici peste, et qui sévit partout, faute de vaccination. Les Sœurs ont en ce moment vingt et un sujets atteints de cette terrible maladie, mais elles les tiennent dans une autre maison, appelée Lazaret. De l'hôpital je passe à la paroisse. Elle est située sur une grande place plantée d'arbres, avec une fontaine au milieu, dans le genre de la place de Concepcion. L'église a trois nefs avec une coupole élevée, et peut contenir 2,000 personnes. On fait l'exercice du premier vendredi du mois. Les femmes, accroupies à terre sur leur petit tapis, répondent au chapelet que récite le prêtre du haut de la chaire. Ce murmure en cadence de centaines de lèvres a son charme, et rappelle le bruit des vagues de l'océan, lorsqu'il est calme. Les hommes se groupent de préférence dans les bas côtés, près des confessionnaux. Après les litanies, le prêtre déroule un long discours, que les bébés ne peuvent supporter. Pour se distraire, quelques-uns prêchent à leur (p. 272) tour et à leur manière. À huit heures, je rentre à l'hôtel. Le 4 août, c'est l'anniversaire de la naissance de M. Santa-Maria, président de la République du Chili. Toutes les écoles chôment en son honneur. De bon matin, je suis chez les Sœurs du Sacré-Cœur, et je demande la Mère supérieure. Quoique Française, à la suite d'un long séjour au Chili, elle a presque oublié sa langue natale. Les Sœurs du Sacré-Cœur ont de nombreux pensionnats au Chili et au Pérou. Le gouvernement leur a même confié, à Santiago, la direction de l'école normale. À Talca, le pensionnat compte 70 élèves payant vine pension de 700 fr. l'an. Les enfants sont douces et bonnes; il faut un peu de temps pour les former à l'esprit d'ordre et de propreté. Elles aiment le théâtre et la danse, mais ces deux sortes de récréation n'ont pas encore dégénéré ici autant que dans d'autres pays. Le théâtre a été inventé pour instruire en amusant, et n'est dangereux que lorsque, déviant de son but, comme il arrive chez nous, il corrompt en amusant. La plupart des élèves viennent des campagnes; les écoles là n'existent pas, et le clergé est insuffisant. Beaucoup de prêtres de bonne famille trouvent plus commode de rester dans ce qu'ils appellent le ministère libre ou sans emploi, ou bien d'occuper des chapelanies, à Santiago. En face du Sacré-Cœur s'élève un vaste marché couvert, rempli de viandes, de poissons, de légumes et de fruits de l'Europe. On y voit aussi des moules d'une grosseur extraordinaire. Je marchande les principaux articles, et suis (p. 273) étonné de voir que les prix sont à peu près ceux de chez nous: la viande 1 fr. 50 le kilo, le pain 50 centimes le kilo, le vin 10 sous le litre, et le reste à l'avenant. À neuf heures, je suis à la gare pour le départ.
Le chemin de fer suit toujours la vallée, qui tantôt s'élargit, tantôt se rétrécit. Les Andes commencent à se relever; leur altitude, qui n'était que de 3,000 mètres environ au volcan Chillan vers le 37°, dépasse maintenant 5,000 mètres au volcan Maïpu. Bientôt, au 33°, elle atteindra son maximum au sommet du volcan l'Aconcagua, près de Santiago, dont l'altitude est de 6,797 mètres, dépassant ainsi d'environ 2,000 mètres l'altitude du Mont-Blanc. L'Aconcagua est le pic le plus élevé des deux Amériques. Vers le sud, après le 42°, la Cordillère des Andes va en baissant jusqu'au 52°, où elle n'atteint que 1,000 mètres; mais, à son extrémité, au 55°, le pic Darwin au cap Horn a encore 2,071 mètres d'altitude.
J'avais pris mon billet pour la station de Cauquènes dans le désir de visiter les bains de ce nom, aussi renommés pour leurs eaux sulfureuses que par le site pittoresque. On m'avait assuré que, si l'établissement des bains sulfureux de Chillan était fermé en hiver parce qu'il était alors enseveli sous la neige, par contre, celui de Cauquènes, moins élevé, était ouvert toute l'année, et des voitures partant à l'arrivée de chaque train franchissaient en 3 heures les sept lieues entre la station et les bains. J'avais prié le conducteur du train de me prévenir à la station de Cauquènes, où nous arrivons vers (p. 274) deux heures de l'après-midi. Mais le bonhomme oublie ma demande, et comme à Cauquènes il n'y a qu'un arrêt, le train ne fait que ralentir; puis il continue et me dépose à la station suivante, à Gultro. Là, le chef de gare, M. Manoel Alexandro Tarraxo, voyant mon embarras, cherche aussitôt un cheval pour moi, et un pour mes bagages, afin que je puisse rejoindre ainsi la station de Cauquènes, où j'espérais trouver une voiture pour les bains. Tout était prêt, lorsque survient le cocher habituel de la voiture des bains, qui assure que l'établissement est fermé, qu'il n'y a point de voiture pour s'y rendre, et que même, voudrait-on y aller à cheval, les chemins sont défoncés et l'on trouverait là-haut porte close. Dans cette situation, je prie le chef de gare de me faire conduire à l'hôtel du village, pour attendre le train qui passe à neuf heures, le lendemain, pour Santiago. Il me répond qu'il n'y a là ni hôtel ni village, et que Gultro est une simple campagne; mais que, si je veux bien accepter, il m'offre chez lui l'hospitalité. Je n'avais pas de choix, et j'accepte avec reconnaissance. Dans peu de temps, Mme Tarraxo a préparé sa meilleure chambre, et je m'y installe pour rédiger mon journal. Tout y est pauvre mais propre; les parois intérieures sont en toile tapissée et la toile du plafond est crevassée, mais que pouvaient-ils donner de plus, ces braves gens, à l'étranger, puisqu'ils donnent tout ce qu'ils ont! À cinq heures, ils m'admettent à leur table servie d'un copieux dîner. Un petit garçon de cinq ans fait la joie des parents, une fillette de douze ans nous sert (p. 275) et la maîtresse de maison a l'œil à tout. On m'avait peint la femme chilienne comme molle, indolente et aimant à se faire servir. Celle que j'ai sous les yeux dément ces renseignements. Après le dîner, nous faisons une longue promenade sur la voie ferrée, jusqu'à une grande ferme, où nous causons avec le seigneur de l'endroit. Un mariage dans les environs attire de nombreux invités. C'est par troupes que les cavaliers galopent à côté des amazones. Si je n'étais pressé, je serais allé moi-même à la noce; on m'assure que j'y aurais été reçu avec l'hospitalité des anciens temps. Je renonce à mon désir, et je rentre à ma chambrette pour continuer mon travail jusque assez avant dans la nuit.

Chili.—Cataracte ou Salto Del Laja.
Un vent de glace soufflait avec violence et amenait une pluie torrentielle; j'eus de la peine à me réchauffer.
Le matin, un soleil resplendissant éclairait une scène grandiose. La pluie de la plaine était de la neige dans les montagnes; elles en étaient couvertes jusqu'au pied, aussi bien la chaîne ouest que la grande chaîne. Elles paraissent plus imposantes dans leur éblouissante toilette. Après le déjeuner, je demande à payer ma note. Ces braves gens refusent tout argent, contents, disent-ils, de m'avoir tiré d'embarras. Exemple de plus à ajouter à l'esprit hospitalier des Chiliens! À neuf heures, le train arrive, et je reprends ma route. Bientôt la vallée se rétrécit pour un instant, jusqu'à ne laisser passage qu'à la petite rivière; ce point est appelé Augustura. Deux Basques français sont dans le train et parlent viticulture; (p. 276) excellente occasion pour me renseigner à bonne source sur ce genre de produits agricoles, qui tend à se multiplier dans le pays. Chacun, en effet, veut maintenant avoir sa vigne, mais comme les indigènes sont encore peu experts dans ce genre de culture, ils recherchent les vignerons français. Si vous pouviez m'en donner une vingtaine, me disait un grand propriétaire, je les placerais à l'instant au prix de 4 à 500 fr. par mois, avec logement et un peu de terre à cultiver pour les besoins de leur famille. Je donne au mien 600 fr. par mois. On me cite un Français qui, de vendeur d'allumettes, avec de la conduite et de l'ordre, par la culture de la vigne, a maintenant une fortune de plus de 600,000 fr. Mon interlocuteur me fait remarquer à droite et à gauche de belles plantations. Elles sont entourées d'un mur de terre, pour les préserver des incursions des animaux. Vous pouvez, me dit-il, distinguer les cultures indigènes des cultures françaises; dans les premières, les vignes poussent à l'avenant sans échalas; dans les autres, elles ont chacune leur piquet ou conduite de fil de fer galvanisé. On ne les plante que dans la plaine ou autre endroit arrosable; car, durant les six mois d'été, il ne pleut jamais, et il faut les arroser souvent. Le propriétaire indigène donne volontiers la terre au viticulteur français, pour neuf ans, à condition que celui-ci la plante en vignes, en retire le revenu; et comme prix de location, après les neuf ans, la terre et la vigne reviennent au propriétaire, qui l'exploite alors pour son propre compte. Dans cette opération, le vigneron, au (p. 277) bout des neuf ans, a gagné environ 2,000 piastres, soit 10,000 fr. par cuadra monnaie nominale. Je dis monnaie nominale, car la piastre ou peso-papier, qui est censé valoir 5 fr., ne vaut actuellement que 3 fr. 70, à cause du change et du cours forcé du papier-monnaie.
Une cuadra est un carré de 150 varras de côté, soit 22,500 varras carrées. La varra équivaut à 0m86, en sorte qu'une cuadra équivaut à 18,769mc, soit environ 2 hectares. Le prix du terrain varie de 200 à 500 pesos la cuadra, selon le plus ou moins de proximité de Santiago; et demande environ 2,000 pesos de frais de plantation, intérêt du capital jusqu'à la récolte, etc. La terre étant très mobile et sablonneuse, il suffit d'un bon labour à la charrue; et on plante dans le sillon, soit à bouture, soit à barbeau. Dans le premier cas, on a à peu près 20% de pieds secs à remplacer; dans le second, à peine 3%. Les indigènes labourent même avec une charrue entièrement de bois, portant parfois un petit morceau de fer au bout.
Les ouvriers sont souvent nomades, et s'attachent peu à la ferme. On les paie de 25 à 30 sous par jour en hiver, et presque le double à la récolte. On leur donne pour nourriture un pain de 3 sous le matin, des haricots à midi, un petit pain de 2 sous le soir. Ces ouvriers nomades font le lundi, et mettent tout leur argent en boissons. Ils ne recommencent à travailler que lorsque la faim se fait sentir; ceci révèle un désordre social auquel les classes dirigeantes devraient se hâter de porter remède. Une cuadra de terre reçoit environ 7,000 pieds de vigne. (p. 278) La vigne produit au bout de trois ans et donne environ 58 arobas de vin par cuadra, mais elle arrive ensuite jusqu'à donner 300 arobas. L'aroba ici n'est plus la même que de l'autre côté des Andes; elle est de 35 litres pour les liquides, pendant qu'elle n'est que d'environ 12 kilogrammes pour les grains. Une aroba de vin, depuis les droits élevés mis à l'importation, vaut 3 pesos (de 12 à 15 fr.), soit de 0 fr. 30 à 0 fr. 40 le litre. Mon interlocuteur a trouvé plus de bénéfice à convertir sa récolte en chica, boisson spéciale au pays; et, pour l'obtenir, voici comment il procède. Il écrase le raisin, chauffe le jus et écume, puis il met dans les cuves deux poignées de cendre, pour clarifier, et cuit ensuite à 12 ou 15 degrés et met en barrique. Après cinq ou six jours vient la fermentation, et il vend ce produit 3 pesos l'aroba, ou de 10 à 20 sous la bouteille, suivant la qualité. J'ai bu souvent la chica; on la trouve dans toutes les maisons, elle tient du vin et de la bière. Elle est jaunâtre et agréable au goût, mais elle est laxative.
L'autre Français, avec lequel je lie conversation, est aussi depuis longtemps au Chili, et s'est occupé d'industries diverses. En dernier lieu il avait traîné de lourdes machines par des chemins de chèvre, dans les Andes, afin d'y monter une scierie de marbre. On l'avait assuré que le chemin voiturable suivrait bientôt, et il avait voulu prendre le devant; mais le chemin ne fut point achevé, et il ne put tirer parti de ses marbres, par l'impossibilité de les transporter. Il abandonna donc l'entreprise (p. 279) et les machines, avec une perte de 9,000 pesos: un indigène aurait attendu que le chemin promis fût exécuté.
Tout en causant, le train marche, et bientôt il passe le Maïpu, sur un pont en poutrelles de fer. Dans les environs est le champ de bataille dans lequel furent défaits les Espagnols. La blanche muraille des Andes s'élève toujours à notre droite avec majesté, et, à notre gauche, la chaîne centrale est blanchie aussi jusqu'au pied. On me montre, à droite, un petit monticule, que couronne une maisonnette à vérandah. C'est de là que la Commission scientifique française a fait ses observations sur le passage de Vénus, pendant que les astronomes chiliens l'observaient de leur observatoire. Nous voici à l'avant-dernière station, à San-Bernardo, qu'aime à fréquenter le peuple, le dimanche; puis nous entrons en gare à Santiago, vers onze heure un quart. Je monte en voiture et dis au cocher: À l'Hôtel Ingles. Il tenait bien dans sa voiture le tarif réglementaire, mais il avait déchiré les chiffres des prix. Je crus donc prudent de me renseigner à l'hôtel, et, en arrivant, je demande au concierge, qui vient au-devant de moi, quel est le prix que je dois à la voiture: un peso, Señor, fut sa réponse, et je donne un peso (5 fr.), mais j'apprends bientôt que le tarif porte 0 fr. 75, et j'en fais la remarque au bureau de l'hôtel. Le secrétaire exprime ses regrets, mais il ajoute que l'hôtel ne peut répondre de ses domestiques: bon à savoir!
Ma première visite est pour la poste, où je parcours les (p. 280) longues listes des lettres en souffrance, toujours affichées à l'entrée; mon nom ne s'y trouve pas. Le voyageur est alors désappointé, car, depuis la dernière station, il pense à la station suivante, où il pourra trouver les nouvelles des parents et des amis.
J'entre à la cathédrale. C'est dimanche et j'en profite. Cette vaste et belle église semble avoir servi de modèle à la plupart de celles du Chili. Elle est romane et a trois nefs. De gros piliers massifs, de calcaire, soutiennent les voûtes en bois; précaution nécessaire ici à cause des fréquents tremblements de terre. Les autels sont ornés de statues et de tableaux, copies des grands peintres italiens. Les ornements du plafond et des autels sont blanc et or; les lustres, les vases d'albâtre, les lampes placés avec goût, donnent au monument un aspect imposant et agréable.
De grandes orgues surmontent la tribune au-dessus de la porte d'entrée; deux orgues plus petites lui répondent à l'autre extrémité de l'église. Il paraît que les paresseux sont nombreux ici; l'église est comble pour la messe de midi. Les femmes, enveloppées dans leur noire mantilla, se tiennent accroupies sur leur petit tapis, et ressemblent à autant de nonnes. On voit pourtant quelques bancs, quelques chaises et prie-Dieu. La tenue de tout ce monde est pieuse, mais, selon l'usage d'ici, on ne se lève pas à la lecture des évangiles.
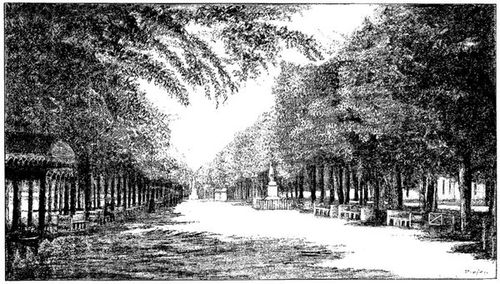
Chili.—Calle de Las Delicias ou Alameda a Santiago.
Pour bien m'orienter, je commence par grimper sur le cerro de Santa-Lucia. Ce rocher élevé a été converti en (p. 281) lieu de plaisance: des statues, des créneaux, des grottes, des jets d'eau, surprennent à tout instant le visiteur; mais il est encore plus surpris de lire sur un ensemble d'arceaux: Aqueduc romain. Vraiment, si on ne l'avait écrit, il ne serait venu à l'idée de personne qu'il pût y avoir en Amérique un aqueduc romain; c'est porter un peu loin l'amour de l'imitation. Après une longue ascension à travers un labyrinthe d'allées et d'escaliers, j'arrive au sommet, couronné d'un petit kiosque, et je vois à mes pieds toute la ville et la campagne, bornée par la superbe muraille des Andes, toute blanche de neige.
Santiago, capitale du Chili, est située au pied des Andes, au milieu d'un amphithéâtre de montagnes, à 700 mètres d'altitude et par 33° 27 latitude sud. La population est de 220,000 habitants. Les maisons sont basses, ordinairement à un seul rez-de-chaussée. Elles sont construites en adobe, briques de terre et paille, qu'on croit plus élastiques pour résister aux tremblements de terre; les toitures sont en tuiles rondes. Les rues ont environ 10 mètres de large. À l'est, la Calle de las delicias, ou Alameda, divise la ville en deux. Vers l'ouest court une rivière un peu à sec, comme le Paillon de Nice. Les clochers sont nombreux. Quelques édifices publics et privés, assez jolis, s'élèvent au-dessus des maisons. Au loin, des quintas, ou maisons de campagne. Après avoir vu la ville de haut, je descends pour la voir de près. Le premier édifice sur mes pas est le théâtre; j'y entre pour voir la salle. Elle est assez vaste, à trois rangs de loges ou plutôt (p. 282) de galeries, car les séparations ne sont qu'à hauteur d'appui. Le parterre est fortement incliné. Le prix d'entrée est de 10 fr., celui des loges de 100 fr. Une troupe italienne joue Lucrecia Borgia. À l'hôpital Saint-Jean; je trouve 20 Sœurs de Charité, soignant 400 malades hommes, répartis en plusieurs salles au rez-de-chaussée et au premier étage; toujours beaucoup de blessés par suite de l'ivrognerie. Une salle est remplie d'enfants; ils mangent ici trop de fruits verts. Les Sœurs ont, ailleurs, l'hôpital des femmes et l'hôpital Saint-Vincent. Elles ont ici une maison mère, et un noviciat qui leur a déjà formé plus de 100 Sœurs chiliennes. Elles donnent en outre l'instruction à de nombreuses élèves, dans plusieurs écoles. Je suis heureux de retrouver les quatre Sœurs que j'ai eues pour compagnes de voyage dans l'Aconcagua. Une d'elles restera à Santiago, deux iront à l'hôpital de Talca, et la quatrième à l'hôpital de Valparaiso. Comme des soldats, elles n'attendent que la consigne et sont toujours prêtes à partir. Ceci nous dédommage un peu du mal qui se fait ailleurs par plusieurs de nos nationaux. Toujours patriotes, elles voient volontiers un Français. Elles se réunissent et veulent que je leur parle de notre chère France. J'eus de la peine à les quitter. Que leurs prières et leurs mérites accompagnent le voyageur!

Chili.—Santiago.—La Plaça de Arme.—L'Hôtel Ingles. Vue des Andes dans le lointain.
Je descends l'Alameda: on l'appelle ainsi du nom des peupliers d'Italie dont elle est plantée, arbre qui en espagnol s'appelle alamede. Le nom de Calle de las delicias qu'on lui a donné serait bien adapté, si elle était mieux (p. 283) entretenue. Elle se divise en 5 larges allées et a plusieurs: kilomètres de long. Les statues des grands hommes du pays en complètent l'ornement. On ne peut qu'applaudir à l'idée de mettre sous les yeux des générations l'image des hommes qui ont illustré la patrie. Le bon exemple est aussi contagieux; mais il faut éviter que les coteries (p. 284) ou l'esprit de parti ne faufilent des hommes petits parmi les grands hommes.
J'arrive à une des plus belles maisons qui bordent l'Alameda, chez le sénateur Don Francisco de Borja Larrain Gaudarillar, frère de l'administrateur du diocèse. Il est président du Conseil des Conférences de Saint-Vincent de Paul, et me donne des détails sur cette institution charitable au Chili et à Santiago. Dans la capitale, les Conférences sont au nombre de 7; outre la visite des pauvres, elles s'occupent de la visite des écoles, des catéchismes, et ont fondé une maison d'arts et métiers, où l'on apprend le travail à 200 orphelins. M. Larrain m'invite à la visiter le lendemain.
Le soir, à chaque coin de rue se tient un sergent de ville et des inspecteurs à cheval passent fréquemment. Ils sifflent à tout instant pour correspondre entre eux, et continuent ainsi toute la nuit, jusqu'au matin; les voleurs n'ont pas beau jeu. La plaça de arme ou place centrale, dont l'Hôtel anglais occupe une des faces, est fort jolie. D'un côté la cathédrale, de l'autre la mairie et l'intendance. Le passage San-Carlos, sur un des côtés, et un autre passage en forme de croix, derrière l'hôtel, laissent voir les étalages de superbes magasins; la plupart français.
De bon matin, je vois dans les rues des vaches conduites de porte en porte: la fraude est à l'ordre du jour, et le moyen le plus sûr d'avoir le lait pur, c'est de le voir traire. Je monte en tramway; les carritos (nom qu'on leur (p. 285) donne) vont partout; je suis étonné de voir une demoiselle venir me demander les 5 sous réglementaires. Depuis quelques mois, ce sont les jeunes filles qui font ce service dans les tramways; mais évidemment ce n'est pas là leur place. On me dit que c'est pour leur donner du travail, dont elles manquent. Les dames de la haute société sont partout les protectrices de la fille du peuple. Il serait sage qu'elles s'associent pour procurer à ces jeunes filles un travail de couture et de broderie qui leur vient maintenant tout fait d'Europe. Elles ôteraient ainsi le prétexte à un métier peu fait pour favoriser la pudeur, qui est pourtant le plus bel ornement de la femme.
J'arrive enfin au bout de la ville, aux Talleres de San-Vincente, où je trouve M. Larrain et plusieurs de ses confrères. Les Frères de la Doctrine chrétienne, venus de France, dirigent l'établissement. Nous parcourons les ateliers de menuiserie, de tailleur, les dortoirs, le réfectoire, la cuisine, et nous passons au jardin pour voir les agriculteurs. Ce jardin contient 10 hectares: en vignes, prairie, blé et pommes de terre. Durant l'été, la sécheresse est telle, qu'il faut tout arroser, aussi bien le blé que le reste. Ces 200 enfants, en quittant l'établissement, connaissent un métier qui ne les laissera pas manquer de pain:
M. Larrain me donne rendez-vous au Sénat pour l'après-midi, et je m'en vais chez les lazaristes. Le Père supérieur, homme calme, fin observateur, et habitant le (p. 286) pays depuis longues années, me donne des détails nombreux. Le gouvernement l'avait chargé d'ouvrir en Araucanie plusieurs écoles dirigées par des Sœurs de Charité, mais la guerre survenant, il fallut courir au plus pressé; et les bonnes Sœurs, au lieu d'aller instruire les Indiens, durent se dévouer à panser les blessés dans les 7 ambulances qui leur furent confiées. On calcule que les morts de la guerre, pour le Chili, se sont élevés à environ 20,000. M. le supérieur pense, avec raison, qu'un établissement agricole ou ferme modèle, confié aux Trappistes, ferait le plus grand bien en Araucanie. Il importe en effet d'apprendre à ces bons Indiens l'agriculture, qui leur permettra de tirer parti de leur sol productif.
À deux heures et demie, je suis au Sénat. M, Larrain me fait visiter l'établissement, qui est réellement monumental: d'un côté, le Sénat avec de nombreuses salles pour les Commissions; j'en remarque une garnie d'un excellent buffet; de l'autre, la Chambre des députés, et au centre la vaste salle où le Congrès, composé des deux Chambres, se réunit d'office une fois l'an. M. Larrain s'en va prendre part à la séance. J'assiste à la discussion dans la loge des journalistes. Une vingtaine de sénateurs sont présents, quelques-uns fument. Ils parlent de leur place et assis, en s'adressant au Président, selon le système anglais. Il s'agit d'abord d'une loi sur le personnel des chemins de fer, puis on passe à la nomination du Président et des Vice-Présidents du Sénat; et enfin on fait retirer le public pour procéder secrètement à la nomination d'un (p. 287) général. Je fais passer ma carte et une lettre au sénateur Don Benjamin Vicuña Mackenna; il paraît un instant et me dit: «Je suis en ce moment occupé à la discussion; venez dîner chez moi ce soir, à cinq heures; nous pourrons alors causer à notre aise.»
Je quitte le Sénat pour me rendre à la Légation de France. Le secrétaire, M. Bourgarel, m'accueille avec bonté, et m'invite à dîner pour le surlendemain. En revenant sur mes pas, j'entre chez les capucins pour remettre une lettre au Père gardien. Ce vénérable vieillard me met au courant des travaux de sa Congrégation auprès des Indiens d'Araucanie. Ils ont là 20 missions, et vont en créer deux nouvelles. Le gouvernement leur donne 2,000 pesos pour construire maison, église et école dans chaque station. Hier, me dit-il, deux fils du cacique de Roboa sont venus de la part de leur père me demander des missionnaires, et je vais leur en envoyer. Ils ne se sont pas toujours montrés aussi faciles; et pas plus loin que l'année dernière, dans une insurrection où les Indiens de l'autre côté des Andes étaient venus à leur secours, ils ont brûlé tout devant eux. À Impérial, les deux Pères de la mission, ayant perdu jusqu'à leurs chevaux, durent se sauver à pied, et rejoindre par cinq jours de marche la station la plus rapprochée.
Ce couvent, me dit-il, est la maison de retraite des vieux Pères qui ne peuvent plus travailler. Quelques-uns pourtant se consacrent encore aux missions des campagnes. Comme je me montrais pressé par le rendez-vous (p. 288) chez Don Vicuña Mackenna, le bon vieillard me dit: Venez demain à midi déjeuner avec nous, nous pourrons causer. Puis il me fait parcourir le jardin, couvert en partie par de belles treilles de vignes. Nous traversons les cours plantées de grands orangers, et à l'église je remarque de magnifiques tableaux, scènes de l'Évangile copiées par un Italien sur les parchemins d'un ancien bréviaire. À cinq heures et demie j'étais à la quinta de Don Benjamin. C'est ainsi qu'on appelle ici ce sénateur. Il est fort populaire et connu de tout le monde. Il me reçoit avec beaucoup de bonté et me fait parcourir son magnifique jardin. Un pavillon isolé contient sa riche bibliothèque, et lui sert de maison de retraite pour ses nombreuses compositions. Travailleur infatigable, il a déjà publié plus de cent volumes, et à l'heure actuelle il écrit quatre ouvrages en même temps, édités à New-York, et en Europe.
M. Vicuña Mackenna me présente à sa femme, qui avec lui a visité l'Europe, et à ses 4 charmants enfants. L'hospitalité antique est en honneur dans le pays.
Les grands tiennent une vaste table toujours servie. J'y prends place ce soir, et, sur mon désir, on me fait, goûter les plats et la boisson nationale, la casuela, le haricot et la chica. La conversation est pour moi fort instructive. M. Vicuña Mackenna a été candidat à la présidence de la République, en concurrence avec M. Pinto, prédécesseur de Santa-Maria, président actuel. Le Président sortant présente un candidat, et le peuple un autre, (p. 289) et le suffrage décide; mais la sincérité ne préside pas toujours à toutes les opérations, et la liberté n'est guère assurée qu'au plus fort. M. Mackenna a même été blessé par certains émissaires pendant qu'il pérorait à Angol, et a failli être accusé de cacher des munitions, parce qu'on avait vu ses domestiques transportant les livres de sa bibliothèque. Il croit qu'il est très difficile à un candidat indépendant de lutter contre un candidat officiel, armé de toutes les forces du gouvernement. C'est regrettable; car la force provoque la force, et l'on roule ainsi dans le cercle destructeur des révolutions.
Après le dîner, l'aînée des jeunes filles nous distrait par quelques morceaux de piano, et enfin je prends congé de cette bonne famille; mais, en me quittant, M. Mackenna me dit: «Demain, à une heure, j'irai vous prendre à l'hôtel, et nous visiterons ensemble les principaux établissements de notre capitale.»[Table des matières]
Le collège des jésuites. — L'épiscopat. — La Saint-Albert. — La Monnaie. — Le ministre des finances. — Le papier-monnaie. — Incendie de l'église de la Compañia. — La bibliothèque. — L'Université. — Lutte à propos des cimetières. — Les Cercles catholiques. — La Quinta normal. — Les Pères de Picpus. — Un dîner diplomatique. — De Santiago à Valparaiso. — La hacienda de Limache. — L'Urmaneta. — Le huasso. — Une vacherie. — Une porcherie. — L'élevage. — Salaires. — Logements. — La ville de Valparaiso. — Le port. — Le gaz. — Don Mariano Sarratea. — Le code civil. — Le gouverneur ecclésiastique. — L'hôpital. — Le logement des pauvres. — Los padres frances. — Les docks. — Les grues Amstrong. — La belle Elène. — Le séminaire. — Les Sœurs de la Providence. — L'enseignement par les yeux. — Le club français. — Guerre barbare.
Au collège des Pères jésuites, l'église, sur le type de Saint-Ignace de Rome, contient de beaux tableaux. Le pensionnat reçoit 300 élèves; les dortoirs sont divisés en petits compartiments; les cabinets d'histoire naturelle et de physique sont bien fournis. La maison est en adobe et en bois. M. le supérieur, homme d'esprit et de tact, me renseigne sur l'organisation ecclésiastique dans le pays. Il est divisé en trois évêchés, dépendant de l'archevêché de Santiago; mais, à l'heure actuelle, l'archevêque de Santiago est mort, et, par suite d'un conflit, entre le Saint-Siège et le gouvernement, il n'a encore pu être remplacé. À la vacance d'un siège, les Chambres désignent trois candidats et le président propose un des trois à la nomination (p. 292) du Pape. L'évêque de Concepcion vient de mourir, celui de Ancud est mort aussi, et il ne reste que celui de la Serena, qui est complètement sourd. Les Congrégations religieuses se recrutent spécialement dans la classe inférieure. Les grandes familles donnent des membres au clergé, mais ils prennent rarement une charge, et gardent la situation de prêtres libres. Dans les campagnes, le clergé est absolument insuffisant. Chemin faisant, je visite encore quelques familles françaises, et à midi, je suis chez les capucins. C'est le jour de sant' Alberto, fête du supérieur. Plusieurs laïques sont invités et placés à côté des moines. Les tables, ordinairement si frugales, sont couvertes aujourd'hui de mets abondants. Il fait beau voir ces vieillards, dont la barbe a blanchi dans les montagnes d'Araucanie! Celui qui est à côté de moi parle l'espagnol avec un accent étranger, et j'apprends qu'il est des Abruzzi, en Italie. Je le plaisante alors de ce qu'il est venu si loin évangéliser des Indiens, pendant qu'il avait tant de brigands à convertir dans son pays. Pressé par le temps, je porte un toast au supérieur et à la Communauté et je me sauve à l'hôtel, où je trouve une invitation pour dîner, le soir même, chez le sénateur Concha. Peu après, survient l'avocat Risopatron, fils du président de la Cour d'appel qui m'avait reçu à Concepcion. Ce jeune avocat fait en ce moment un travail fort utile pour son pays: il rédige le dictionnaire des lois chiliennes, avec commentaire et jurisprudence. M. Mackenna arrive aussi et voudrait m'avoir jeudi au théâtre, mais je pars jeudi matin.
(p. 293) Il me conduit au palais de Moeda, où sont les divers ministères, et me présente à son ami Don Pedro Cuadra, ministre de Hacienda (du commerce). Je trouve en lui l'homme doux, aimable, intelligent. Il se met à ma disposition pour tout renseignement, et fait porter chez moi les dernières statistiques, pour me donner une idée exacte du mouvement industriel, agricole et commercial du pays.
La fabrication de la monnaie: fonte et purification de l'or, de l'argent et du cuivre, laminoir, découpage, coulage, le tout ressemble à ce qu'on voit dans les Monnaies de tous, les pays. L'or vaut actuellement ici 715 pesos le kilog., et l'argent 43 pesos. (Peso, valeur nominale, 5 fr.) Dans le même établissement, on fait le papier-monnaie, sous la direction d'un Français. Pour éviter la dépréciation de ce papier, le gouvernement donne un intérêt aux banquiers qui le déposent dans ses caisses, mais, comme plusieurs banques ont été autorisées à émettre du papier-monnaie, jusqu'à concurrence de 150% de leur capital, elles déposent le papier de l'État, qui leur donne un intérêt, et mettent en cours le leur. Elles arrivent ainsi à donner des dividendes de 20%. On me dit que le papier-monnaie émis par le gouvernement, ne dépasse pas 12 millions de pesos. Sur le monnayage de l'argent, vu le dixième d'alliage, le gouvernement gagne environ 1% et 1 et demi% sur celui de l'or. L'or fait prime, mais il pèse 6% de moins que l'or français, 8% de moins que l'or anglais, et 11% de moins que l'or américain.
(p. 294) En sortant de la Moeda, nous trouvons un membre du gouvernement, qui nous annonce comme bonne nouvelle, la probabilité de voir la paix signée prochainement. Les Chiliens viennent, en effet, de remporter dans le nord, à Huamachuco, une grande victoire sur les Péruviens, qui se sont retirés en perdant un millier d'hommes; et on espère qu'ils accepteront les dures conditions du vainqueur.
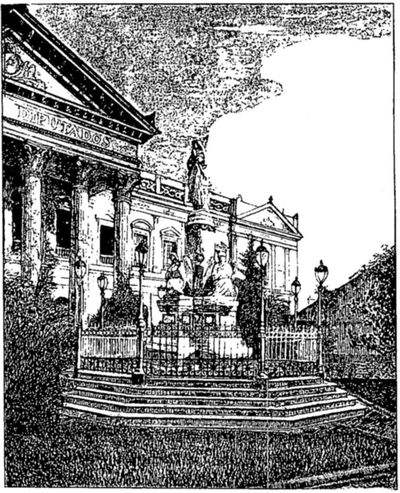
Chili.—Santiago.—Monument commémoratif de l'incendie de l'Église de la Compañia.
Mon cicérone me conduit sur le lieu du terrible incendie de l'église de la Compañia, où 2 à 3,000 personnes trouvèrent la mort. Il me trace les détails de l'effroyable drame: l'église était comble, c'était la fête de l'Immaculée-Conception. Le feu se communique aux tentures et la panique fait perdre la tête aux assistants. Ils se précipitent vers les portes, mais les premiers rangs sont culbutés et forment une muraille humaine, impossible à franchir. Les quelques-uns qui se sauvent passent par la porte de derrière. J'interromps M. Mackenna pour lui demander si le détail donné par plusieurs récits que j'ai lus, concernant la fermeture des portes de derrière, pour préserver du vol les objets du culte, était vrai. Il me répond qu'il est absolument faux; qu'il était présent, et que tous ceux qui se sont sauvés sont passés par cette porte. Parmi les sauvés on me cite Mlle Rodriguez, jeune fille appartenant à une des premières familles, fort jolie et très répandue dans le monde. Elle fut retirée nue, mais sans blessures, et le lendemain elle entrait novice au couvent du Sacré-Cœur, où elle fait encore l'édification (p. 295) des pensionnaires. L'emplacement du couvent de la Compañia est maintenant occupé par le Palais du Congrès, et à l'endroit où s'élevait l'église, on a construit un square, au milieu duquel se dresse une statue de l'Immaculée-Conception. Sur le piédestal on lit cette inscription:
(p. 296) A LA MEMORIA
DE LAS VICTIMAS IMMOLADAS POR EL FUEGO
EL VIII DE DICIEMBRE DE MDCCCLXIII
EL AMOR Y EL DUELO INEXTINGUIBLES
DEL PUEBLO DE SANTIAGO
DICIEMBRE VIII DE MDCCCLXXIII
À la mémoire
des victimes immolées par le feu
le 8 décembre 1863
l'amour et le deuil inextinguibles
du peuple de Santiago
8 décembre 1873.
Nous entrons au Sénat, où M. Vicuña dicte à un secrétaire diverses lettres qui doivent me servir au Pérou; puis nous passons à la Bibliothèque, où le bibliothécaire me fait cadeau de quelques livres sur le Chili. Nous allons ensuite à l'Université. Elle réunit les quatre facultés de lettres, sciences, droit et théologie. Pour les cérémonies de la proclamation des grades, on a élevé une grande salle surmontée d'une coupole. À côté, se trouve le Collège national pour l'enseignement secondaire; le latin et le grec ont été supprimés et remplacés par deux langues vivantes. Sur mes questions concernant les divers professeurs, M. Vicuña m'en cite un, M. Barros d'Araña, homme de grand talent, mais qui a passé sa vie à inspirer l'athéisme à la nouvelle génération. Il a fait ainsi plus de tort au pays que s'il lui avait fait perdre plusieurs batailles; car une génération athée aura beaucoup à souffrir et ne sera ramenée à la foi que par la souffrance.
Nous passons à la mairie; dans la grande salle, parmi (p. 297) les médaillons retraçant les portraits des divers maires, je remarque celui de mon guide. En sortant, celui-ci rencontre un ami qui lui annonce un grand malheur: le fils unique de M. Barros d'Araña, dit-il, vient de tomber de l'escalier de sa maison et il est mort, le père est inconsolable. Je vous quitte, me dit M. Vicuña, je vais essayer de soulager ce pauvre père.
Le soir, M. Concha avait réuni à sa table de nombreux amis. On cause sur les questions du jour. La loi sur les cimetières laïques vient d'être approuvée par le président et jette le trouble dans les consciences catholiques. Les protestants peuvent avoir leur cimetière exclusif; les catholiques ne peuvent avoir le leur. Ils sont forcés de porter leurs morts au cimetière civil. Il y a déjà tant de peine à conduire les vivants, pourquoi va-t-on réveiller les morts? La loi sur le mariage civil est à l'ordre du jour; les catholiques se groupent pour résister. Une société civile s'est formée au capital de 300,000 pesos (2,500,000 fr.). La plupart des actions sont souscrites, on va acheter pour un million de francs un terrain central, pour y construire un Cercle destiné à la classe dirigeante. Le reste, du capital sera employé à élever sept Cercles catholiques d'ouvriers, dans les divers quartiers de la ville, et la jeunesse catholique en formera les comités. M. Concha reçoit la Revue, l'Association catholique et toutes les publications du Comité des Cercles catholiques de France. Je signale à ces messieurs la nécessité d'améliorer le logement de l'ouvrier et du paysan dans le (p. 298) Chili, et l'utilité de prendre en main la direction du mouvement irrésistible vers l'instruction populaire et l'assistance mutuelle.
Le lendemain, M. Terrier, maître de l'Hôtel anglais, revenu d'une partie de chasse, veut bien m'accompagner à la Quinta normal, et me présenter au directeur, M. Lefèvre. La Société d'agriculture a fondé cette ferme modèle il y a cinq à six ans, et la subventionne. La vente des plantes et semis fait la plus grande partie des frais. Là se trouve le palais de l'Exposition de 1875, vaste et beau monument. Il est transformé maintenant en musée et école agricole. On y voit une collection de machines et de tous les produits du pays. Les cours ont lieu deux fois par jour: ils sont théoriques et pratiques. À la suite d'un examen et levé d'un plan de ferme, à la fin du cours, les élèves reçoivent le diplôme d'ingénieur agricole. Dans les jardins, nous voyons de belles pépinières et des vergers, où les élèves s'exercent à la taille. M. Lefèvre a organisé des haies vives de vignes, d'acacias et de saules d'un bel effet.
Au compartiment des animaux, nous trouvons les animaux indigènes: llamas, huanacos, vicuñas, diverses sortes de renards, le condor, et un grand oiseau aquatique à longues pattes, à long cou, avec plumes blanches et rouges, et qu'on appelle flamengo. On voit aussi un superbe lion emporté de Lima, comme trophée de guerre. M. Lefèvre me fait remarquer le produit du croisement du bouc et de la brebis. La tête est celle du (p. 299) mouton, le poil celui de la chèvre. Ces animaux se reproduisent pour quelques générations, mais leur fécondité est limitée.
La Quinta normal a encore un enseignement vétérinaire, confié à un professeur français. On voit là un hôpital de vaches et chevaux pour l'enseignement pratique, et, dans un compartiment voisin, de magnifiques taureaux de Durham, de superbes mérinos et autres animaux importés à grands frais pour l'amélioration des races.
Au retour, nous rencontrons dans le tramway notre ministre, M. Pascal Duprat, qui me donne rendez-vous à la Légation, dans l'après-midi; ne l'y ayant point trouvé, je visite la principale des tanneries du pays, appartenant à M. Tiffon. Cette industrie est principalement aux mains des Français. Celle-ci tanne 18,000 cuirs par an, et 6,000 peaux de moutons; prépare les maroquins et toutes sortes de peaux. Elle a utilisé la vapeur pour la plupart de ses opérations; mais cette industrie languit, parce que le débit est restreint au pays, les droits étant presque prohibitifs en France.
Je me rends chez les Pères de Picpus, connus ici sous le nom de Pères français. Leur internat compte 220 élèves, suivant les divers cours jusqu'à la philosophie. Les cabinets de physique et d'histoire naturelle sont bien montés, la chapelle est enrichie de statues venant de Belgique, de vitraux faits en Angleterre.
Le soir, M. Bourgarel, notre secrétaire d'ambassade, (p. 300) me prend à l'hôtel et m'emmène chez lui. Il avait invité à sa table M. Magliano, Turinais, chargé d'affaires d'Italie, et nous donne en miniature un véritable dîner diplomatique. M. Magliano a connu plusieurs de mes amis; M. Bourgarel a occupé plusieurs postes, et habité deux ans la Chine. Nous avons des souvenirs communs; la conversation fut intéressante, et nous nous séparâmes bien avant dans la nuit, en nous donnant rendez-vous en France; car M. Bourgarel attend un congé de six mois.
À huit heures, je suis à la gare pour le train direct de Valparaiso, et m'installe dans un wagon à l'européenne, bien rembourré, mais mal suspendu. Il y a 180 kilomètres de Santiago à Valparaiso; le train direct les franchit en quatre heures et demie. La voie suit d'abord la plaine, d'où l'on continue à voir la blanche et imposante muraille des Andes; puis on atteint bientôt la Cordillère centrale, que la voie traverse par de fortes courbes, des pentes raides et plusieurs tunnels. Sur les monts, où paissent les vaches, on voit d'énormes cactus gigantea à plusieurs branches, et, par-ci par-là, quelques maigres oliviers. Un Chilien me dit que l'olivier était très répandu dans son pays, mais une maladie l'a presque anéanti. Vers neuf heures et demie, à la station de Llaïlaï, nous déjeunons et quittons les montagnes. La voie suit maintenant une riche vallée couverte de prairies et de blé, mais les ranchos y sont toujours misérables. Aux stations on nous présente de magnifiques bouquets de violettes, de roses et d'héliotrope. (p. 301) Les pêchers sont fleuris: évidemment l'hiver s'en va et le printemps approche. Nous avons aussi quitté l'altitude de Santiago où je voyais la glace dans la rue, et nous approchons de la mer. M. le sénateur Vicuña Mackenna m'avait donné une lettre d'introduction auprès des frères Eastman, qui ont à Limache une importante hacienda. Je savais que c'est de là que sort le bon vin d'Urmaneta que je buvais à Santiago. Je tenais à voir de près ce genre de culture, et je m'arrête à la station de Limache.
Non loin de la gare, j'arrive à un superbe château entouré d'un magnifique parc. M. Rodolfo se montre plein d'égards, et, apprenant que je désire aller le soir même à Valparaiso, il prend de suite les dispositions pour me faire visiter sa ferme. Elle comprend deux parties, sur une étendue de 10,000 hectares. Une est plantée de vignes; il vient de l'acheter à sa belle-mère: l'autre sert au bétail, et il vient de la vendre à son frère aîné, ingénieur de chemin de fer, père de huit enfants. Carlos, le plus jeune frère, est gérant des deux propriétés et perçoit un tant pour cent sur le revenu; il est installé avec sa famille dans un joli chalet, sur un terrain que Rodolfo vient de lui donner. C'est bien là faire les affaires en famille.
Les vignes sont tenues par un vigneron français. La plantation occupe environ 80 hectares contenant 260,000 ceps, et produisant tous les ans une moyenne de 6 à 7,000 arobas. Une aroba remplit 40 bouteilles. Le phylloxera (p. 302) n'a pas paru, et l'oïdium est vaincue par le souffre. Les vignes sont bien taillées et alignées sur fil de fer galvanisé. Nous parcourons la vaste cave à deux étages. Le vin reste pendant trois ans en fût, et on le transvase trois à quatre fois l'an en le clarifiant avec la poudre Appert. Au bout de trois ans on le tire, et on le vend après un an de bouteille. J'en goûte de trois qualités: l'Urmaneta ordinaire de 1879, ressemble au Beaujolais; l'Urmaneta blanc, tient du Chablis; l'Urmaneta caverné de 1877, qu'on prendrait pour du Porto. Les deux premières qualités sont vendues 9 pesos la caisse de 12 bouteilles, environ 3 fr. la bouteille; la troisième 15 pesos la caisse.
Les chevaux sont sellés, et nous partons pour l'autre ferme. Un huasso (le même qu'on appelle gaucho dans la République argentine), sur une selle formée de plusieurs peaux de mouton superposées, et, armé de son lazo, nous précède. Nous arrivons au compartiment des vaches; elles sont maintenant au nombre de 200, et de 500 pendant l'été. Les 200 produisent environ 1,000 litres de lait, qu'on vend à Valparaiso, au prix de six sous le litre. Une vingtaine de femmes sont occupées à traire, et on les paie trois pesos par mois. Le matin, après qu'on a pris le lait, on laisse les vaches dans la prairie avec leurs veaux; vers midi on les sépare.
On fait devant nous le rodeo: des hommes à cheval poussent tous ces animaux, mères et enfants, dans une vaste cour, d'où ils doivent passer dans une seconde, (p. 303) mais, à la porte, les veaux sont arrêtés, et enfermés dans un compartiment à part où ils trouvent de la farine et de l'herbe. Ces vaches produisent en outre 50 livres de beurre par jour, vendu 3 fr. la livre.
Nous parcourons les prairies, divisées par des rangées de peupliers d'Italie. M. Eastman y fait planter par intervalle des groupes de chênes pour que les vaches puissent s'abriter à l'ombre durant l'été. Nous arrivons à une porcherie, où 440 porcs sont engraissés par les résidus du lait et la farine de maïs. À l'heure des repas, on sonne le tam-tam, et ils s'empressent de courir des bords de la rivière Limache, qui coule tout près. Nous cherchons un gué pour la traverser, et nous avons de la peine à sortir des buissons odorants qui la bordent; enfin nous arrivons à un endroit où les chevaux n'ont de l'eau que jusqu'au ventre, et ils avancent précédés du chien de chasse, qui nage à ravir.
De l'autre côté de la rivière, M. Eastman me fait remarquer les travaux de canalisation par lesquels son frère se propose d'arroser 200 hectares de plus; puis nous grimpons les collines sur lesquelles paissent 2,500 moutons, que le propriétaire vend au prix de 3 pesos à l'âge de 10 mois. Il reçoit aussi dans la ferme les chevaux des tramways de Valparaiso, ce qui lui donne encore un revenu de quelques milliers de francs par mois. Les ouvriers employés sont au nombre de 40 environ. On sème aussi la pomme de terre, le maïs et le blé, mais seulement pour l'usage de la ferme. Le salaire varie de 1 fr. 25 à (p. 304) 2 fr. 25 par jour, nourriture en plus. Les frères Eastman, quoique protestants, en hommes intelligents et chrétiens, ont établi, pour leur personnel et les paysans des environs, une chapelle catholique et des écoles gratuites. Ils ont aussi commencé à leur construire des maisons décentes, où la propreté sera possible et la moralité sauvegardée. Elles leur coûtent 250 pesos, 1,200 fr. chaque. C'est un bon exemple.
À trois heures dix minutes, je reprends le train, et à cinq heures, je descends à Valparaiso, à l'Hôtel Colon.
Valparaiso est la deuxième ville et le port principal du Chili. Elle est bâtie au bord de la mer, mais limitée de toute part par des cerros ou collines. On a pu construire à peine deux ou trois rues au bord de l'eau, et la population ouvrière se loge dans des maisons de bois sur la pente des cerros. Il serait facile d'utiliser cette situation et de tracer un plan régulier sur les plateaux des collines, avec tramways à corde sans fin, comme on a fait à San-Francisco de Californie. La population compte maintenant 180,000 âmes. On vient de la fournir d'eau au moyen d'une canalisation, mais elle est assez chère. Le gaz coûte aussi O fr. 75 le mètre cube, et les trois compagnies qui le fabriquent donnent des dividendes de 40%. On fait des essais pour l'électricité. Après une visite à la poste, je passe la soirée chez M. Mariano Sarratea, qui, au nom de la République argentine, a négocié avec le Chili le traité de délimitation de la frontière vers la Patagonie. M. Sarratea, Argentin, mais fixé depuis (p. 305) 40 ans au Chili, connaît bien ce pays, et nous pouvons en causer longuement. Il me fait cadeau du Code civil chilien. J'y remarque, qu'en fait de succession, le père dispose toujours de la moitié, et l'époux survivant hérite toujours du quart, ou d'une portion égale à celle d'un des fils; mais, contrairement aux dispositions du Code argentin, le Code chilien a reproduit notre législation en lait de séduction. La recherche de la paternité est interdite; la fille séduite n'a d'autre droit que de déférer serment au séducteur, pour lui faire confesser s'il croit être le père: remède dérisoire! Aussi, ici, comme en France, on recueille des fruits amers du manque absolu de protection pour la femme.
M. Sarratea m'avait donné rendez-vous chez les Pères de Picpus. Ils desservent une vaste église et tiennent un externat qui réunit 200 élèves pour les études secondaires. M. le supérieur me fait visiter l'établissement. Au musée, je remarque des cordes en cheveux tressés, des flèches et des lances en pierre, hameçons en os, et autres objets que les Pères ont apportés de leurs missions dans les diverses îles de l'Océanie. Dans la collection des volatiles du pays, il y a des condors, un bel albatros de Magellan, le flamengo, grand oiseau aquatique au plumage rose; le loïco, espèce de merle à gorge rouge; le tenca, qui chante comme le rossignol; le tordo noir à bec noir; le piccaflor, dont le bec fin a 10 centimètres de long; le loro-bruto, espèce de perroquet du Sud qui dévore le blé et le raisin. Parmi les quadrupèdes, on me montre le (p. 306) chingue, qui, poursuivi par les chiens, les met en fuite en lançant, des glandes qu'il tient derrière, une matière fétide insupportable. Parmi les végétaux, je remarque le cochayuyo et la luce, deux herbes marines qu'on mange ici. Les Pères m'invitent à dîner pour le soir. Je les quitte pour déjeuner chez M. Sarratea. Les grands du pays ont toujours table servie. À l'hôpital, 21 Sœurs de Charité soignent 500 malades, et desservent l'hôpital militaire contigu. Je rencontre là une des 4 Sœurs du navire l'Aconcagua, tout émue de revoir un Français, qui lui rappelle la patrie absente. La Sœur supérieure me fait parcourir les salles. Quelques-unes sont pleines de malheureuses jeunes filles. Il n'y a ici aucune surveillance ou police des mœurs. Devant l'hôpital, on a élevé une statue à M. Antonera, qui a légué 1,500,000 pesos aux pauvres. Bon exemple! Au port, je remarque deux dique ou docks flottants. Un est occupé par un immense steamer en réparation. Je vois aussi de belles dragues à vapeur, et sur le môle récemment construit sur poutrelles de fer, je trouve 13 grues, système Amstrong, mues par l'eau comprimée; 8 sont mobiles et courent sur 4 pieds à roues, laissant libre espace aux wagons de marchandises. La plus grande est fixe et soulève 45,000 kilogrammes à la fois. Un grand steamer allemand est accosté au môle, et les nombreuses grues puisent les marchandises, qu'elles déposent sur des wagonnets, les emmenant aux entrepôts de la douane. On vient de construire encore 8 de ces entrepôts à cinq étages, de 50 mètres de (p. 307) long sur 20 de large. Des ascenseurs hydrauliques montent les colis à tous les étages. Dans aucun de nos ports je n'ai vu un système aussi bien imaginé pour décharger et emmagasiner rapidement la marchandise. L'Aconcagua, steamer de 4,500 tonnes, a été déchargé et rechargé en trois jours et demi, et il contenait 45,000 colis. Parmi les nombreux navires, je remarque une corvette et un aviso de guerre.
Je grimpe le cerro pour dominer la ville et pénètre dans un fort. Il y en a 22 autour de la rade, armés de canons Amstrong et Parrot, avec boulets de 450 kilos. La vue s'étend au loin jusqu'aux Andes, derrière lesquelles le soleil se couche en lançant une lueur rougeâtre sur les hauts pics couverts de neige.
À cinq heures et demie j'étais chez les Pères de Picpus. Ils avaient réuni à leur table le gouverneur ecclésiastique et autres notables du pays. Un des Pères préside une des deux Conférences de Saint-Vincent de Paul, et un des membres s'offre à me faire visiter le lendemain quelques familles pauvres, pendant que Don Mariano Casanova me retient pour la visite du séminaire et autres établissements. La conversation fut animée et intéressante. À huit heures je quitte les convives pour passer la soirée dans la famille Barthels, que j'avais eue pour compagne de voyage dans l'Aconcagua. Elle avait été bonne pour moi, et une des demoiselles, charmante enfant de 19 ans, m'avait donné des leçons d'espagnol. Gracieuse Hélène, que Dieu veille sur ton avenir!
(p. 308) Le lendemain matin, un confrère vient me prendre à l'hôtel, et nous grimpons les cerros pour voir quelques familles pauvres; partout grande misère et maisons délabrées. La première que nous visitons a, comme presque toutes, une seule chambre. Un mauvais tapis est tendu sur la terre nue; des chiffons bouchent les crevasses. Dans un lit, une vieille à bout de forces; dans un autre, une femme qui tousse comme les poitrinaires au dernier degré. Un troisième lit est réservé à une jeune femme qui tombe du mal caduc. Une jeune fille de 20 ans et une de 7 ans couchent à terre; elles prendront certainement la phtisie ou le mal caduc, si elles ne sont paralysées par le rhumatisme. Une petite cabane près de la porte sert de cuisine. Je demande à mon confrère ce qu'on paie d'ordinaire un tel logement. Il vaut 8 pesos (40 fr.) par mois, me dit-il.
Dans la deuxième maison, composée aussi d'une chambre non pavée et délabrée, nous trouvons une pauvre veuve dont les nombreux enfants sont à l'école: l'aîné a 18 ans et fait le menuisier, mais il a déjà donné signe de phtisie. Presque partout dans ces misérables huttes, nous voyons le linge des gens aisés qu'on donne à laver et à repasser. Bien souvent les médecins se creusent la tête pour savoir comment les maladies de poitrine ou autres pénètrent dans des familles qui n'en ont jamais souffert. Ils pourraient faire une visite au logement des lessiveuses et repasseuses. Ainsi, par une juste punition, la classe aisée souffre elle-même d'une triste situation (p. 309) faite à la classe populaire, et qu'il serait de son devoir de changer.
À neuf heures j'arrive au séminaire, où m'attendait le gouverneur ecclésiastique. Cet établissement renferme 70 élèves, et on construit une aile à part pour ceux qui se destinent à la prêtrise. Il y a 6 ans, le directeur était encore laïque, et parmi les plus mondains de la ville. Il y aura toujours des ouvriers de la onzième heure.
Du séminaire, nous passons chez les Sœurs de la Providence. Nous voyons le pensionnat des Sœurs françaises du Sacré-Cœur, et un orphelinat que construit à ses frais la famille Edwards. Cette famille a donné aussi 500,000 pesos pour l'achat du terrain d'un nouvel hôpital. Les Sœurs de la Providence appartiennent à la Congrégation canadienne que j'avais vue à Québec et à Montréal. Elles ont ici un externat avec 600 élèves, et un internat avec 50 pensionnaires à 50 fr. par mois. Elles sont chargées des enfants trouvés et en réunissent une moyenne de 10 par mois, qu'elles placent à la campagne. Elles ont 8 maisons au Chili, et instruisent 1,000 élèves à Santiago. Leur système d'instruction m'a paru remarquable: pour les premières classes, l'enseignement se fait principalement par les yeux, au moyen de nombreux tableaux. C'est ainsi qu'elles apprennent facilement et vite aux petites filles, la religion, l'histoire, l'histoire naturelle et même le calcul, car un ingénieux système de boulettes et de compartiments leur permet de faire faire facilement aux élèves les principales opérations.
(p. 310) J'avais déjà remarqué aux États-Unis de l'Amérique du Nord cet excellent système d'enseigner par les yeux. Il serait important de le généraliser chez nous. On éviterait ainsi bien du mauvais sang aux maîtres et aux maîtresses, et bien des maux de tête aux jeunes intelligences, encore incapables d'idées abstraites.
M. le gouverneur ecclésiastique avait réuni à sa table les supérieurs du séminaire et des Pères français et autres personnes notables. Après le déjeuner, je rends visite à M. Abel Schmid, notre consul, avec lequel nous causons longuement sur le Chili et sur les 700 compatriotes qui forment notre colonie à Valparaiso. M. Devès, un des principaux négociants, m'introduit au Club français et m'inscrit dans ses registres. Divers négociants français et chiliens me donnent des lettres pour le Pérou, et je viens au port. Une quantité de fer encombre une partie des quais. Ce sont des ponts démontés et des rails. Je demande à un Chilien d'où vient cette ferraille. C'est tel chemin de fer, me dit-il, que nous avons démonté au Pérou; nous allons l'établir chez nous, à tel endroit. On m'avait fait une réponse analogue à Concepcion, à Talca, à Santiago, lorsque je demandais la provenance de belles statues de marbre ou de bronze. Même à la Quinta normal, en voyant un beau lion d'Afrique, on m'avait dit qu'il avait été apporté de Lima.
Les Chiliens en cela se montrent arriérés d'un siècle: ils en sont encore à l'époque de Napoléon Ier, qui enlevait les objets d'art. Si les Chiliens qui voyagent en Europe (p. 311) remarquaient un peu l'effet que produit la même cantilène répétée à tous les monuments d'Italie ou d'Espagne, ou d'ailleurs: «Il y avait ici un trésor, mais il fut emporté par Napoléon; telle statue, tel tableau a été envoyé à Paris par le conquérant, mais il a été restitué après la paix,» ils se persuaderaient qu'il est plus sage de ne pas semer derrière soi des souvenirs de haine qui se transmettent aux générations.[Table des matières]
Départ pour le Pérou. — Le steamer La Serena. — Mes compagnons de voyage. — Navigation. — L'arche de Noé. — Coquimbo. — Les fonderies de Guayacano. — Un dîner politique. — La ville la Serena. — L'intendant. — L'évêque. — La garde nationale. — Huasco. — Carrizal-Bajo. — La fonderie Gibbs et Cie. — Main-d'œuvre. — Logements. — Les forces de la nature. — Le maestranza. — Encore la Samo-cueca. — La poésie et la musique. — Caldera. — Le désert d'Atacama. — Le chemin de fer de Copiapò. — Le borax. — Chañaral.
Un petit bateau me porte au navire de guerre Le Blanco, corvette de 2,500 tonnes, portant six gros canons Armstrong. Les officiers chiliens me le font visiter avec bienveillance, et de là je passe à la Serena.
Ce navire de la Pacific steam Company déplace 1,900 tonnes et a une machine de 250 chevaux effectifs. Les cabines sont sur le pont où il y a plus d'air; mais, au dessous on vient d'installer 200 bœufs, des moutons, des poules; c'est l'arche de Noé, par trop parfumée sans doute. Je suis heureux de rencontrer des voyageurs de l'Aconcagua, qui vont au Callao, et j'ai pour compagnons de navigation le bon Don Mariano Casanova, gouverneur ecclésiastique de Valparaiso, et deux de ses amis: M. Jean Walker Martinez, qui s'en va à Antofagasta, pour inspecter certaines mines dont il dirige la Société; et son cousin, M. C. Walker Martinez, avocat, ancien député et ex-ministre (p. 314) du Chili auprès de la République bolivienne. C'est lui qui a négocié et signé avec la Bolivie le traité dont la violation vient de faire naître la terrible guerre qui dure encore entre le Chili d'une part, et le Pérou et la Bolivie de l'autre.
La nuit, le roulis fut très fort; les 200 taureaux, au-dessous des cabines, ne pouvant tenir debout, roulaient et glissaient tantôt sur leurs jambes de devant, tantôt sur leurs jambes de derrière, et faisaient un bruit peu commode. Les agneaux et les brebis bêlaient, et parfois on sentait le besoin de se cramponner à la couchette pour ne pas être renversé. Un bébé, dans la cabine voisine, ajoutait ses pleurs aux gémissements de la maman. C'est toujours la même scène durant les premières quarante-huit heures de l'embarquement; ensuite les estomacs s'habituent, et tout le monde retrouve la gaieté. Le lendemain, à la pointe du jour, je demande mon bain, mais on ne donne ici que des bains froids. Le soleil levant nous laisse voir dans la brume une côte dénudée, puis il se voile toute la journée dans les brouillards. Vers une heure nous passons entre des rochers, et peu après on jette la sonde. Ce n'est pas superflu: à quelques pas de nous, on voit dans la baie la carcasse en fer d'un steamer échoué il y a quelque temps. Enfin, à deux heures, le canon annonce que nous sommes arrivés à Coquimbo, et on jette l'ancre à 200 mètres de terre. Le capitaine nous dit qu'on ne repartira qu'à sept heures du soir; nous avons donc le temps de débarquer.
(p. 315) La baie de Coquimbo, fort gracieuse, est occupée en ce moment par de nombreux navires qui viennent y chercher le minerai de cuivre. J'y vois aussi une frégate espagnole, portant le nom de Navas de Tolosa. Elle vient ici pour saluer les drapeaux du Chili à l'occasion de l'hommage rendu par celui-ci aux soldats espagnols tombés dans la dernière guerre entre les deux pays, et faciliter ainsi la signature d'un traité de paix.
À droite, on voit fumer les hautes cheminées des fonderies de cuivre de Guayacano, qui travaillent avec le charbon de pierre porté des mines de Lebu, entre Lota et Valdivia; à gauche, nous apercevons la fumée des fonderies Lambert, qui a gagné dans ses mines plus de 50 millions de francs et qui a construit un chemin de fer entre ses fonderies et le port de Coquimbo.
M. Casanova et ses deux amis m'invitent à descendre à terre dans le même bateau, et à les suivre. Nous parcourons quelques rues fort propres, et arrivons à un estaminet célèbre pour la préparation de la casuela, sorte de soupe chilienne, dans laquelle on découpe de la viande et une poule. La maîtresse vient au-devant de nous, et nous montre la table mise. Avertie par dépêche, elle avait tout préparé. Elle est grande, forte, active, et cause politique comme un ministre. Elle s'est vaillamment battue à la guerre, me dit M. Martinez, qui lui remet plusieurs prospectus à distribuer. On parle de celui-ci et de celui-là, et je suis tout étonné de me trouver à un dîner politique, dans lequel l'agent principal semble être la matrone. (p. 316) Parmi les bonnes choses qu'on me sert, je remarque plusieurs sortes de fruits spéciaux au pays: la popaja, la lucuma, de la grosseur d'une pomme, écorce verte, intérieur jaune, moelleux et goût de marron. Elle a pour noyau une châtaigne qu'on dit vénéneuse, la palta, qui a la forme d'une poire verte: on la coupe en deux, l'intérieur est à demi-creux. On saupoudre de sel et on mange la chair avec une cuiller à café; elle a le goût de l'olive mûre prise à l'olivier. Après le dîner on monte en voiture et, fouette cocher! car le temps nous presse. Nous voulons en effet visiter Serena, capitale de la province, ville de 20,000 habitants. Elle est située à une lieue et demie au bout du cap qui forme la baie. Les chevaux suivent la plage sur le sable mouillé; il me semble refaire le trajet de Caïffa à Saint-Jean d'Acre. Un autre cocher, parti après nous, nous devance; mais le nôtre, piqué d'orgueil, fouette et dépasse à son tour le rival. Cela dure si bien, que nous courons risque de prendre un bain dans les vagues. Enfin, nous arrivons sains et saufs à la magnifique Alameda de la Serena.
La voiture nous conduit chez l'intendant, M. Domingo de Toro, qui commande la Province. Il a fait la campagne du Pérou comme colonel, et nous accueille avec bonté. Il nous fait passer à la salle à manger, toujours servie chez les grands, et après quelques libations, il me montre une belle collection des minerais que fournit la contrée; il me donne une grande pierre de cuivre du poids de plusieurs kilogrammes. Ayant sa femme malade, il exprime (p. 317) son regret de ne pouvoir m'accompagner, et me signale comme établissements dignes d'être visités, le séminaire, le collège et l'hôpital. Nous passons devant les bâtiments des deux premiers de ces établissements, et rendons visite à Monseigneur l'évêque de la Serena, le seul survivant des quatre évêques du Chili. Il nous fait bon accueil, mais il est complètement sourd, et il faut recourir à l'ardoise pour lui parler. Pour répondre, il relève la voix d'une manière pénible. Il aurait voulu aller consulter quelques spécialistes en Europe, mais le gouvernement l'en a empêché, en lui imposant des conditions humiliantes. Il nous remet le décret qu'il vient de publier pour exécrer les cimetières laïcisés de son diocèse. On ne pourra plus y faire aucune cérémonie religieuse.
Nous prenons congé de Monseigneur, et en traversant la place, nous voyons défiler le bataillon de la garde nationale, musique en tête. C'est dimanche, les magasins sont fermés; le matin, on va à la messe, mais l'après-midi les vêpres sont remplacées par l'exercice militaire. Il n'y a pas de conscription au Chili; les enrôlements sont volontaires. Lorsque le besoin presse, ils se font un peu comme en Angleterre. Les enrôleurs reçoivent tant par homme, et emploient une partie de leur gain à enivrer les candidats pour leur faire signer l'engagement. Ceux-ci, après avoir cuvé leur vin, sont tout étonnés de se réveiller à la caserne; mais, s'il n'y a pas de conscription, par contre, tout homme valide doit porter les armes, et fait partie de la garde nationale.
(p. 318) À l'hôpital, les Sœurs de Charité soignent une centaine de malades et donnent l'instruction à 40 élèves internes qui paient 50 fr. par mois. À six heures, nous sommes à la gare, et montons dans un wagon américain; à six heures trois quarts nous rentrons au port de Coquimbo, et à sept heures à bord. Quelques passagers, pour tuer le temps, avaient abusé du Champagne, et ils abusent de la parole. Un peu de sommeil les guérira.
La nuit a été plus calme; le matin, à sept heures et demie, le canon annonce que nous arrivons à Huasco, et le navire y jette l'ancre. On fait grande profusion du canon: son bruit se fait sentir à chaque port; or, nous touchons à treize dans le trajet de Valparaiso au Callao, et mettons ainsi dix jours à parcourir un espace de 1,500 milles, qu'on franchirait aisément en quatre ou cinq jours, si l'on suivait directement. La côte est toujours aride, mais l'embouchure de la rivière le Huasco laisse voir un tapis de verdure entouré de forêts d'eucalyptus. Cet arbre, importé d'Australie, est devenu ici à la mode. On l'a planté et on le plante partout; son bois sert, dans ces contrées minières, à étayer les galeries. Le Huasco est utilisé pour l'irrigation, et la vallée nourrit de nombreux troupeaux. On y récolte aussi un raisin à gros grains et à peau tendre qu'on fait sécher et qu'on vend dans des petites boîtes sous le nom de pasas; une vingtaine de filles sont venues à bord et nous poursuivent aux cris de pasas caballero!
Le port de Huasco a été construit le deuxième après la (p. 319) conquête. Il n'a pas progressé, on n'y voit que quelques petites maisons de bois ou de boue. La plupart des toitures, ici comme sur le reste de la côte, vers le nord, sont en terre. L'eau les fond difficilement, parce qu'on les enduit d'une couche de mortier, composé de sable et de chaux de coquillages. À côté du village, on voit quatre cheminées qui indiquent la présence d'une usine, fonderie de cuivre, abandonnée depuis longtemps. Le minerai, qu'on extrait de l'autre côté de la montagne, arrive par une autre vallée plus facilement au port de Pegna-Blanca. Ces mines, qu'on me dit appartenir à M. Dickenson Benett Montt, donnent 25,000 quintaux de cuivre net par an.
À dix heures, le navire a déchargé la farine et la bière destinées à Huasco, et nous suivons notre route.
À deux heures, le canon nous annonce un nouvel arrêt; nous sommes à Carrizal-Bajo, et nous n'en repartirons qu'à la nuit.
Nous pouvons donc aller visiter les fonderies de cuivre dont nous voyons fumer les hautes cheminées; une d'elles, en effet, a 134 pieds de haut. M. Aniceto Yzaga est parmi les passagers: il se rend à son établissement des mines de Chañarcitos, à six lieues de la côte; il connaît donc à merveille choses et gens de ces lieux, et s'offre à être mon cicérone. MM. Casanova et Martinez veulent bien être de la partie, et nous montons dans une petite barque. Ce n'est pas sans peine, car les vagues sont hautes, et comme à Jaffa, il faut saisir le moment propice. Nous (p. 320) arrivons à un môle prolongé sur poutrelles en bois; un insecte, qui aime à vivre dans la mer, les a littéralement rongées à fleur d'eau, et on a dû les doubler de fer. À terre, M. Yzaga nous présente aux directeurs de la fonderie Gibbs and Cy, qui travaillent le minerai de cuivre, amené des mines de Cerro-Blanco, à quelques lieues d'ici. Ces messieurs nous font visiter l'usine. Il n'y a que deux fours, mais ils sont hermétiquement fermés, et la même chaleur qui fond le minerai, par une habile combinaison, sert aussi à calciner le minerai plus fin, opération nécessaire avant la fonte. Puis, par divers conduits souterrains, le calorique va opérer la concentration de l'eau de mer pour la transformer en eau douce. L'eau manque en effet ici: il ne pleut presque jamais sur cette partie de la côte, et l'eau qu'on amène par le chemin de fer se vend quatre sous l'aroba. Les deux fours fondent ensemble 40 tonnes de minerai par jour. Le minerai plus gros est calciné à part dans des compartiments spéciaux, où il brûle par lui-même durant 28 à 30 jours. Il contient, en effet, 45% de souffre, de l'antimoine et 10 marcs d'argent par cajones de 64 quintaux métriques. Ce minerai, après la calcination et la fonte, perd le souffre, et donne un minerai nouveau appelé mates, et dans le pays eges de cobre, et contient 50% de cuivre, de l'argent et de l'antimoine. Il est ainsi transporté en Angleterre, où l'usine Charles Lambert, à Swansea, fait les dernières opérations pour séparer les trois métaux. Le charbon est pris en Angleterre, et mélangé avec partie de charbon de (p. 321) Lota. On paie ici ce dernier 10 pesos la tonne, le charbon anglais 33 schellings. Cent ouvriers sont employés' à l'usine; ils reçoivent de 3 à 4 fr. par jour; leur logement, comme presque tous ceux du peuple, au Chili, se compose d'une seule pièce pour toute la famille. C'est trop peu pour l'hygiène et la moralité. Les directeurs se proposent de l'améliorer. La charbonnière m'a paru fort ingénieuse pour éviter la main-d'œuvre. Les grues prennent le charbon au navire et le jettent dans un vaste compartiment de bois dont le pavé est à plan incliné, et surélevé de terre d'environ deux mètres. Au centre un chemin de fer conduit les wagonnets sous la charbonnière, et on n'a qu'à ouvrir des trappes pour qu'ils se remplissent seuls: exactement le même système que celui des elevators de Chicago pour le maniement des blés. Ainsi, la seule force de gravité fait le travail de centaines de bras; il est bon de mettre à profit les forces de la nature. Il restera toujours bien du travail pour les bras; le difficile est de ménager les transitions.
Les directeurs me munissent de beaux spécimens de métal, nous réchauffent avec le Xérès et nous rafraîchissent avec de la bière; puis nous visitons le village, qui compte 1,200 habitants. Il a été plus peuplé autrefois, lorsque les mines donnaient plus de produits et plus de travail. Les mines sont et seront toujours une loterie. Les maisons sont en bois; on peut ainsi les démolir et les transporter lorsqu'une plus grande production de nouvelles mines appelle la population ailleurs.
(p. 322) M. Yzaga nous conduit à la Maestranza (ateliers du chemin de fer); les tours, les rabots, les laminoirs travaillent le fer comme s'il était de bois. À côté, un vaste magasin contient tous les approvisionnements nécessaires aux machines; et, un peu plus loin, on voit une usine pour fondre le plomb argentifère. À la plage, nous recueillons diverses herbes marines qu'ici on mange comme au Japon, et nous retournons à bord pour le dîner.
Le soir, M. Robertson, agent de la Compagnie minière, tient la guitare et joue à merveille, en accompagnant de sa voix la plus belle samo-cueca du pays. Le capitaine donne l'exemple, et immédiatement on organise cette danse moresque que j'ai déjà décrite en parlant de mon séjour en Araucanie. Les assistants battent des mains en cadence pour aider à l'animation de la musique; et les gens du pays sont étonnés de voir et d'entendre des gringos exécuter si bien leur musique et leur danse. M. Robertson nous chante aussi avec bonne expression plusieurs des chansons locales. Ce sont des amourettes, des chants de départ, des demandes en mariage; toutes gracieuses et morales. Je regrette de n'avoir pu retenir plusieurs strophes qui m'ont parues remarquables de poésie et de sentiment. Dans une, le jeune homme, avec beaucoup de compliments, s'adresse à une jeune fille, et lui demande sa main. Celle-ci le toise et lui dit: Votre tenue n'est pas complète, vos gains insuffisants. C'est en vain que vous pensez à vous marier: il vous faut avant acquérir plus d'ordre et plus d'amour pour le travail. (p. 323) Vous perdrez donc votre peine en vous adressant à mon père, il sait que le mari doit être un modèle d'application et de vertu. Dans une autre, l'amant part pour la guerre, et les adieux à sa belle sont pleins de nobles aspirations. Voici à peu près le refrain: «La patrie m'appelle, je ne puis être sourd. Ton souvenir me suit, je ne peux vivre sans toi, je reviendrai, je reviendrai plein d'amour et d'honneur, je serai toujours digne de toi.»
Chez tous les peuples, la poésie et la musique ont toujours été un grand moyen pour exprimer les sentiments de l'âme. Un peuple qui sait encore les retracer d'une manière si digne prouve qu'il a en lui des éléments sérieux de solidité. Par contre, les peuples qui abaissent la poésie et la musique pour en faire des instruments de vains plaisirs ou de corruption sont sur la voie de la décadence. À neuf heures, M. Robertson nous quitte, et le navire se met en marche.
14 août.—À sept heures du matin, nous jetons l'ancre dans le port de Caldera. Plusieurs navires viennent y chercher le minerai de Capiapò et des environs, car nous sommes ici dans un des principaux districts miniers du Chili. À terre, nous ne voyons que du sable, et, par-ci par-là, quelques petits buissons. C'est le Sahara ou un des déserts de l'Égypte: c'est ici, en effet, que commence proprement le désert d'Atacama. L'eau féconderait ce sable, mais on peut dire qu'il ne pleut jamais dans ces contrées, et on distille l'eau de la mer pour le service des habitants de la côte. Toutefois, si la nature n'a pas (p. 324) donné la beauté à ces sites, elle leur a prodigué la richesse dans ses minerais d'or, d'argent, de cuivre, de charbon, de borax, de salpêtre et de guano. Comme une bonne mère, la nature ne donne jamais tout à tous, et partage ses dons; le paon a reçu la plus belle toilette et la plus laide voix; le rossignol, le moins bien vêtu des oiseaux, donne les sons les plus harmonieux.
La petite ville de Caldera compte environ 2,000 habitants. Elle est un peu en décadence en ce moment, parce que la plupart des mines ont des filons moins riches et donnent peu de dividendes. La place est identique à celle des autres villes chiliennes, les rues sont larges, les maisons en bois, l'église gracieuse. J'y vois une statue de la madone du Carme, au pied de laquelle s'élève un trophée de drapeaux, armes et tambours; c'est la patronne des armées du pays. Les Chiliens aiment à lui rapporter leurs succès et leurs victoires. Vers la plage s'élève la Maestranza, nom qu'on donne ici aux ateliers de réparation et construction de machines, et du matériel de chemins de fer. Ils sont plus importants que les ateliers de Carrizal-Bajo, que nous avons vus hier. Ce chemin de fer a été le premier construit dans le Chili, et date de 1852. La plupart des actionnaires sont en Angleterre, quelques-uns à Capiapò. Depuis son installation jusqu'à ce jour, il a transporté plus de 2,000,000 de quintaux métriques de charbon, plus de 2,000,000 1/2 de minerai, et autant d'autres marchandises diverses, ce qui, avec le matériel du chemin de fer et autres, forme un total de presque un (p. 325) milliard de quintaux métriques. Il a en outre transporté 650,000 passagers. Son coût a été de 1,600,000 piastres; les frais d'exploitation se sont élevés, durant les trente ans, à 7,400,000 piastres, mais le produit a été de 18,300,000 piastres, laissant ainsi un bénéfice net d'environ 11,000,000 de piastres; soit environ 50,000,000 de francs. Ce chemin de fer conduit en deux heures à Capiapò; et un peu plus haut, à Païpote, il se divise en deux branches: l'une va à Puquios, et reçoit le borax qui vient par charrettes des dépôts de Quebrada, au pied des Andes. Il porte aussi le minerai d'or de Cachiyuyo, de cuivre de Puquios et ciel Chulo, de charbon de Sierra de la Ternera, et le minerai d'argent des mines de Garin. L'autre branche va à Pabellon, prenant les minerais de cuivre de Ojancas et de Lirios, et le minerai d'argent de Pampa-larga, de Cabeza de Vaca et del Romanero. À Potrero Seco, il se divise encore en deux branches; l'une va à San-Antonio et reçoit des minerais d'argent des mines de Lomas Bayas, de los Bardos, et del Sacramento; l'autre va à Godoy, et dessert les mines d'argent de Chañacillo de Pajonales et de plomb de Baudurrias. Son étendue est d'environ 250 kilomètres, et partant de la mer à Caldera, il atteint à Puquios l'altitude de 1,400 mètres.
M. Walker nous conduit chez son frère, qui dirige ici la seule usine de borax existant au Chili. Cette matière s'emploie pour la fabrication du verre et de la porcelaine. On vient de trouver le moyen de s'en servir pour la conservation des viandes, et on l'utilise encore pour la fonte des (p. 326) minerais précieux, d'or et d'argent. Ce minerai est très rare; on ne l'obtient qu'en Toscane, en condensant les vapeurs d'acide borique, et dans la mer de Marmara, où l'on trouve le tinkal ou borax de soude. Les gisements qui fournissent le borax à l'usine Walker sont à plus de 200 kilomètres, à Quebrada, au pied des Andes, et ont une épaisseur qui varie de six pouces à un mètre. Les pierres blanches et légères, portées à l'usine, sont broyées sous la meule et placées dans de grandes cuves, par quantité de 30 à 40 quintaux métriques par cuve; là le borax bout 2 à 3 heures dans un mélange d'eau mère et d'acide sulfurique, puis on laisse reposer une heure pour que les parties impures se déposent au fond. Le borax s'en va alors par des canaux dans 12 grands réservoirs, où il se cristallise, et on le retire pour le sécher au soleil. On le met alors en caisses et on l'expédie à Liverpool, où il se paie de 60 à 65 livres sterling la tonne, selon qu'il contient plus ou moins de 83% d'acide borique. Chaque réservoir donne une moyenne de 2 tonnes. L'usine produit 1,000 tonnes par an. L'acide sulfurique, qu'on emploie jusqu'à concurrence de 1,000 kilogrammes par jour, est aussi produit: dans l'établissement. Dans de grands réservoirs de plomb, on introduit le gaz sulfureux produit dans des fours par la crémation de minerais de cuivre et de fer sulfureux. On mélange avec l'acide nitrique, produit du nitrate de soude, et ces deux gaz, mélangés à la vapeur d'eau, donnent le gaz sulfurique.
M. Walker nous présente à sa jeune femme, qui arrive (p. 327) entourée de ses nombreux enfants, puis nous fait remarquer dans la cour de son habitation de nombreuses plantes d'agrément, véritable luxe dans ce pays de sable. Dans une seconde cour nous voyons une vigogne, espèce de huanaco, mais plus petit. Elle est apprivoisée et se laisse volontiers caresser. Je remarque deux magnifiques mules. Celle-ci, me dit M. Walker, m'a porté plusieurs fois en 20 jours au-delà du désert, et est restée jusqu'à trois jours sans boire. Or, je pèse 104 kilogrammes. À toute exposition, cette bête mériterait certainement un premier prix. Après la visite de l'établissement, nous aurions voulu visiter à côté une fonderie de plomb argentifère, mais le temps presse. Mme Walker nous invite à prendre place à sa table: elle nous sert gracieusement un copieux déjeuner, puis nous montons sur un wagon primitif qui nous conduit à la plage, et nous revenons à notre bateau. Le soir, à cinq heures et demie, le canon nous dit encore que nous touchons à un autre port. C'est celui de Chañaral, en tout semblable aux précédents. Quelques maisons de bois sur des rochers nus et quelques cheminées fumantes indiquent la présence de fonderies. Le navire charge et décharge et repart à huit heures du soir.[Table des matières]
Le 15 août à Tantal. — L'Église et le Pasteur. — La Marseillaise au désert. — Encore l'Aconuagua. — Antofogasta. — Le salpêtre. — L'iode. — La Société Beneficiadora de metales. — Le salaire. — Le guano. — La laguna d'Acostan. — Encore l'incendie de l'église de la Compañia. — Épisodes émouvants. — Capture de Huescar. — Les marsouins. — Iquique. — Les incendies. — Combat naval. — L'eau distillée. — Le vicaire ecclésiastique. — L'école. — La prison. — Prix divers. — Pisagua. — Arica. — Les effets de la guerre. — Un tremblement de mer. — La Bolivie. — Tacna. — La Pax. — La corvette Le Camus. — Mollendo et le chemin de fer do Pisco. — Les îles de Chinca. — Une lettre de Pascal Duprat à propos de Voltaire. — Réponse du député Don Ambrosio Montt.
Le matin du 15 août, à six heures et demie, notre steamer jette l'ancre à Tantal. L'aspect est toujours le même: rochers nus percés de quelques trous de mine, aucune végétation; c'est le vrai désert. Don Mariano Casanova nous rappelle que l'Assomption est fête de précepte, et nous invite à le suivre pour la messe. Nous cherchons l'église, et nous trouvons une pauvre cabane de bois avec un presbytère encore plus pauvre. Le curé nous reçoit dans sa meilleure chambre. Peu de meubles, mais plusieurs livres qui indiquent l'homme d'études: Donoso Cortès, Gaume, La cité de Dieu, etc. L'Église est vraiment une bonne mère. À peine se forme un groupe de population, qu'elle établit auprès d'elle un homme pour en (p. 330) avoir soin et lui enseigner la vérité. Elle lui défend même d'avoir une famille, afin qu'il puisse mieux se consacrer à l'instruction des enfants, aux soins des infirmes, au bien de toutes les familles. C'est le véritable pasteur, et s'il sait être encore le bon pasteur, son troupeau ne manquera pas de bien-être. Pour la commodité de ses paroissiens, le curé de Tantal célèbre deux messes, une à huit heures, l'autre à dix heures. Mais le sexe dévot est sans contredit le plus nombreux. Après la messe nous déjeunons à l'hôtel de la Bolsa, tenu par un Français. Nous passons devant une baraque de planches, et je lis sur l'affiche: Teatro, Jueves 16, la Marsellesa. Théâtre, jeudi 16, la Marseillaise. Nous laissons de côté deux distilleries d'eau de mer, qui alimentent d'eau douce la population, et en retournant au bateau nous passons devant l'Aconcagua, qui est ici en chargement. Ses officiers, sur le pont, reconnaissent le voyageur du détroit de Magellan, et nous nous saluons avec bonheur. Ils avaient été si gais et si bons durant le trajet! Le reste de la journée sera pour la rédaction et pour le repos.
Jeudi 16 août.—À six heures et demie, le navire stoppe à Antofagasta, et bientôt nous allons à terre. Don Mariano continue à souffrir du gosier et décide de s'arrêter ici. MM. Walker Martinez s'y arrêtent aussi pour se rendre dans l'intérieur inspecter des mines dans lesquelles ils ont des intérêts; mais avant de nous quitter ils redoublent d'égards, et veulent me faire connaître les deux établissements importants d'Antofagasta. Ils me (p. 331) présentent à M. Eugène de Rurange, Français qui dirige l'exploitation des Barateras de Ascotan, à 8 lieues vers les Andes, et nous passons à l'établissement de salpêtre, le plus important du monde en son genre. Il occupe 800 ouvriers à l'usine et autant au lieu d'extraction. Nous sommes ici dans l'établissement qui a été cause de la guerre entre le Chili et la Bolivie et son allié le Pérou. M. l'avocat Walker Martinez m'explique que c'est lui-même qui, en 1875, en sa qualité de ministre du Chili, à la Pax, a rédigé et signé avec M. Baptista, représentant de la Bolivie, le traité en vertu duquel le Chili renonçait à ses prétentions sur le territoire d'Antofagasta en faveur de la Bolivie. En retour, celle-ci s'engageait à ne jamais frapper d'aucun droit les produits de salpêtre et autres minéraux exploités sur le territoire contesté. Or, la Bolivie ayant voulu plus tard imposer un droit de dix sous par quintal à l'exportation, il s'en est suivi la guerre.
Le minerai appelé salitre par les indigènes, salpêtre par les Français, et nitrate par les Anglais, est amené par chemin de fer de la Pampa centrale à 150 kilomètres vers les Andes. La Compagnie anonyme des salitres i ferro Carril d'Antofagasta, au capital de 5,000,000 de pesos, possède là une surface de 23 hectares, où le salpêtre se trouve par couches de 1 à 2 pieds d'épaisseur. À l'usine, les pierres passent dans une machine à broyer, et sous des cylindres qui la pulvérisent. Cette poudre est élevée par une courroie à godets à une hauteur de 15 mètres, d'où elle tombe dans des chaudières. Là, par l'eau chaude (p. 332) et par la vapeur d'eau, elle se fond, et après 4 à 6 heures de cuisson, elle s'en va dans 280 réservoirs de fer, où elle se cristallise et est mise à sécher sur des plates-formes. Le directeur, M. Évariste Soublette, qui nous guide, nous montre aussi les produits d'iode qu'on obtient à l'usine. L'iode vient solidifié, en forme d'iodure de cuivre, et on en fait ici 200 quintaux par mois. Il est vendu à Londres au prix de 4 pence l'once, et sert pour la médecine, pour la photographie et comme fondant en diverses industries. Le salpêtre produit à l'usine atteint 3,000 quintaux métriques par jour, et on l'exporte aussi à Londres, où il se paie environ 10 fr. le quintal. Il sert pour engrais, pour la fonte du fer et de la porcelaine, et pour faire la poudre à canon. L'usine donne aux actionnaires un dividende de 10 à 15% l'an. M. Juan Walker m'accompagne à l'usine de la Société anonyme Beneficiadora de metales au capital de 2,000,000 de pesos, dont il est actionnaire. Le gérant, M. Telesforo Mandiola, se fait notre cicérone, et nous montre le minerai d'argent venant d'un peu partout, mais surtout des mines de Caracoles en Bolivie, à 35 lieues de la côte. Ce minerai est amené sous des meules en fer perpendiculaires qui le broyent dans l'eau et l'envoient dans des réservoirs, où il se convertit en pâte terreuse jaune. Cette pâte, étendue au soleil, sèche, puis est passée sous une autre machine, qui la réduit en poussière, et dans cet état on la met dans 24 grands cylindres, par poids de 40 quintaux chaque. On ajoute des agents chimiques, du sel, du cuivre, du fer, du zinc et de l'eau, et de 4 à 8 quintaux (p. 333) de mercure, suivant le métal. Après une cuisson qui varie de 4 à 12 heures, la pulpe qui en résulte est amenée avec de l'eau froide dans des réservoirs cylindriques, où l'argent et le mercure se séparent des matières terreuses, et le minerai est mis à écouler. Le mercure tombe à travers un linge, et l'amalgame qui reste contient un sixième d'argent. On le presse alors dans des moules cylindriques, et on le place pendant 10 heures dans des fours, où le mercure s'évapore et va se condenser ailleurs. Le résidu forme un minerai d'argent appelé pigna dans le pays, et pour dernière opération on le place durant 2 à 3 heures dans un four, où il fond, et on le coule dans des moules, en lingots de 70 kilogrammes chaque. Il est ainsi expédié en Angleterre, où on le vend en ce moment 46 pesos[4] le kilogramme. L'usine emploie environ 200 ouvriers, à raison de 1 1/2, 2 et 3 pesos. La main-d'œuvre est plus chère ici, parce que le désert ne donne rien, et il faut tirer de loin par bateau tout le nécessaire à la vie. Le moteur est de la force de 100 chevaux, système américain exécuté à Glascow. Toute la vapeur employée pour les diverses opérations est concentrée par de nombreux tubes immergés dans un réservoir, et se transforme ainsi en eau douce pour la boisson et autres usages de la vie. On la vend ici 5 sous les 30 litres, et il n'y en a pas d'autre, soit pour les habitants, soit pour les nombreux voiliers qui viennent chercher (p. 334) le minerai. L'usine rétribue le capital par un dividende de 30%. Le mercure est acheté à Valparaiso, en Europe ou en Californie, au prix de 46 pesos le flacon de 34 kilogrammes. On en perd environ un quart du poids d'argent produit dans chaque opération. L'usine, donne de 20 à 30,000 marcs d'argent par mois (le marc équivaut à 230 grammes).
M. Mandiola, qui est en même temps commandant des deux batteries qui gardent le port, nous montre les boulets de 300 et de 150 kilos, envoyés par les canons du Huascar, le fameux monitor des Péruviens. Il y répondait en envoyant par ses 5 canons Armstrong, des boulets de même calibre.
La ville, semblable à Tantal, compte 5 à 6,000 âmes. Les maisons sont des cabanes de bois à toiture légère. Il ne pleut jamais ici. Une vaste église de bois est en construction. Dans la montagne, les soldats ont écrit en lettres blanches colossales: «Soldados Chillenos 8e bataillon, marco 1882,» et les marins ont peint en blanc une grande ancre qu'on voit de la mer.
Nous revenons chez M. de Bourange, qui nous montre un ensemble d'ossements et œufs d'oiseaux, obtenus par lui en tamisant du guano pris au dépôt de Solar del Carmen, à 26 lieues au nord-est d'Antofagasta. Là, sous une couche de 21 pieds de roches, on trouve une couche de 3 pieds de guano. Qui a déposé là cette matière, et de quoi est-elle composée? Les uns disent que ce sont des excréments que les oiseaux aquatiques ont accumulés (p. 335) avec les siècles. D'autres déclarent la chose impossible, et ajoutent que c'est là une composition chimique comme il y en a dans la nature: M. de Bourange me remet un opuscule sur la laguna de Ascotan, d'où la compagnie qu'il dirige retire le borax. Cet ancien lac a 15 lieues de long et 7 de large, et on y trouve plusieurs sources d'eau chaude à 45 degrés. L'épaisseur du borax qui le recouvre varie de 5 à 85 centimètres. D'après les calculs longuement étudiés dans la brochure, on relève que le capital, employé sera rétribué au 100 pour 100, puisque le quintal de borax, qui se vend en Europe 8 à 9 pesos, reviendra à la compagnie à la moitié de ce prix, tous frais compris, jusqu'au lieu de vente.
M. de Bourange me présente sa femme, ses belles-sœurs et ses nombreux enfants, et nous prenons tous place à sa table. Vers le milieu du repas, je porte la santé du Chili et je pars à la hâte, car le capitaine du port me fait dire: Ne perdez pas un instant, on n'attend plus que vous. J'emporte les nombreux spécimens de minerai que m'ont donnés M. Juan Walker et les divers directeurs des usines visitées, et bientôt je suis sur la Serena. Et maintenant, pendant que le bateau suit sa marche, en longeant la côte où sont les dépôts de guano, j'aime à relater ici la conversation que j'ai eue hier au soir avec l'avocat Walker Martinez et dom Mariano, sur l'incendie de l'église de la Compañia à Santiago. Le premier était présent, le second a été chargé de faire l'enquête, et a dû entendre des centaines de témoins oculaires. (p. 336) L'église était richement, mais imprudemment parée. Un ensemble de lampes à pétrole au maître-autel ont causé le premier feu, et brûlé l'autel. Alors la foule s'est précipitée par les 5 grandes portes, 3 sur la façade et 2 latérales, qui étaient non fermées, mais grandes ouvertes. La poussée a été telle, que les premiers sortants, précipités à terre, ont arrêté les autres qui se sont amoncelés, formant une muraille humaine de 1 mètre 1/2 de haut. M. Martinez, pour essayer de tirer au-dessus de cette muraille quelques-unes des femmes qui, l'appelant par son nom, le suppliaient de les aider, jeta avec quelques autres jeunes gens des lazos pour qu'elles pussent s'y accrocher, mais les flammes brûlaient les lazos. Ils coupèrent alors de petits arbres, près de là, et les tendirent aux malheureuses, mais celles qui purent les saisir ne purent quand même se sauver, parce que leurs compagnes, dans l'espoir de les suivre, s'accrochaient à elles.
Par contre, tous ceux qui, dans le commencement, se dirigeaient vers la porte de la sacristie, sortirent sans peine, parce que de ce côté, à cause du feu au maître-autel, la foule ne se pressait pas.
L'édifice fut consumé en très peu de temps, le plafond était en bois peint, ainsi que la vaste coupole, et il s'était formé par elle un grand courant d'air comme par une cheminée. Les deux tours servant de clochers ne tardèrent pas, elles aussi, à s'écrouler. Dom Mariano ajoute que, d'après l'enquête, le nombre des morts s'est élevé à (p. 337) 1,870, la plupart femmes, et appartenant à la haute société; il n'y eut presque pas de famille à Santiago qui ne fut en deuil. Tous affirment que les récits répandus, dans lesquels on parle de portes fermées, sont complètement faux.
Vers le soir, nous passons près la pointe d'Angamos Mejillones, où fut pris le Huascar par deux frégates chiliennes, après la mort de son commandant. Près de là sont de nombreux dépôts de guano, et le gouvernement chilien vient d'en vendre un million de tonnes à une maison française.
Une multitude de marsouins suit le navire en faisant d'énormes sauts hors de l'eau; c'est leur samo-cueca. Après le dîner, on danse encore bien avant dans la soirée.
17 Août.—À huit heures, nous stoppons à Iquique, chef-lieu de la province de Tarapacà. Elle appartenait au Pérou, mais le Chili la détient et ne la lâchera pas. Iquique est maintenant le second port après Valparaiso, et sert d'entrepôt au salpêtre qui vient de l'intérieur. Le gouvernement chilien a relevé les droits à l'exportation; on paie maintenant 1 peso 60 centavos par quintal de salpêtre exporté (de 7 à 8 fr.), ce qui donne au trésor un revenu de 8 à 10,000,000 de pesos par an. La ville d'Iquique contient 14,000 habitants, avec intendant et Cour d'appel. Une trentaine de navires sont dans le port pour charger le salpêtre: on m'en montre un en fer qui a brûlé dernièrement. La moitié de la ville est en reconstruction. (p. 338) Le mois dernier, elle a brûlé pour la troisième fois en deux ans, et les compagnies n'assurent maintenant contre l'incendie que moyennant une prime de 5%. Toutes les maisons sont en bois, et couvertes en forme de terrasse, car il ne pleut jamais. Dans la reconstruction on laisse des rues larges de 20 mètres, pour diminuer la propagation du feu.
Avec le ciment importé, le sable et les petites pierres qui forment ce désert, il serait facile de bâtir des maisons incombustibles.
C'est à Iquique qu'eut lieu le fameux combat entre le Huascar et l'Indipendencia d'une part, et l'Esmeralda et la Covadanga d'autre part: deux petits navires chiliens contre deux plus grands péruviens. Le commandant de l'Esmeralda préféra couler plutôt que de se rendre. Sur la place, un monument en bois porte au centre le buste de ce héros chilien avec cette inscription:
ARTURO PRATT
EL PUEPLO DE IQUIQUE
A LOS HEROES DEL 21 DE MAYO DE 1879.
Arturo Pratt
Le peuple de Iquique
Aux héros du 21 mai 1879.
Sur le piédestal, on lit une soixantaine de noms des personnes qui ont péri avec lui. En ville, je vois trois banques, des magasins bien garnis, et entre autres, un magasin chinois, tenu par deux cinos vêtus à l'européenne et vendant les thés, vases, laques, broderies et autres marchandises de leur pays. Le marché est bien garni (p. 339) de toutes sortes de fruits et légumes venant du nord et du sud, car il ne pousse pas un seul brin d'herbe ici, et on n'a d'autre eau que l'eau de mer distillée. Un chemin de fer conduit dans l'intérieur, aux nombreuses salpêtrières, et les ateliers de réparation et construction de machines sont assez complets.
Dom Mariano Casanova m'avait recommandé de saluer en son nom le vicaire ecclésiastique, M. Camilo Ortuzar; il m'accueille avec bonté, et nous montons en voiture pour aller voir l'école récemment construite. C'est la première que je vois en ce genre. Au centre, une vaste salle ou rotonde surmontée d'une coupole sert à réunir les 300 élèves pour l'instruction religieuse. Vers le sud se détachent en rayons 4 grandes salles, formant 4 classes entièrement ouvertes sur la rotonde, en sorte que l'œil embrasse tous les élèves à la fois. Vers le nord, rayonnent 4 autres corps de bâtiment, qui sont les maisons des professeurs et de leur famille. Autour de la rotonde, à l'étage supérieur, on réunit un musée d'histoire naturelle. Les espaces entre les bâtiments forment des cours couvertes en roseaux pour tamiser les rayons du soleil. Les élèves arrivent à huit heures du matin et vont déjeuner à onze heures. Ils retournent à midi et sortent à quatre heures. Ainsi six heures de travail par jour, car à chaque heure, le travail est interrompu par dix minutes de récréation dans les cours. Système excellent, car l'attention de l'enfant ne peut se soutenir longtemps, et lorsque son esprit est fatigué, il ne peut s'appliquer. (p. 340) Une cour est réservée aux bains alimentés par l'eau de mer, et les élèves, en été, en usent tous les jours.
Nous passons à un autre établissement, lui aussi tout neuf. C'est la prison de la province, renfermant en ce moment 82 prisonniers. La construction est en tôle de fer galvanisé à double paroi. L'espace entre les parois est rempli de coquillages dont le pays abonde, en sorte que, si les prisonniers venaient à enlever une plaque de fer, le bruit que feraient les coquillages en tombant avertirait les surveillants.
Le plan de la construction est semblable à celui de l'école. Un octogone au centre, d'où rayonnent 4 salles et 4 cours fermées avec portes grillées; ainsi un seul surveillant au centre a tout son monde sous les yeux. Un compartiment est réservé aux femmes, un a des cellules pour les malfaiteurs plus dangereux, ou pour ceux que le juge d'instruction veut mettre au secret: les simples prévenus, les condamnés à une courte détention ont aussi leur compartiment. Les condamnés exercent divers métiers, et ont tous deux heures d'école par jour. Le temps de leur prison n'est donc pas perdu, et plusieurs pourront en sortir meilleurs. Le dimanche, un autel est élevé à l'octogone, et tous les prisonniers entendent la messe. Les sentinelles sur le mur de clôture surveillent le toit et correspondent entre elles par un appareil électrique.
Dans la ville, je marchande plusieurs objets, mais tout est très cher. Les moindres photographies coûtent de 5 à 10 fr.; d'une petite corne de bœuf qui sert de verre aux (p. 341) Indiens, on me demande 6 fr., et dans une boutique d'organelli tenue par un Italien, on demande 1,000 fr. pour un méchant petit orgue qui a déjà servi. M. le vicaire ajoute que les loyers sont aussi fort chers, et que pour une maisonnette de 7 pièces, il paie 120 pesos par mois. Les ouvriers gagnent de 10 à 25 fr. par jour; ceux qui chargent les navires gagnent de 40 à 50 fr., mais tout le gain s'en va en boisson. Je lui demande combien le gouvernement paie le clergé: lui, vicaire ecclésiastique, reçoit 3,000 pesos (15,000 fr. l'an), le curé, 2,000 pesos, et le sous-curé, 1,500 pesos.
M. Ortuzar a voyagé en Europe, aux États-Unis et en Palestine; sa mère et 4 de ses frères vivent à Paris. Je l'engage à reconstruire en pierres artificielles et non en bois son église incendiée. Je le quitte à l'embarcadère et retourne au bateau. Le soir nous stoppons à Pisagua. Ce port ressemble à tous ceux que nous avons vus jusqu'ici sur la côte du désert. Il est célèbre par le combat qui a eu lieu en ces derniers temps entre Chiliens et Péruviens. Un monument, au sommet de la ville, est consacré à la mémoire des nombreux braves tombés dans la bataille. Il n'y a point ici de machines à distiller l'eau; un entrepreneur la porte d'Arica dans un petit steamer, et il est devenu très riche en vendant de l'eau. Il en est souvent ainsi pour les monopoles.
18 août.—Le navire reprend sa route à dix heures du soir, et ce matin à huit heures nous stoppons à Arica. C'est ici la porte de la Bolivie: les mules en six jours de marche (p. 342) arrivent à la Pax. On aperçoit au loin les pics blancs de neige, et le soleil, que nous voyons à peine pour la deuxième fois depuis notre départ de Valparaiso, les rend brillants à nos yeux.
Depuis Caldera nous n'avions pas vu un brin d'herbe; ici une rigole d'eau qui descend des Andes laisse voir un peu de verdure et quelques légumes. On me dit même qu'au loin la Vallée contient de magnifiques orangers. Le Puno, navire de la même compagnie, vient d'arriver; à son bord, je trouve, parmi les officiers, un bon jeune homme que j'avais eu pour compagnon de voyage dans l'Aconcagua. On vient d'amputer le bras d'un pauvre marin tombé dans la calle, et on nous le passe pour que nous le déposions à Callao. Ce n'est que par un miracle d'équilibre que ces pauvres marins qui guident la chaîne au chargement et déchargement, ne tombent pas dans la mer ou dans la calle. Si on imposait la compagnie de 100,000 fr. pour chaque homme tombé, ce serait justice, mais alors elle prendrait les mesures nécessaires pour éviter ces accidents.
Arrivé à terre, je vois la ville brûlée: on relève à peine quelques maisons, c'est le fruit de la guerre. En juin 1880, il y eut ici rude bataille et des milliers de morts: on m'assure même que les Péruviens, ayant fait usage de la dynamite, les Chiliens, en représailles, fusillèrent les hommes arrachés à leurs maisons. L'église est en fer, probablement pour mieux résister aux incendies et aux tremblements de terre. Ils sont célèbres ici. En (p. 343) 1868, à la suite d'un tremblement, la mer se souleva et transporta au-delà de la ville un steamer américain. Onze ans plus tard, un autre tremblement a encore soulevé la mer, et le navire, remis à flot, a été jeté à 500 mètres plus loin: on vient de le démonter, il y a trois mois, pour en prendre le fer. Je n'ai encore senti aucun tremblor ici; il paraît qu'ils sont fréquents et peu commodes. Le capitaine du navire me montre une blessure au nez, qu'il a reçue dans un tremblor qui le jeta à terre.
Le seul établissement important d'Arica est la douane et ses vastes entrepôts pour les marchandises qui vont et viennent de Bolivie; mais ils sont presque vides en ce moment. Pour forcer la Bolivie à faire la paix, le Chili a bloqué le port de Mollendo et mis des droits presque prohibitifs, en sorte que la Bolivie trouve plus commode de faire passer ses produits et tirer ses provisions par la République argentine.
Un chemin de fer conduit en deux heures et demie à Tacna, ville de 15,000 âmes, à 13 lieues d'ici: de là les mules vont à la Pax en six jours. Le prix de chaque mule d'ici à la Pax est de 30 à 40 pesos, plus de 100 fr. Il en faut au moins trois: une pour le voyageur, l'autre pour le conducteur, la troisième pour les bagages, en sorte que ce voyage revient assez cher, sans parler de la fatigue, car il faut porter ses provisions de bouche, ses couvertures, et courir le risque d'avoir le soroche, espèce de suffocation qu'on éprouve au point où la route atteint (p. 344) 5,000 mètres d'altitude. La population ici a déjà entièrement changé de physionomie: ce ne sont plus les types chiliens, mélange de Basques et d'Araucans, mais le type péruvien, mélange d'Andalous et d'Incas. On voit même de nombreuses femmes coiffées d'un panama, avec longues tresses noires: c'est le vrai type Incas.
À une heure, pendant que je retourne au navire, le Comus, corvette anglaise, jette l'ancre. Je m'y fais conduire. L'échelle n'étant pas encore descendue, on me tend deux cordes. Peu confiant en mes talents gymnastiques, j'hésite, puis je grimpe bravement. Les officiers me reçoivent avec égard et me font visiter le navire. Son blindage d'acier est de 0m20; il porte 15 canons, 250 hommes d'équipage, déplace 2,300 tonnes; sa machine a 2,300 chevaux vapeur. À trois heures le navire reprend sa marche.
D'après l'indicateur, demain nous devrions stopper à Mollendo.
Un chemin de fer conduit de ce port à Aréquipa en un jour; d'Aréquipa, le même chemin de fer conduit dans les Andes et on arrive, après deux jours, à Puno, au bord du lac Titicaca. Un petit bateau à vapeur traverse le lac en un jour, et, sur la rive bolivienne, une diligence prend les voyageurs et les conduit en deux heures à la Pax.
Aréquipa est encore occupée par Montero, un des nombreux présidents de la République du Pérou, et l'armée chilienne projette une expédition pour aller l'en chasser. Il ne fait pas bon s'aventurer par là dans ces (p. 345) temps de trouble: de nombreux malfaiteurs ajoutent encore leurs forfaits aux malheurs de la guerre. Au reste, comme je l'ai dit, Mollendo est bloqué, et le navire ne s'y arrête pas.
Qu'elle est donc longue, cette navigation sur une côte désolée! Depuis huit jours, nous faisons une vie de grenouille, vivant moitié à terre, moitié sur l'eau.
19 août.—La Bolivie occupant les montagnes de l'intérieur est encore peu connue, sa superficie est évaluée à 1,300,000 kilomètres carrés, et sa population à 2,900,000 habitants, la plupart Indiens. Elle est gouvernée par un président et deux Chambres électives, mais sujette aux troubles intérieurs; maladie commune à la plupart des républiques de l'Amérique du Sud. La langue officielle est l'espagnol, mais deux idiomes indiens, le quicha et le guarani, sont également répandus. Les mines y sont riches et nombreuses, mais inexploitables, faute de route. Notre navire continue à suivre la côte montagneuse et aride. À un certain point, les montagnes deviennent blanches: on les dirait couvertes de neiges; c'est simplement de la cendre lancée, il y a quelques années, par un volcan.
20 août.—Route semblable à celle d'hier. Sur une des montagnes, près de Pisco, nous voyons une immense croix gravée dans la montagne par les Incas, dit-on. Nous voici aux îles de Chincas, quatre petits rochers qui ont fourni des millions de tonnes de guano. Combien d'années et de siècles faudra-t-il aux nombreuses bandes (p. 346) d'oiseaux marins pour les regarnir de nouveau? Voici Pisco; on voit quelques brins de verdure. La vue de la ville, avec son clocher, est pittoresque; mais je n'irai pas à terre: il est tard, et l'on sait qu'il y a la fièvre jaune.
Demain matin, nous serons au Callao. J'ai sous la main un journal de Santiago, le Ferro-carril, du 9 courant. J'y lis une lettre de notre ministre, Pascal Duprat, à un des chefs du libéralisme chilien, Don Ambrosio Montt, à propos de certains de ses discours, que celui-ci lui avait envoyés. Dans sa lettre, M. Duprat fait l'éloge de Voltaire, et déclare qu'il en manque un à l'Amérique. Montt lui répond, par ces paroles: «En vérité, que ferait Voltaire dans notre Amérique? Celle du Nord a son incomparable Washington, et, dans notre Amérique latine, il est à craindre qu'un génie tel que Voltaire détruirait, comme en Europe, non seulement d'odieuses superstitions, mais irait jusqu'à affaiblir et effacer l'idée chrétienne, qui est en même temps le fondement de notre société et le meilleur auxiliaire de nos institutions républicaines, sans fonder en retour une philosophie pour nos penseurs, ni une science pour nos publicistes, ni une religion pour notre peuple.
Je pensais que nos ministres, à l'étranger, étaient chargés de représenter notre pays et de protéger nos intérêts: il paraît que quelques-uns réduisent leur devoir à la propagande des mauvaises idées révolutionnaires; plût à Dieu qu'ils trouvassent partout la réponse de M. Montt![Table des matières]
Le Pérou.
Surface. — Population. — Gouvernement. — Justice. — Les Chinois. — L'instruction. — Le guano et le salpêtre. — La guerre avec le Chili. — Les Incas. — Leurs croyances. — Manco-Ccapec et sa dynastie. — Les lois et usages. — Le Callao. — Le port. — La monnaie. — Les types.
La République du Pérou, située entre le 1° et le 22° latitude sud et le 70° et le 84° longitude ouest du méridien de Paris, a une surface de 2,700,000 kilomètres carrés, plus de 5 fois la surface de la France. La population est de 2,700,000 habitants. À l'est, le Pérou confine au Brésil, avec lequel il est relié par les voies navigables des confluents de l'Amazone; à l'ouest il est baigné par le Pacifique; au nord il a la République de l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade; au sud la Bolivie, à laquelle le relie le chemin de fer d'Aréquipa et Puno. Les chemins de fer actuellement en exploitation s'élèvent à environ 2,500 kilomètres.
Avant la guerre encore pendante avec le Chili, la République du Pérou était gouvernée par un Président élu (p. 348) pour 4 ans. Le pouvoir législatif était confié au Congrès, composé de deux Chambres: le Sénat et les députés. Le pays est divisé en 19 départements, qui nomment chacun 4 sénateurs et 4 suppléants. Les députés sont élus à raison de un pour 30,000 habitants. Les sénateurs doivent avoir 30 ans d'âge et justifier de 1,000[5] soles de rente, les députés doivent avoir au moins 25 ans et 500 soles de revenu. Le pouvoir judiciaire était confié 1o à une Cour suprême siégeant à Lima, et dont les membres, proposés par le Congrès, sont nommés par le Président; 2o à des Cours supérieures siégeant dans les chefs-lieux des départements, et dont les membres, proposés par le Président, sont nommés par la Cour suprême; et 3o à des Cours de 1re instance siégeant dans les chefs-lieux de province, et nommées par la Cour suprême.
Pour les finances, le budget, en 1878, s'élevait à environ 40,000,000 de soles pour l'entrée, et à peu près autant pour la sortie; la dette dépassait un milliard de francs. La religion catholique, apostolique, romaine, est la dominante. Le pays est divisé en 8 diocèses, dont 4 actuellement vacants.
Le climat est divers, selon les zones. Dans la partie connue sous le nom de costa, qui s'étend des Andes au Pacifique, il ne pleut jamais; mais un brouillard presque constant mitigé les rayons du soleil. À Lima, le thermomètre dépasse rarement 29° et descend rarement au-dessous (p. 349) de 16°. Dans la Sierra, ou montagnes, la température varie selon l'altitude; elle est toujours très chaude dans les vallées.
L'agriculture commence à faire quelques progrès, surtout pour la canne à sucre, qui trouve ici un sol privilégié. En effet, la canne produit 2,500 kilogrammes de sucre par hectare de terrain planté, à Cuba, à la Martinique et aux Antilles en général; 5,000 à la Réunion, 6,000 au Brésil pour les plantations d'un an, et 7,500 pour les plantations de 15 mois; mais elle donne 8,000 kilogrammes de sucre par hectare planté au Pérou, ce qui correspond à 80 tonnes de cannes par hectare. L'exportation du sucre du Pérou dépasse déjà 100,000,000 de kilogrammes par an. La main-d'œuvre manquant pour cette culture, on a eu recours aux Chinois, et de 1850 à 1874 on en a importé 87,952, sur lesquels le dixième est mort durant la traversée. Les autres ont été vendus au Callao à peu près comme esclaves, au prix de 300 à 400 soles, avec prétendu engagement de 8 ans. Ils ont été si maltraités que la plupart sont morts, et ceux qui l'ont pu, se sont sauvés. Le Céleste-Empire, informé des faits, avait défendu cette nouvelle traite; mais en 1875 le gouvernement péruvien envoya en Chine un ambassadeur qui réussit à conclure un traité pour le voyage libre des Chinois au Pérou, à condition qu'ils y seraient traités comme les citoyens de toute autre nation. Cela n'empêche pas que les Chinois sont ici mal vus, et qu'ils reçoivent souvent des traitements peu chrétiens; alors ils se révoltent (p. 350) et réussissent parfois à assassiner leurs bourreaux. Par contre, là où on les traite bien, ils se conduisent généralement en braves gens et s'attachent aux intérêts de leur maître. On m'a raconté que, pour leur inspirer de la terreur, dans une ferme, on brûlait leurs cadavres dans un four. On sait que le Chinois croit qu'en mourant sur la terre étrangère, il ressuscitera dans son pays; or la chose; lui paraît impossible si son corps passe par le feu.
Le gouvernement avait aussi fait des efforts pour amener le colon européen, et sur les bords du Chanchamayo, de l'autre côté des Andes, il lui donnait en propriété des terrains, jusqu'à concurrence de 15 hectares par personne, les semences et les bêtes de labour. Cette colonie, souvent détruite par les Indiens qui habitent les forêts voisines, et souvent reprise, semble maintenant, marcher vers un meilleur avenir. Le colon européen ne viendra, sérieusement que le jour où des routes assureront le débouché des produits, et qu'une bonne administration donnera la paix et la sécurité.
L'instruction est primaire, secondaire ou supérieure; celle-ci est donnée par l'université; les deux premières sont gratuites et obligatoires; mais malgré cela, surtout dans les campagnes, la gent illettrée est de beaucoup la majorité.
Le Pérou compte 50 ports sur le Pacifique: 9 majeurs, 10 mineurs et 31 petits havres. Le plus important est celui du Callao, qui embrasse plus de 5 hectares et a coûté près de 10,000,000 de soles. La Société générale, (p. 351) pour le compte de laquelle ce gigantesque travail a été exécuté, a le droit de l'exploiter durant 60 ans selon des prix stipulés.
Les principales villes sont Lima, la capitale, qui, avant la guerre, comptait 180,000 habitants, et le Callao, qui en comptait 30,000. Ces chiffres sont de beaucoup réduits depuis les hostilités. Les Italiens sont une quinzaine de mille.

Pérou.—Capeador à cheval dans les jeux de toros.
La découverte du guano et du salpêtre avait enrichi le Pérou d'une manière extraordinaire et inattendue, et le pays ne sut résister à la richesse. Sauf d'honorables exceptions, le clergé était corrompu, la justice se vendait, le public courait après des jeux malsains, et encore aujourd'hui on le voit se presser dans le cirque pour les sanglants combats de taureaux et de coqs, deux spectacles (p. 352) indignes d'un peuple civilisé. Mais ce n'est pas impunément que les peuples comme les individus provoquent la justice de Dieu. En 1879, une guerre éclate avec le Chili. Le Pérou avait avec la Bolivie un traité d'alliance offensive et défensive; il dut se mettre en campagne. Il avait des hommes, de l'argent, des armes et des navires; il se croyait le plus fort; mais, affaibli par ses divisions, il fut battu sur toute la ligne. L'ennemi occupe aujourd'hui ses meilleures provinces et en perçoit les revenus, qu'il emploie chez lui en travaux publics. En attendant, la division règne encore partout; les uns sont pour Montero, vice-président de la République, qui occupe Aréquipa; les autres pour Caceres, son général; d'autres suivent Garcia Calderon, président prisonnier au Chili, et d'autres Iglesias qui voudraient arriver à la paix. Dans cette situation, le Chili, ne trouvant avec qui traiter, continue à occuper le pays. D'autres disent qu'il n'est pas étranger à ces divisions, et que, puisque l'occupation double ses revenus, il est heureux de la continuer; quelques-uns vont plus loin, et croient que le Chili, voyant s'ouvrir l'isthme de Panama qui le placera au bout du monde, serait heureux de se rapprocher du canal en s'annexant le Pérou. Il compte donc fatiguer le commerce étranger jusqu'à ce que les commerçants eux-mêmes fassent hâter par les puissances un arrangement quelconque, fut-ce même l'annexion. Quant aux Chiliens, ils déclarent que c'est pour le bien du pays qu'ils consentent encore à l'occuper; car, eux partis, il y aurait (p. 353) la Commune; et que, de bonne foi, ils ne poursuivent que l'annexion de la province de Tarapacà et éventuellement d'Arica et Tacna.
Quel que soit le gouvernement qui prendra en main ce pays, il aura beaucoup à faire pour régénérer les mœurs; et le Saint-Siège encore plus de besogne pour ramener le clergé à son devoir. Il est la lumière qui éclaire et le sel qui sale; lorsqu'il manque à ses devoirs, le peuple tombe dans les ténèbres et dans la pourriture.
J'ajouterai maintenant deux mots sur les Incas, qui habitaient le Pérou avant la conquête espagnole. Dès les temps préhistoriques, les deux Amériques étaient peuplées par des tribus multiples plus ou moins civilisées. Au Pérou, ces tribus étaient commandées par des chefs appelés Curacas ou Caciques, et formaient quatre seigneuries. Les Collas ou Aimaraes, qui habitaient le haut plateau de Titicaca; les Huancas, qui occupaient les départements des Aucachs, Junin, Huancavelica, Ayacucho et Cuzco; et les Chincas, qui peuplaient la côte, étaient la plus civilisée. Ils croyaient à un Dieu, pur esprit, créateur de l'Univers, qu'ils appelaient Con.
Le genre humain s'étant révolté contre lui, Con le dépouilla de tous ses dons et convertit les hommes en bêtes féroces. Mais Pachacumac, fils de Con, ayant pris le gouvernement du monde, restaura le genre humain, et les hommes lui bâtirent un grand temple dont on voit encore les grandioses ruines près de Lima.
Ils croyaient à l'immortalité de l'âme, à la récompense (p. 354) des bons, à la punition des méchants et à la résurrection des corps. C'est pourquoi ils mettaient dans le cercueil les vêtements, la nourriture et la monnaie qui devaient servir au ressuscité.
Ils reconnaissaient aussi un esprit du mal, appelé Supay, combattu par Pachacumac.
Vers le milieu du XIe siècle, Manco-Ccapec et sa femme Mama-Oello se dirent fils du soleil, engendrés dans une île du lac Titicaca, et envoyés pour régénérer la terre. Il est plus probable que Manco-Ccapec, fils de Curaca de Gacaritambo, plus intelligent que ses contemporains, aura inventé cette fable pour attirer les populations et accaparer le pouvoir. Quoi qu'il en soit, plusieurs tribus l'acceptèrent pour chef, il leur donna des lois relativement sages, et surtout le bon exemple d'une vie honnête; il réprima les vices au moyen d'un code pénal sévère, et organisa une armée qui lui soumit une grande étendue du pays. Ses successeurs, au nombre de 14, continuèrent la conquête et possédèrent le pays depuis Quito, sous l'équateur, jusqu'à la rivière Maule dans le Chili. Ils le couvrirent de routes et monuments, et par une habile organisation qui divisait le peuple en décades, compagnies et bataillons, ils étaient au courant de tout ce qui se passait et pouvaient réprimer les abus. L'instruction n'était donnée qu'aux nobles et aux chevaliers. Ils divisaient l'année en 12 mois. Les hommes pratiquaient l'extraction des métaux, surtout de l'or, de l'argent et du cuivre, pendant que les femmes faisaient avec la laine de (p. 355) llamas et de huanacos les vêtements pour le peuple, et avec la laine de vicogne et d'alpaca, les vêtements des nobles. La terre était divisée en trois portions: une pour le Soleil ou le culte, l'autre pour l'Inca, la troisième pour le peuple; mais lorsque celui-ci croissait en nombre et n'avait pas assez de terres, on prenait sur les deux premières portions. Il y avait des terres pour les veuves, pour les orphelins, pour les infirmes et pour les soldats sous les armes. Toutes ces terres étaient travaillées par le peuple. Avant tout, on travaillait les terres du Soleil, ensuite celles des veuves et autres empêchés, puis celles du roi, et enfin les autres; on ne pouvait ni les acheter ni les vendre. Elles étaient à la communauté.
Des surintendants, aux époques marquées, sonnaient de grand matin la trompette pour convoquer les cultivateurs, leur donner les semences et leur indiquer les champs de travail. La famille, comme la propriété, fut aussi absorbée par l'État. L'Inca faisait les mariages des nobles, et les magistrats, en province, ceux du peuple. La cérémonie avait lieu une fois l'an: les jeunes filles de 18 à 20 ans se plaçaient en ligne, et vis-à-vis s'alignaient les jeunes gens de 24 à 25 ans. La communauté construisait la maison des époux; ils devaient la garder toujours et ne pouvaient sortir de la condition des ancêtres. La puissance du père était excessive; sa femme était presque son esclave, et ses enfants sa richesse.
Parmi les lois, on distinguait la loi municipale, qui régissait les villages; la loi de communauté, qui marquait les (p. 356) travaux à faire en commun; la loi de fraternité, qui énumérait les conditions d'assistance dans le travail de la terre et construction des maisons; la loi mitachanacuy, qui réglait le travail commun aux villages, provinces et individus; la loi en faveur des invalides, qui ordonnait l'entretien, aux frais de l'État, des aveugles, des boiteux etc.; la loi de l'hospitalité, qui ordonnait de pourvoir aux frais du public, aux besoins des voyageurs, en les logeant dans les bâtiments appelés Corpahuasis; et finalement la loi casera, et la loi économique.
Ils avaient plusieurs maximes pour inculquer la vertu et faire haïr le vice, telles que celles-ci: Aime.—Évite l'oisiveté.—Tu ne mentiras.—Tu ne tueras.—Tu ne commettras adultère.—Tu ne frapperas, etc.
Les lois pénales étaient sévères: l'oisif était flagellé; l'homicide, l'adultère, le voleur, l'incendiaire étaient punis de mort. Les questions civiles étaient réglées par l'Incas et par ses magistrats.

Pérou.—Callao.—Le port et le môle.
La religion avait pour base le culte du soleil, qui avait des armées de prêtres. On en comptait 4,000 dans la seule ville de Cuzco. Ils étaient tous parents de l'Inca, et leurs fonctions étaient à vie. Quand on prenait une nouvelle province, on y bâtissait un temple, et on y envoyait des prêtres. Ils avaient aussi des prêtresses, choisies parmi les plus belles jeunes filles nobles. Elles gardaient la virginité, et comme les vestales, elles conservaient le feu sacré. Elles filaient aussi la laine et tissaient les vêtements du roi et de sa Cour. Il y avait, durant l'année, plusieurs (p. 357) fêtes du soleil.—À chaque lune on sacrifiait 100 llamas de diverses couleurs, selon, le genre d'holocauste. Au commencement de chacune des 4 saisons, on célébrait une grande fête, dont celle de ccapac-raymi, au solstice de décembre, était la plus imposante.
On offrait au soleil, du règne minéral, de petites pierres pointues, de la terre, du cuivre, de l'argent, des pierres précieuses; du règne végétal, du maïs diversement préparé, des arômes qu'on brûlait en holocauste, de la coca, dont la fumée était considérée comme très agréable à la divinité; du règne animal, des llamas et autres animaux, et, en certaines occasions, une ou plusieurs victimes humaines. Au couronnement de l'Inca, on immolait toujours, un enfant, pour obtenir la protection du Ciel sur son gouvernement. On vénérait aussi la lune, sœur du soleil; et, dans certains temples, on rendait des oracles.
Quand l'enfant poussait les premiers cheveux, quand il arrivait à la puberté, au mariage, à la mort, on faisait de grandes cérémonies, bals et orgies. On retrouve encore les monnaies des Incas parfaitement conservées.
Un gouvernement organisé ainsi en communauté, et comme une seule famille, tel que le rêvent encore aujourd'hui certains communards, a pu traverser plusieurs siècles, grâce aux lois morales et paternelles de son fondateur; mais il ne put résister à une poignée d'étrangers. C'est en effet, avec 200 ou 300 hommes, que Pizarro conquit le Pérou, et tua indignement Atahualpa, le dernier des Incas.
(p. 358) Je reviens maintenant à mon journal de voyage.
Le 21 août 1883, à sept heures du matin, le steamer La Serena tire le canon: nous sommes au Callao. Pendant que le capitaine se dispose à entrer dans le dock, je vais à terre, et un des employés de la maison Maron, pour lequel j'avais des lettres, a la bonté de me donner divers renseignements relatifs aux docks dont j'ai parlé. 25 grues mobiles à vapeur chargent et déchargent les navires qui accostent au môle. Les droits sont multiples et considérables; 12 centavos ou sous par tonne de jauge pour le mouillage, 75 centavos par tonne de marchandise, 2 soles et demi par tonne de mesure ou un sol et demi par tonne de poids, et malgré cela la compagnie perd de l'argent tous les jours. Les malheurs de la guerre éloignent les navires et le commerce.
La ville du Callao ressemble assez à une des villes du sud de l'Espagne: rues de 10 mètres, maisons à un étage, balcons grillés ou vitrés en encorbellement.
Le voyageur a encore une fois l'ennui de changer de monnaie. Le peso chilien est remplacé par le sol péruvien, qui vaut en ce moment 4 fr. 20, mais le sol en papier qui, avant la guerre, équivalait au sol argent, ne vaut plus à présent qu'environ 0 fr. 30. On donne 15 sols papier pour 1 sol argent.
Le type péruvien rappelle l'Espagnol du sud, comme le type chilien rappelle celui du nord, mais on rencontre aussi bien des nègres, des Chinois, des Cholos ou Indiens, le tout plus ou moins croisé. Les dames ont parfois (p. 359) un teint absolument blanc, diaphane et incolore. Après avoir parcouru la ville du Callao, je prends le train, qui, dans une demi-heure, me conduit à Lima. Le chemin de fer traverse une plaine arrosée qui serait garnie de villas sans l'insécurité du pays.[Table des matières]
Lima. — L'hôpital français. — Les monuments. — Le Panthéon. — L'hôpital duo de Mayo. — L'hacienda l'Infanta. — La fabrication du sucre. — Les édifices religieux. — Sainte Rose de Lima. — L'Établissement de Bélem, et, les Congrégations françaises. — Excursion à Chicla. — Le chemin de fer transandin. — Un oncle d'Amérique. — Les Indiens et la magie. — Le sorroche. — Retour à Lima. — Payta. — Navigation vers l'Équateur.
La ville de Lima, avec ses nombreux clochers, ses balcons en encorbellement, rappelle le sud de l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi on a tout dernièrement défendu ces sortes de balcons. Ils empêchent le soleil de chauffer directement le mur des appartements, qui demeurent ainsi plus frais. La capitale du Pérou est en ce moment occupée par les troupes chiliennes, et offre l'aspect d'une ville morte. La population, qui était de 180,000 habitants, est en décroissance; le commerce est paralysé, et beaucoup d'étrangers, ne faisant plus leurs affaires, s'en vont. Espérons que tout cela cessera à la conclusion de la paix.
Dans mes nombreuses visites, j'arrive chez le président du club français et de la Chambre de commerce française. M. Jules Fort, avec une extrême amabilité, se fait mon cicérone et me conduit d'abord à l'hôpital (p. 362) français, sorte de maison de santé dirigée par les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Notre colonie ne compte en ce moment qu'environ 500 membres, et la maison qui reçoit gratuitement les Français, reçoit, moyennant 2 soles par jour, les malades des autres nations. Elle est parfaitement tenue et jouit d'un beau jardin. Cette œuvre, qui a coûté à la petite colonie des centaines de mille francs, montre son patriotisme et sa charité: elle a aussi ouvert une école française pour les enfants des deux sexes.
Non loin de là, nous passons devant la Penitenciera et la prison, deux des principaux établissements de Lima, et arrivons au jardin de l'Exposition. C'est là que se trouvaient les belles statues, les vases, les animaux qui maintenant ornent les places et jardins de Santiago et des autres villes du Chili.
Nous parcourons les quartiers du centre, ornés de beaux magasins; mais les marchandises restent sans acheteurs. Le vainqueur a imposé de 10,000 soles les personnes riches du pays; il interdit le retrait de l'argent des banques et la vente des propriétés: tout est paralysé. Il perçoit pour son compte les droits de douane qu'il a doublés, et l'importateur, privé du bénéfice d'un entrepôt, est obligé de payer en argent comptant les droits dans la quinzaine de l'arrivée des marchandises.

Pérou.—Panorama de Lima.—Plaza de Arme.—La cathédrale.
Je passe la soirée chez M. Cabral, ministre de la République argentine. Ce jeune diplomate, récemment marié me présente à sa famille avec la simplicité des anciens temps. La jeune épouse, dans un dîner exquis, veut (p. 363) bien me faire connaître les principaux plats et fruits du Pérou.
Pour se former une idée d'un pays, il ne suffit pas de voir les villes et la vie qu'on y mène: il faut savoir encore comment on cultive la campagne. M. Martinet, gérant de la propriété l'Infanta, une des principales du Pérou, veut bien accepter de me la faire visiter lui-même. Elle est à trois quarts d'heure de chemin de fer de Lima; nous nous donnons rendez-vous à 9 heures à la station; mais auparavant M. Jules Fort et son ami Paul Carriquiry ont la bonté de me conduire au Panthéon. Une voiture nous a bientôt transportés à l'autre bout de la cité, à la ville des morts. Sous une coupole repose un Christ de marbre, vrai chef-d'œuvre d'art. Des compartiments nombreux reçoivent les corps dans de petites voûtes superposées jusqu'à la hauteur de 2 mètres, d'après le système des cimetières d'Italie. L'espace intermédiaire est occupé par de riches monuments qui révèlent l'opulence des temps passés. Je remarque une pauvre chola (Indienne) qui porte sur son sein son enfant mort et vient l'enterrer de ses mains.
Du cimetière, nous passons à l'hôpital due de Mayo; il est affecté en ce moment aux malades de l'armée d'occupation. D'un vaste polygone au centre partent 12 rayons formant 12 grandes salles'; l'espace entre les salles sert de jardins ou promenoirs.—Le tout est enfermé par un bâtiment formant clôture et contenant d'autres salles qui donnent sur un porticat. Ces portiques même sont encombrés (p. 364) de malades en ce moment. Nous y voyons les blessés de la bataille de Huamacuco; de nombreux fiévreux atteints de la typhoïde; beaucoup de malades syphilitiques. 25 Sœurs de Charité françaises ont la direction de l'établissement. Elles dirigent aussi l'hôpital civil, les enfants trouvés, les orphelinats et l'hospice des fous. M. Fort y a conduit dernièrement un jeune Français, empoisonné par une herbe terrible que connaissent les Indiens. Ce poison rend fou d'une folie inguérissable, et ne laisse absolument aucune trace dans l'organisme, en sorte que l'autopsie ne peut le constater.
À 9 heures nous sommes à la station, et vers 10 heures à la hacienda l'Infanta. Elle appartient à MM. Althaus et Tenaud, demeurant en ce moment à Paris. Elle a une surface de 550 hectares, la plupart plantés en canne à sucre. Un magnifique château entouré d'un superbe parc s'offre à nos yeux. La construction est admirablement comprise pour les besoins du pays: un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, grande élévation de plafond; portiques qui empêchent le soleil de chauffer directement les murs, courants d'air partout, eau et bains de toute sorte. Il me semble revoir un des meilleurs et des plus élégants bungalows de l'Indoustan. De la terrasse nous voyons au loin la mer et Callao avec ses navires. Cette terrasse forme toiture; elle est en planches, recouvertes d'une légère couche de terre battue; c'est suffisant pour ce pays, où il ne pleut jamais: aussi n'y ai-je point vu de marchands de parapluies. Un galinasso vautour urubus (p. 365) vient se poser sur le pinacle destiné à l'horloge. M. Martinet le tire avec son revolver. Cet oiseau, qui a la couleur du corbeau et la forme du vautour, abonde dans le pays: il est un peu chargé de la propreté. Dans le parc, les colibris, charmants oiseaux-mouches à mille couleurs, voltigent avec grâce de fleur en fleur; au verger nous voyons le poirier et le pommier à côté du bananier; au potager croissent tous nos légumes d'Europe; un garçon va et vient, criant et faisant du bruit pour éloigner les oiseaux; ces gourmands ont déjà pelé les feuilles des choux, comme l'auraient fait nos chenilles. Au compartiment des animaux, on voit 80 bœufs pour la charrue, des moutons pour le personnel, et de magnifiques chevaux, dont quelques-uns toujours sellés, prêts à partir. Près de là est le compartiment des Chinois: ils sont 200 pour travailler la propriété. On les paie 6 soles papier par jour, plus 2 livres 1/2 de riz. Ils travaillent de 7 heures du matin à 4 heures 1/2 du soir et ont 1 heure 1/2 de repos pour le dîner.
Le dimanche ils ne travaillent qu'en cas d'urgence. Tous ces Chinois sont parqués dans une vaste cour dont les portes sont fermées le soir; ils dorment sur des planches de bois comme les esclaves du Brésil; mais récemment M. Martinet les a autorisés à se faire des maisonnettes séparées, en roseaux et en terre. Le centre de la cour est occupé par un petit temple où ces bons Chinois viennent à leur manière remplir leurs devoirs religieux. Ils ne conservent ni leur queue ni leur costume; (p. 366) ils sont vêtus ici à l'européenne. Lorsqu'ils sont malades, ils passent à l'infirmerie; l'opium les perd ici comme en Chine. Ils n'ont pas de femmes et finiront par s'éteindre. C'est pourtant là une bonne main-d'œuvre qu'on aurait dû mieux ménager. Quelques-uns sont parvenus à établir de beaux magasins où s'étalent les marchandises de Chine. Ils ont, à Lima comme à San-Francisco, un quartier à eux, avec leur théâtre et leur pagode.
L'usine est vaste, bien éclairée, bien aérée. Les machines, qui viennent de la maison Caille de Paris, sont disposées de telle sorte, qu'un seul surveillant a sous les yeux l'ensemble des ouvriers et des opérations.
Un chemin de fer sillonne la propriété, et la locomotive apporte à l'usine les wagons remplis de cannes. Versées sur un tablier sans fin mu par la vapeur, elles arrivent entre les cylindres rayés qui les pressent, elles laissent ainsi tomber leur jus. Ce jus, en passant à travers un filtre métallique, se débarrasse des fibres et autres matières étrangères les plus grossières; puis, par la pression de la vapeur dans un cylindre, il est transporté dans un réservoir élevé, d'où il passe dans certaines chaudières; là, par une mixture de chaux, les autres matières étrangères sont précipitées au fond, et le jus clarifié s'en va dans d'autres chaudières où il perdra l'eau qu'il contient au moyen de l'évaporation. L'écume est aussi travaillée par divers procédés, et rend ce qui lui reste de jus pur. À la suite de toutes ces opérations, le jus, privé de l'eau et des autres matières étrangères, s'en va dans de grands (p. 367) réservoirs et n'a plus besoin que d'être séparé de la mélasse pour laisser le sucre pur. Cette opération se fait au moyen de nombreuses turbines qui font 1,000 tours à la minute. M. Martinet a supprimé la filtration par le noir animal, dont ce jus n'avait pas besoin. Après l'opération, l'usine est lavée; l'eau, amenée dans certains réservoirs, donne ce qu'elle peut contenir encore de matières provenant de la canne, et on en extrait le rhum.
L'usine fabrique de 25 à 30,000 quintaux de sucre par an; la canne produit 10% de sucre, soit 100 kilos de sucre pour une tonne de cannes.
Les ateliers de réparation, menuiserie, forge, etc., sont munis des meilleures machines mues par la vapeur. Un gazomètre distille le charbon pour le gaz à l'usage de la maison, du parc et de l'usine. Le résidu de la canne sert de combustible. Les bureaux sont occupés par trois jeunes gens. Chaque champ a sa comptabilité de doit et avoir. M. Martinet espère que, tous frais déduits, la hacienda donnera encore cette année 200,000 fr. de bénéfice net. Comme administrateur, il a 10% du bénéfice et 12,000 fr. de traitement fixe. Les veilleurs de nuit, qui correspondent au moyen de sifflets, doivent répondre au sifflet du maître. Vient enfin l'heure du déjeuner, que préside la belle-mère du propriétaire. Cette vénérable matrone voudrait bien aller à Paris, mais sans passer la mer.
Après le repas, nous montons à cheval pour parcourir l'hacienda. Ici on coupe la canne, là on laboure, on (p. 368) draine un terrain marécageux; ailleurs on arrose la canne, ou la luzerne, ou le maïs. À un certain point on amène les charretées de canne. Une grue mobile à vapeur, au moyen d'une chaîne, lève d'un seul coup le chargement et le dépose sur les wagons, économisant ainsi la main-d'œuvre de 30 hommes. L'habileté de l'administration et le perfectionnement des moyens sont deux points essentiels pour la bonne réussite dans le rendement d'une hacienda.
M. Martinet, professeur d'agriculture, actif, intelligent, énergique, sait faire rendre des centaines de mille francs à la même propriété, qui en d'autres mains donnerait à peine le montant de la dépense. Il vient d'avoir raison d'une grève de ses Chinois, en renvoyant les meneurs.
Les terres des environs de Lima appartiennent presque toutes à des Communautés religieuses qui les ont données en emphytéose pour une ou plusieurs vies. On appelle vie une période de 50 ans. La redevance annuelle est ordinairement très légère. Ainsi, l'hacienda que nous parcourons ne paie à la Communauté propriétaire qu'un loyer d'environ 25 fr. par mois. Arrivés au bout de la propriété, M. Martinet nous quitte et nous laisse nos chevaux qui dévorent la route, galopant à leur aise dans les cailloux et à travers les fossés. Au bout d'une heure ils nous déposent à Lima.
Nous visitons la cathédrale, dont la façade occupe un des côtés de la plaza de arme ou place centrale. C'est sur cette façade qu'on pendit, il y a quelques années, les (p. 369) deux frères Gouttières, dont un candidat à la Présidence, et, après les y avoir laissés exposés tout le jour, on les brûla sur place. Pour le Pérou, le XIXe siècle n'est pas encore celui de la civilisation!

Pérou.—Rue Valladolid à Lima.
La cathédrale, vaste et bel édifice, renferme les restes de Pizarro, le premier conquérant du Pérou, qui fut assassiné sur la place même. Nous passons à l'église de la Merced et à celle de San-Francisco, qu'on dit la plus belle de Lima. Les sculptures anciennes abondent; les vastes cloîtres sont de toute beauté. Ces immenses couvents, jadis, habités par des centaines de moines, en contiennent aujourd'hui à peine quelques-uns, et la réforme en cette matière n'est ni la moins pressante ni la moins nécessaire. À San-Domingo, autre église très belle, les cloîtres et le monastère sont des habitations royales. C'est dans (p. 370) cette église que priait sainte Rose lorsque lui apparut Notre-Seigneur. Une plaque marque l'endroit où elle se tenait à genoux. On y lit ces paroles de Notre-Seigneur: Rosa de mi corazon, io te querro por mi sposa; et la réponse de Rose: Ve qui esta esclava tuia, o Rey de Eterna majestad, tuia son y tuia saré. On sait que sainte Rose naquit à Lima le 30 avril 1586, qu'elle y vécut tertiaire de Saint-Dominique, et y mourut à l'âge de 31 ans, le 24 août 1617, après avoir édifié tout le pays par la sainteté de sa vie. Elle fut béatifiée le 12 février 1668 par Clément IX, et canonisée par Clément X, le 12 avril 1671.
Voyant que je m'intéressais à ces souvenirs, MM. Fort et Carriquiri me conduisent à l'église de Santa-Rosa, élevée sur l'emplacement de sa maison. On y prêchait, en ce moment, à l'occasion de la neuvaine précédant sa fête, fixée au 31 août. Derrière l'église actuelle, là où on a commencé la construction d'une grande basilique, nous voyons le jardin que Rose aimait à cultiver de sa main. Il est garni de roses et de liserons; sa cellule est enfermée dans des planches, près d'un puits. La tradition rapporte que sainte Rose, après avoir revêtu un cilice fermé à cadenas, en jeta la clef dans ce puits, afin de le porter toute sa vie. Dans la sacristie, on nous montre un tronc d'oranger provenant d'un arbre planté par la sainte; son corps a été récemment enlevé et caché, pour le soustraire à une profanation toujours possible dans les troubles de la guerre.
M. Tremouille, photographe, m'invite à visiter sa collection (p. 371) de raretés indigènes. J'y remarque une belle variété d'échantillons de minerais, de nombreux spécimens de vases et vaisselle indiens. Quelques-uns à sujets aussi lubriques qu'à Pompei. Le plus curieux de la collection sont des os de présidents ou prétendants de la République, brûlés ou assassinés, des cordes de présidents pendus, etc. Cela suffit à donner une idée des mœurs du pays.
Je passe encore la soirée chez M. Cabral et chez, son beau-père, M. de Tizanos Pinto, ministre plénipotentiaire de San-Salvador. Celui-ci me fournit l'occasion de connaître Mgr D. Pedro Garcia, lequel a habité longtemps Rome et l'Europe.
Le 23 août, de grand matin, M. Carriquiry vient me prendre à l'hôtel et me conduit à l'établissement de Bélem, tenu par les Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. L'aumônier, des Pères de Picpus, et la Sœur supérieure nous font parcourir la maison: vastes cours, dortoirs aérés, belles salles d'étude. C'est un établissement de premier ordre qui donne l'instruction à plus de 300 élèves, dont 160 internes et 140 externes, outre une école gratuite. La pension, qui était de 100 fr. par mois, a été réduite de moitié pour aider les parents éprouvés par les malheurs de la guerre. Une autre Congrégation française, celle du Sacré-Cœur, tient aussi à Lima un pensionnat florissant. Ce sont les Congrégations qui, ici comme un peu partout, donnant l'instruction et l'éducation française, font connaître et aimer notre pays.
(p. 372) Après avoir visité Lima, ses principaux établissements et ses environs, je devais pénétrer dans l'intérieur du pays; mais par ces temps de trouble, la chose est peu facile et assez dangereuse. Des bandes de pillards, sous le nom de Montereros (partisans de Montero), parcourent le pays, ravageant tout sur leur passage. D'autre part, les chemins manquent et les moindres distances exigent plusieurs jours de voyage à cheval par des sentiers difficiles. J'aurais voulu faire une visite à la colonie de Chanchamayo, au-delà des Andes. Il y a là plusieurs Français qui s'occupent de la culture de la canne à sucre: celle-ci vient si bien dans cette partie du Pérou, qu'on n'a pas besoin de la replanter. Mais de Chicla, où s'arrête le chemin de fer, jusqu'à Chanchamayo, il y a encore 3 ou 4 jours de cheval. Je renonce donc aux longues excursions pour prendre le bateau du 24. Néanmoins, je ne puis résister au désir de gravir les Andes par le chemin de fer transandin, dit de la Oroya. Le train s'y rend trois fois par semaine; c'est aujourd'hui le jour du départ, mais il ne retourne que le lendemain, trop tard pour atteindre le bateau au Callao. Le directeur, M. Backus, veut bien lever cette difficulté en mettant à ma disposition un homme et un carrito qui, par la seule pente de la voie, me ramènera demain assez de bonne heure. M. Backus pousse l'attention jusqu'à me donner pour conducteur le plus ancien employé de la ligne, M. Georges Devani, un vénérable Savoyard, à figure de saint François de Sales, qui me fera remarquer les points (p. 373) saillants de la route. À 8 heures 1/2 nous sommes dans le train, qui nous emporte rapidement. La voie traverse la ville et suit le Rimac, espèce de Paillon de Nice qui traverse Lima. Le long de la vallée on dérive le peu d'eau d'irrigation qui descend des montagnes. On a, dans ce but, utilisé 3 lacs en déversant les eaux de l'un dans l'autre pour les précipiter dans le Rimac. On peut ainsi arroser des champs de coton et de cannes à sucre.

Pérou.—Chemin de fer de La Oroya.—Pont de Las Verrugas.
À Santa-Clara une importante hacienda, dans le genre de l'Infanta, est la propriété d'un Américain du Nord qui la gère avec l'énergie et l'esprit pratique, propres à sa race. Il sait recueillir de larges bénéfices là où souvent les indigènes perdent de l'argent, faute d'ordre, de méthode, et parce qu'ils se laissent absorber par les dettes, dont les intérêts sont ruineux. Nous voyons même une fabrique de tissus entourée de champs de coton, et quelques briqueteries. Le long de la route abonde le roseau, le lanthana, le poivrier, le figuier, le cactus gigantea qu'on emploie pour combustible, et une espèce de dracœna, qui laisse pousser une tige de 5 mètres ayant la forme d'une asperge colossale. Nous laissons derrière nous, au pied des montagnes, de nombreuses ruines d'anciens villages Incas.
À la station de San-Bartholomeo (4,949 pieds) la voie aborde plus directement la montagne. Les tranchées sont profondes et dans un terrain friable sujet aux éboulements. Les tunnels se succèdent au nombre de 40. Nous passons et repassons le Rimac sur des ponts plus ou (p. 374) moins élevés reposant sur des cages de fer comme dans les railways du nord de l'Espagne. Le plus élevé, celui d'Agua-Verugas, a presque 100 mètres de haut. On le dirait élevé sur d'immenses béquilles. Le torrent qu'il traverse est ainsi appelé parce que son eau fait pousser des verrues. Devani, qui a assisté à tous les travaux de la route, m'affirme qu'à ce point une grande mortalité s'était déclarée parmi les ouvriers, à cause des verrues, qui leur poussaient sur toutes les parties du corps, sans excepter les yeux et les oreilles.
La nature devient toujours plus sauvage, les montagnes plus escarpées. Nous n'apercevons que quelques pâtres conduisant leurs chèvres. Ils habitent des cavernes ou des huttes de pierre sèche.

Pérou.—Chemin de fer de la Oroya.—Tunnel de Parac.
Dans les gares, des cholas (Indiennes) se montrent avec leur bébé attaché sur le dos à la manière japonaise; elles ont le même costume que les montagnards de l'Himalaya: une espèce de soutane qui les couvre jusqu'aux pieds. Leur type est celui de la race jaune un peu mélangé. Évidemment il y a eu des gens que le courant ou les tempêtes ont amenés ici de divers pays et qui, par la suite, se sont croisés. Les Indiens d'ici, comme ceux de l'Hindoustan, mâchent une feuille appelée coca, la même que j'avais vue aux Indes, et préparée également avec un peu de chaux. J'ai pour compagnon de voyage un aventurier des environs de Nîmes. Il s'en va à certaines mines de l'intérieur et connaît parfaitement ce pays. Chemin faisant, il me raconte que l'amour d'aventures le poussa (p. 375) à quitter de bonne heure son village; qu'il parcourut la plupart des pays d'Amérique et de l'Extrême-Orient, essayant de nombreux métiers; arrivant plusieurs fois à la fortune, la perdant et la refaisant encore. En dernier lieu tout son avoir était dans un navire qu'il avait chargé pour l'Europe, et il a fait naufrage. Il venait de remettre à la Monnaie de Lima un lingot d'argent de 12,000 fr., et l'employé s'est sauvé en l'emportant. Il reprend son courage (p. 376) et son travail et espère refaire bientôt fortune. Il y a quelque temps, après 25 ans d'absence, sans avoir donné signe de vie, le désir le prend de revoir son village et ses parents. Il part pour l'Europe et arrive chez lui: personne ne le reconnaît; on le croyait mort, mais aussitôt qu'on sait qu'il vient d'Amérique et qu'il a de l'argent, les frères, les sœurs, les neveux, les oncles, les grands-oncles sortent de tout côté; tout le pays veut être son parent. Un lui demande l'achat d'un petit champ, l'autre d'un mulet; la mère veut qu'il dote ses sœurs. Après 6 jours, le bonhomme avait épuisé sa bourse et crut prudent de reprendre le chemin de l'Amérique. Ici il est encore poursuivi par leurs lettres; tantôt c'est une sœur qui se marie et qui demande un trousseau; tantôt un neveu qui se trouve au régiment et malade à l'hôpital; tantôt une nièce qui va monter un magasin et lui demande de l'aider. Il a envoyé de l'argent à plusieurs reprises, mais il craint maintenant les tromperies et ne répond plus. Je signale cet oncle d'Amérique aux amateurs de vaudeville.
Enfin le train arrive à Matucaña, à 7,788 pieds. La température y est délicieuse, nous sortons de la chaleur suffocante que nous avons eue jusqu'ici. La vallée s'élargit un peu. Le Rimac bouillonne entre les roches comme un Gave des Pyrénées laissant sur sa route une agréable bande de verdure. Matucaña, comme tous les villages que nous avons vus jusqu'ici, est brûlé; les soldats chiliens se logent dans l'Église. La locomotive siffle et reprend (p. 377) sa marche. L'espace manquant pour développer les courbes, le train revient en sens inverse formant dans la montagne cinq zigzags, comme dans les anciennes routes voiturables. La locomotive les parcourt, tantôt en tirant le train, tantôt en le poussant par derrière.

Pérou.—Chemin de fer de la Oroya.—Station de Chicla.
Bientôt nous arrivons à l'Infernillo: là on a fait dévier la rivière en la jetant sous un petit tunnel. Les parois de (p. 378) la montagne s'élèvent à pic à une hauteur effrayante. Toujours la même désolation: rochers nus, pas un brin d'herbe.
Je commence à sentir les effets du sorroche, maladie des grandes altitudes. La respiration devient difficile, la tête lourde, on a de la peine à penser, à parler, à écouter; la vie semble manquer. Enfin, à cinq heures et demie nous nous arrêtons à Chicla; à 12,200 pieds d'altitude. Le chemin est tracé, mais non fini, jusqu'au mont Meiggs, à 17,574 pieds d'altitude, d'où il descend à Oroya, à 12,257 pieds, sur le versant est des Andes, dans le bassin de l'Amazone. Il m'aurait été difficile d'aller jusqu'au bout; j'ai de la peine à gravir la petite rampe et les quelques marches qui montent à l'hôtel.
La nature est grandiose d'horreur; le soleil éclaire les derniers sommets dont quelques-uns blanchis de neige; autour de nous de nombreux troupeaux de llamas qui seuls portent sans fatigue leur charge d'un quintal dans ces altitudes.
À table prennent place des Allemands, des Espagnols, des Anglais, des Français; on parle une langue qui tient des quatre à la fois. Ces aventuriers, après le dîner, se montrent leurs joujoux: des revolvers et des coutelas, et racontent beaucoup d'histoires sur les Indiens avec lesquels ils trafiquent. Comme dans tous les pays reculés, ces Indiens croient aux fées, à la magie, et torturent certains membres d'un crapeau pour guérir un malade en enlevant le maléfice de la sorcière. Je ne sais pas (p. 379) pourquoi sur tous les points du globe, c'est toujours au crapeau qu'on s'en prend dans ces circonstances.
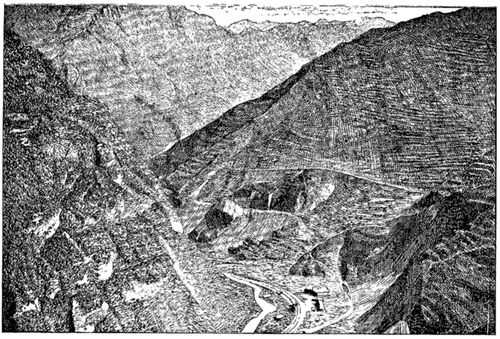
Pérou.—Chemin de fer de La Oroya.—Rio Blanco.
Enfin, après avoir longtemps admiré les étoiles, beaucoup plus brillantes dans cette atmosphère raréfiée, j'essaie d'écrire, mais les mains tremblent comme les jambes; je n'ai pas plus de force qu'un enfant, et je prends le lit. Impossible de dormir, le froid me glace, et mon voisin, séparé par une simple cloison de toile tapissée, fait encore de plus grands efforts que moi pour respirer. Le matin, à cinq heures et demie, Georges m'appelle; à six heures nous sommes sur le carrito. Je m'enveloppe comme un ours et nous voilà partis. Imaginez un petit char découvert à quatre roues, lancé sur des rails dont la pente varie de 2 à 4 pour cent. Il se précipite avec une rapidité vertigineuse, entre dans les ténèbres des tunnels, en sort, franchit les ponts. On se demande si on arrivera entier. Mais Georges me rassure. J'ai souvent déraillé de nuit, me dit-il, bien des individus ont eu des bras et des jambes cassées, mais je n'ai jamais déraillé de jour. En effet, il manœuvre si bien avec son frein, qu'il évite les chars des travailleurs, et ne tue même pas un des nombreux chiens sur la route. Au bas de la montagne, à Chosica, je veux acheter mon déjeuner au restaurant où j'ai dîné la veille; il n'a pas même de pain. Mais à peine le capitaine chilien qui commande le détachement l'apprend-il, qu'il m'en fait apporter du sien. Ainsi, même au Pérou, je devais encore une fois éprouver les effets de la bonté chilienne.
(p. 380) À dix heures nous entrions à Lima, après avoir dégringolé, en quatre heures environ, 4,000 mètres d'altitude. Je me suis demandé pourquoi on a dépensé presque 100 millions de francs pour conduire la locomotive pendant 150 kilomètres dans des montagnes arides qu'il faudra redescendre sur l'autre versant. Il aurait été plus économique et plus court de faire un tunnel comme au Mont-Cenis et au Saint-Gothard. Le chemin de fer transandin m'a paru une simple route carrossable dont les pentes, ne dépassant pas 4%, peuvent laisser passer sur les rails la locomotive. On dit qu'il doit atteindre au Cerro de Pasco une région minière qui contient beaucoup d'argent.
À Lima, je me rends chez M. Lavalle, qui, avec le général Iglesia, s'occupe en ce moment de ramener la paix dans son pays, et je regrette que le temps ne me permette pas de causer longuement avec lui.
À la station, MM. Garcia, Fort et Carriquiry poussent l'amabilité jusqu'à m'accompagner au Callao et ne me quittent qu'au bateau. Que ces messieurs et tous ceux qui m'ont aidé à rendre instructif mon court séjour au Pérou reçoivent ici l'expression de ma reconnaissance.
C'est l'Islay de la Pacific steam Cy qui va me porter à Panama. Ce vieux navire à roue serait tout au plus bon pour une rivière. Son service est mal fait, la cuisine détestable et les prix exorbitants; mais la Pacific steam n'a pas de concurrent sur cette ligne et laisse crier les passagers. On dit qu'une compagnie française a essayé ce parcours et n'a pas réussi; mais on ajoute que l'administration (p. 381) locale laissait à désirer, et que ses bateaux étaient faits pour d'autres mers que ces mers tropicales. Dans ces parages, la chaleur exige que les cabines soient placées sur le pont. Une compagnie qui, dans un esprit pratique, ferait le service régulier entre Panama et Callao, rendrait service au public et gagnerait de l'argent: c'est la voix universelle dans ces contrées.
25 août.—Navigation lente et sans incident, l'air est extraordinairement frais, quoique nous soyons à peu de degrés de l'Équateur. J'en demande la raison à plusieurs savants qui sont à bord; aucun ne sait m'en donner une bonne: la science, malgré ses progrès, a encore bien des choses à trouver et à expliquer.
La côte continue à être d'une désolante laideur, pas un brin de verdure, toujours sables et rochers nus.
Vers le soir, une bande de marsouins vient voltiger autour du navire et semble se réjouir par ses sauts élevés.
26 août.—À deux heures, nous rencontrons le navire de la même compagnie qui vient de Panama. Au moyen d'un canot on échange les dépêches. Au retour, le canot, entraîné par un courant, n'aurait pu rejoindre le navire, si celui-ci ne fût venu à lui. À quatre heures, nous jetons l'ancre devant Payta. Deux voiliers marchands et un aviso de guerre chiliens sont dans la rade. Je vais à terre: la gare du chemin de fer et la maison de la douane sont brûlées, tristes fruits de la guerre! Plusieurs maisons tombent en ruine; la plupart sont de bambous et de terre; l'église même a la toiture en chaume. Les rues (p. 382) sont étroites et sales, les enfants grouillent dans de misérables chambres où, pour tout mobilier, je vois un hamac sur lequel se balance la mère. Une odeur infecte sort de partout; je me hâte de quitter ce nid à typhus.
27 août.—À trois heures du matin l'Islay quitte Payta, le dernier port du Pérou vers le nord, et nous marchons vers Guayaquil, dans la République de l'Équateur, où le lecteur pourra nous suivre dans un autre volume.
Pages
Préface I
Chapitre Ier.—Portugal.
Le départ. — Le Tage. — Lisbonne. — La ville. — Les œuvres catholiques. — L'église de Saint-Roch. — Le cloître de Bélem. — La Casa Pia. — La navigation. — Un mineur qu'on voudrait détrousser. — Le steamer le Niger. — Ses dimensions. — Les passagers. 1
Chapitre II.—Sénégal.
Arrivée à Dakar. — Les nègres plongeurs. — La végétation. — Le marché. — Les fruits. — La ville. — Les cases des nègres. — L'industrie au Sénégal. — Le couscous. — Les négresses. — Une école indigène. — Le roi de Dakar. — Les Sœurs de l'Immaculée-Conception. — Les Pères du Saint-Esprit. — Les Frères de Saint-Gabriel. — Apparition de la locomotive. — Le passage de la ligne. — Les couchers du soleil. 13
Chapitre III.—Le Brésil.
Olinda. — Pernambuco. — Le débarquement. — La ville. — Les monuments. — Les institutions de charité. — Le marché. — Les environs. — Bahïa. — La ville. — Le couvent de Sn-Bento. — Les établissements charitables. — La baie de Rio-de-Janeiro. — Le Brésil. — Forme de gouvernement. — Budget. — Armée. — Marine. — Produits. — Importation. — Exportation. — Immigration. — La monnaie. — La ville de Rio. — Ses faubourgs. — Nicteroy. — L'hôtel Moreau. — Fleurs et fruits. — La Tijuca. — Le musée. — Réception de l'Empereur et de l'Impératrice. 25
Chapitre IV.
Excursion à Pétropolis. — Rencontre du comte d'Eu. — Sa famille. — La colonie allemande. — L'ingénieur Bonjean. — La filature la Pétropolitana. — Les bois de construction. — Pourquoi on délaisse l'industrie française. — Le corps diplomatique. — L'internonce et l'administration religieuse. — Le téléphone. — La Chambre des députés. — Les chemins de fer. — Le baron de Teffé et l'exploration de l'Amazone. 53
Chapitre V.
Excursion à Copa-Cabana. — Sauvés par un bambin. — Le jardin botanique. — L'Hospicio Don Pedro II. — L'orphelinat de Sainte-Thérèse. — Le Casino Fluminense. — Encore le bureau de colonisation. — Le téléphone. — Le marché. — Les aumônes impériales. — L'Hospicio de la Misericordia. 73
Chapitre VI.
Départ pour l'intérieur. — L'esclavage. — La filature de Macaco. — La plantation de D. Pedro Paes-Leme. — Son usine à sucre. — Une famille heureuse. — J'arrive à Barra do Pirahy. — La fazenda de café du baron de Rio Bonito. — La forêt vierge. — La plantation des caféiers. — Cueillette du café. — Préparation. — Coût de production et prix de vente. — Les 800 esclaves. — Les fauves et le gibier. 89
Chapitre VII.
Route vers San-Paulo. — Deux musiques de nègres. — La fête de saint Jean et les pétards. — Un étrange garçon. — La ville. — L'hôpital et les Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry. — Un vigneron français. — Départ pour Sanctos. — Les entrepôts de café. — La Casa di Misericordia. — Navigation vers la République orientale. — En quarantaine à l'île de Florès. 107
Chapitre VIII.—L'Uruguay et la Plata.
Montevideo. — La République orientale ou de l'Uruguay. — Population. — Surface. — Produits. — Exportation. — Importation. — Les Saladeros. — Fray-Bentos et l'extrait de viande Liebig. — Un calcul pour s'établir dans le pays. — Forme de gouvernement. — L'armée. — Rôle de la petite république. — Villa Colon. — Le velario. — Traversée de la Plata. — Buenos-Ayres. — Rues et monuments. — Climat. — Agriculture. — Colonies. — Industrie. — Commerce. — Chemins de fer. — Presse. — Navigation. — Postes et télégraphes. — Budget. — Armée. — Marine. — Main-d'œuvre. — Immigration. — Monnaie. — Dette. — Culte. — Instruction publique. — Assistance publique. — Justice. 121
Chapitre IX.
San Carlo Almagro. — Dom Bosco et ses institutions. — Les Sœurs de Marie-Auxiliatrice. — La Société d'agriculture. — Prix des terrains. — Les œuvres charitables. — Les Lazaristes. — Les Sœurs de Charité. — L'Hospicio de los Mendigos. — La distribution de L'eau. — La fête nationale. — La législation. — Une stancia modèle. — L'autruche et ses mœurs. — Détails sur l'agriculture et L'élevage. 139
Chapitre X.
Retour à Buenos-Ayres. — La nouvelle capitale de la Plata. — Les banques. — Le Musée. — Départ pour Rosario. — Navigation intérieure. — San-Nicolas. — Le pingoin. — La guerre du Paraguay. — Rosario. — San-Juan. — Mendoza et la viticulture. — Inondation dans l'est, sécheresse dans l'ouest. — Un elevator. — Un Allemand colonisateur. 157
Chapitre XI.
Une séance à la Chambre des députés. — Le collège San-Salvador. — L'hôpital. — La charité privée. — Le collège San-José. — Pensées d'un voyageur. — Plantation de la canne à sucre dans les diverses provinces. 177
Chapitre XII.
Retour à Montevideo. — Le bassin de radoub. — Les saladeros au Cerro. — Leur fonctionnement et leurs produits. — La forteresse. — La Société d'agriculture. — Un Parisien éleveur. — La famille Jackson-Buxareo et ses œuvres. — L'hôpital. — L'Hospicio de los Mendicos. — Le maté. — Le manicomio. — Une soirée chez le président du conseil des ministres. — L'embarquement sur l'Aconcagua. — La navigation le long des côtes de la Patagonie. — Le détroit de Magellan. — La Terre de feu. — Arrivée au Chili. 191
Chapitre XIII.—Le Chili.
Situation. — Configuration. — Surface. — Population. — Revenu. — Dépense. — Importation. — Exportation. — Armée. — Marine. — Instruction publique. — Chemins de fer. — Guano. — Minerai. — Histoire. — Constitution. — La guerre avec le Pérou et la Bolivie. — Débarquement à Coronel. — Les Basques. — De Coronel à Lota. — Les ranchos. — Types. — Lutte à cheval. — Lota. — Les mines de charbon. — La fonderie de cuivre. — La verrerie. — Le parc Cuscino. — La population ouvrière. — Retour à Coronel. — La fonderie Schwaga. — Les mines de charbon au Maule. — Un fou. — Départ pour Concepcion. 217
Chapitre XIV.
De Coronel à Concepcion. — La diligence. — Le paysage. — Arrêt à la Posada. — Le Bio-Bio. — La ville de Concepcion. — Encore le maté. — Le testament de Mgr Salas. — Le sortéo. — L'organisation judiciaire. — Les œuvres charitables. — Les magasins. — Appellations chiliennes des étrangers. — L'hôpital. — La fille singe. — La supérieure de Talca. — Excursion en Araucanie. — La ville d'Angol. — Les Basques, leur commerce, leur organisation, leur hospitalité. — Croyances religieuses. — Offrande des prémices. — Une invitation. — La Chambre arsenal. — Exploits des Araucans. — Conquête et colonisation. 235
Chapitre XV.
Les prisonniers. — Les ranchos indiens. — Mobilier. — Vêtement. — Nourriture. — Les femmes. — Les enfants. — Les bijoux. — Les armes. — L'industrie. — Les funérailles. — Le calendrier ficelle. — L'excursion au fort de Chiguaïhué. — Un fort abandonné. — Apostrophe à deux cavaliers. — Les frères Mackay. — La chasse. — Un camp indien. — La chasse au mauvais esprit. — Musique. — Danse indienne. — Détails sur la ferme. — Le blé. — Le bétail. — Le tabac. — Les forêts. — La main-d'œuvre. — Les machines. — Le gibier. — La petite araignée. — Son ennemie, la mouche. — La Samo-cueca. — Les bâtiments. — Les ateliers de réparations. — Le petit Indien. — Le Cacique et sa famille. — Un jugement plus facile que celui de Salomon. — Le mariage chez les Araucans. — La naissance. — La médecine. — La sorcellerie. — Une grande partie de Chuenca. — Retour à Angol. — Les franciscains. — Le pater Araucan. 249
Chapitre XVI.
D'Angol à Santiago. — La grande Cordillera de los Andes. — La cordillera côtière. — La ville de Talca. — L'hôpital. — Les maladies régnantes. — Les Sœurs du Sacré-Cœur. — Le théâtre. — Le clergé. — Le marché. — Les bains de Cauquènes. — Mésaventure à Gultro. — L'hospitalité du chef de gare. — Détails sur la viticulture. — Prix des terrains. — L'ouvrier. — La Chica. — Une scierie de marbre. — Le Maïpu. — Arrivée à Santiago. — Le garçon d'hôtel et le tarif. — La cathédrale. — Le cerro de Santa-Lucia. — La ville. — Le théâtre. — L'Alameda. — L'hôpital. — Les quatre Sœurs de l'Aconcagua. — Les statues des grands hommes. — Les sifflets de nuit. — La plaça de arme. — Les jeunes filles et les tramways. — Les œuvres charitables. — Les talleres de San-Vincente. — Le Sénat. — La Légation de France. — Les capucins. — Don Benjamin. — L'hospitalité chilienne. — L'élection présidentielle. 269
Chapitre XVII.
Le collège des jésuites. — L'épiscopat. — La Saint-Albert. — La Monnaie. — Le ministre des finances. — Le papier-monnaie. — Incendie de l'église de la Compañia. — La bibliothèque. — L'Université. — Lutte à propos des cimetières. — Les Cercles catholiques. — La Quinta normal. — Les Pères de Picpus. — Un dîner diplomatique. — De Santiago à Valparaiso. — La hacienda de Limache. — L'Urmaneta. — Le huasso. — Une vacherie. — Une porcherie. — L'élevage. — Salaires. — Logements. — La ville de Valparaiso. — Le port. — Le gaz. — Don Mariano Sarratea. — Le code civil. — Le gouverneur ecclésiastique. — L'hôpital. — Le logement des pauvres. — Los padres frances. — Les docks. — Les grues Amstrong. — La belle Elène. — Le séminaire. — Les Sœurs de la Providence. — L'enseignement par les yeux. — Le club français. — Guerre barbare. 291
Chapitre XVIII.
Départ pour le Pérou. — Le steamer La Serena. — Mes compagnons de voyage. — Navigation. — L'arche de Noé. — Coquimbo. — Les fonderies de Guayacano. — Un dîner politique. — La ville la Serena. — L'intendant. — L'évêque. — La garde nationale. — Huasco. — Carrizal-Bajo. — La fonderie Gibbs et Cie. — Main-d'œuvre. — Logements. — Les forces de la nature. — Le maestranza. — Encore la Samo-cueca. — La poésie et la musique. — Caldera. — Le désert d'Atacama. — Le chemin de fer de Copiapò. — Le borax. — Chañaral. 313
Chapitre XIX.
Le 15 août à Tantal. — L'Église et le Pasteur. — La Marseillaise au désert. — Encore l'Aconcagua. — Antofogasta. — Le salpêtre. — L'iode. — La Société Beneficiadora de metales. — Le salaire. — Le guano. — La laguna d'Acostan. — Encore l'incendie de l'église de la Compañia. — Épisodes émouvants. — Capture de Huescar. — Les marsouins. — Iquique. — Les incendies. — Combat naval. — L'eau distillée. — Le vicaire ecclésiastique. — L'école. — La prison. — Prix divers. — Pisagua. — Arica. — Les effets de la guerre. — Un tremblement de mer. — La Bolivie. — Tacna. — La Pax. — La corvette Le Camus. — Mollendo et le chemin de fer de Pisco. — Les îles de Chinca. — Une lettre de Pascal Duprat à propos de Voltaire. — Réponse du député Don Ambrosio Montt. 329
Chapitre XX.—Le Pérou.
Surface. — Population. — Gouvernement. — Justice. — Les Chinois. — L'instruction. — Le guano et le salpêtre. — La guerre avec le Chili. — Les Incas. — Leurs croyances. — Manco-Ccapec et sa dynastie. — Les lois et usages. — Le Callao. — Le port. — La monnaie. — Les types. 347
Chapitre XXI.
Lima. — L'hôpital français. — Les monuments. — Le Panthéon. — L'hôpital due de Mayo. — L'hacienda l'Infanta. — La fabrication du sucre. — Les édifices religieux. — Sainte Rose de Lima. — L'Établissement de Bélem, et les Congrégations françaises. — Excursion à Chicla. — Le chemin de fer transandin. — Un oncle d'Amérique. — Les Indiens et la magie. — Le sorroche. — Retour à Lima. — Payta. — Navigation vers l'Équateur. 361
Note 1: On appelle saladeros les usines dans lesquelles on tue les animaux pour en saler la viande, préparer la graisse, etc.[Retour au texte principal.]
Note 2: Nom qu'on donne aux fermes pour l'élevage du bétail.[Retour au texte principal.]
Note 3: Depuis que ces lignes ont été écrites les journaux ont annoncé la création d'une banque française.[Retour au texte principal.]
Note 4: Le peso chilien vaut en ce moment 3 fr. 70.[Retour au texte principal.]
Note 5: Le sole argent vaut nominalement 5 fr., mais aujourd'hui (1883), pour le change, il n'est coté que 4 fr. 20. Le sole papier vaut 29 centimes.[Retour au texte principal.]
End of the Project Gutenberg EBook of À travers l'hémisphère sud, ou Mon
second voyage autour du monde, by Ernest Michel
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK A TRAVERS L'HEMISPHERE SUD ***
***** This file should be named 26510-h.htm or 26510-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/2/6/5/1/26510/
Produced by Adrian Mastronardi, Christine P. Travers and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.net/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.net),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.net
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.